Jazz à Luz (4)

Dernier épisode de Jazz à Luz 2018, sans doute un des festivals les plus libres et les plus audacieux qui existent aujourd’hui. Mon camarade Ludovic Florin vous a raconté les trois premiers jours (il est plus rapide que moi), en voici le dernier.
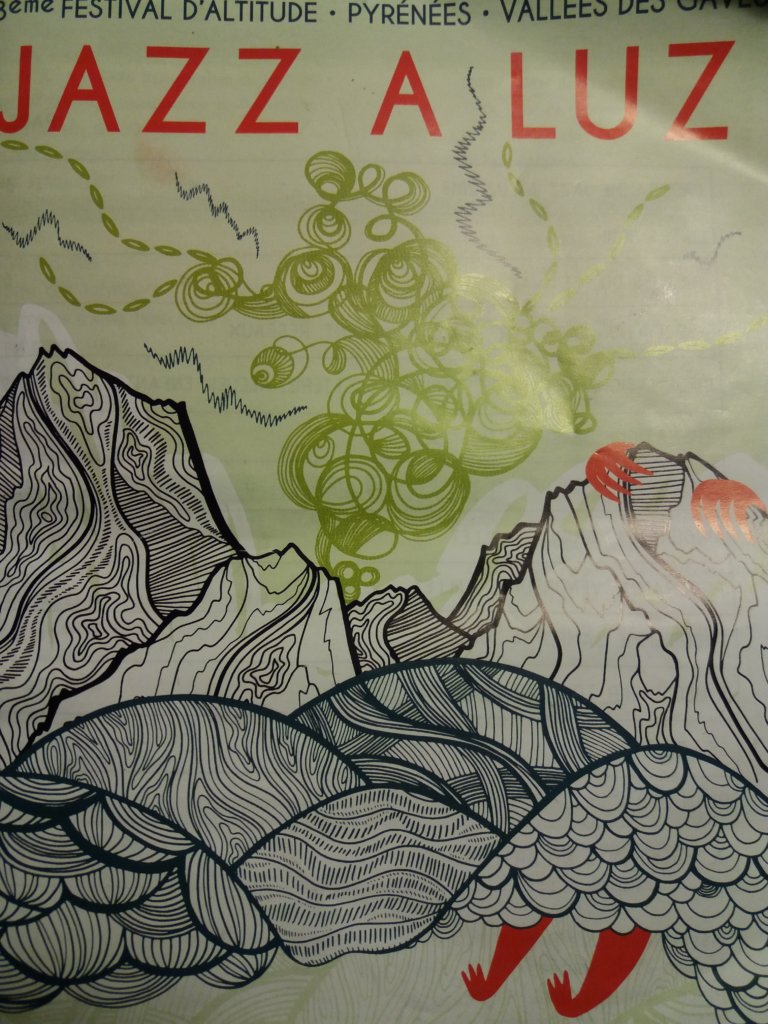
Chaque année le festival de Luz valorise la rencontre entre la musique et une autre pratique artistique. Cette année c’est l’art plastique qui lui est associé, objet de deux performances très différentes celle du trio BEK (Betty Hovette, Karine Sancerry, Emilie Mousset) et celle du duo Gaspar Claus-François Olislaeger.
Betty Hovette (p), Karine Sancerry ( compositions plastiques), Emilie Mousset (sons), Le 14 juillet 2018, Forum de Luz Saint-Sauveur
Les trois protagonistes du trio BEK sont très proches les unes des autres à portée de regards et de gestes. Au coeur de la salle, elles forment un triangle dont le piano de Betty Hovette et l’ordinateur de l’éléctro-accousticienne Emilie Mousset constituent la base, et dont la plasticienne Karine Sancerry serait la pointe. Cette dernière est accroupie, entourée de ses pots et de ses pinceaux, penchée sur une feuille transparente et imperméable. Ses compositions sont projetées juste devant elle. Elle utilise du brou de noix et de l’eau. Cela donne des couleurs qui parcourent toutes les nuances du brun, de l’ocre, du marron.

Son travail est en perpétuel mouvement car elle ne crée pas à partir d’une page blanche mais toujours à partir de cette même matière brune qu’elle reprend, affine, délave, déconstruit (au pinceau ou à la main) et renouvelle sans cesse. Cette impression de mouvement permanent est renforcée par les gouttes de peinture animées d’une vie autonome, qui se rétractent comme de petits insectes, ou font coalescence. Cette technique d’art plastique donne donc à la plasticienne des outils lui permettant de réagir avec souplesse aux propositions de la pianiste Betty Hovette ou de l’éléctro-accousticienne Emilie Mousset.
Le dialogue entre les trois artistes n’est pas seulement livré à leur inspiration du moment. Il s’agit d’une inspiration cadrée, on sent que le trio dispose d’une sorte de trame thématique qui les oriente. On passe d’ambiances lumineuses du début, quand Betty Hovette joue des notes de piano sereines, chaleureuses et ensoleillées, mêlées à un carillon pimpant qui leur confère un caractère édénique, à des ambiances plus menaçantes.
Les correspondances trouvées entre les sons du piano et l’image sont à la fois simples et belles: par exemple quand Betty Hovette explore les graves de l’instrument (sur le clavier ou dans les cordes) un noir opaque et goudronné envahit la toile. Autre moment caractéristique: quand dans la deuxième moitié de cette performance, Betty Hovette se confronte à des ambiances rythmées, tendues, inquiétantes, Karine Sancerry projette une pluie de pigments sur sa plaque, qui font apparaître de troublantes nuances bleutées dans le lacis des ocres, des bruns, des goudrons.

Les interventions de l’éléctro-accousticienne sont discrètes mais toujours pertinentes. J’aime particulièrement ces ambiances industrielles qu’elle distille au moment où la plasticienne élabore des géométries radicales en traçant avec la main des sortes de hachures. Au total, les changements d’atmosphère s’enchaînent avec souplesse et naturel. Les correspondances entre les différents arts finissent par nous les faire voir sous un jour différent: c’est ainsi qu’au bout de quelques dizaines de minutes le halo tremblant des gouttelettes de peinture appliquées par Karine Sancerry m’apparaît comme une sorte de micro-résonance, tandis que les différentes atmosphères produites par Betty Hovette me font songer à une suite de tableaux dessinés avec les doigts. Une performance d’une fluidité enchantée.
« Ce qui tremble et brille au fond de la nuit noire » Gaspar Claus (violoncelle et effets), François Olislaeger (dessins) , maison de la Vallée de Luz Saint-Sauveur, samedi 14 juillet
Un peu plus tard dans l’après-midi, c’est au tour de Gaspar Claus et de François Olislaeger d’explorer les liens entre dessins et musique pour une performance au titre énigmatique « Ce qui tremble et brille au fond de la nuit noire ».
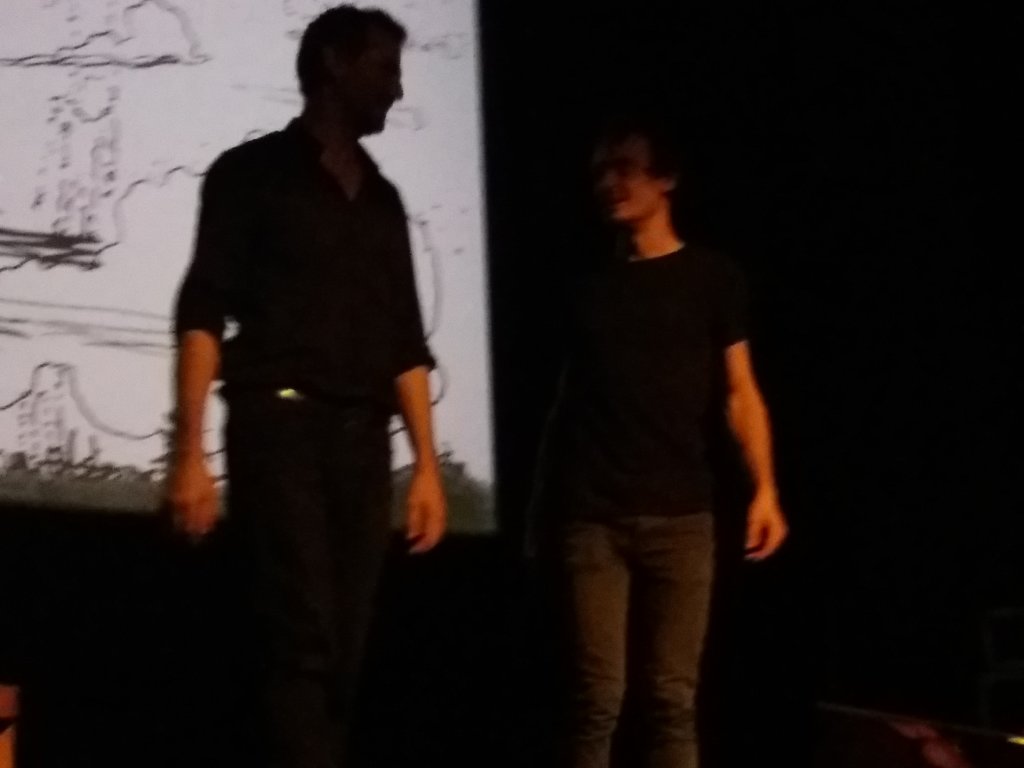
On connaît Gaspar Claus, violoncelliste sans limites et sans frontières, aussi à l’aise avec Stufjan Steven, Angélique Ionatos, qu’avec Serge Teyssot-Gay ou Pedro Soler. Quant à François Olislaeger, dessinateur, illustrateur, auteur de BD, il a sur le plan graphique presque autant de cordes à son arc que le violoncelliste. Il a réalisé nombre de performances avec des artistes aussi divers que Mathieu Boogaerts ou David Prudhomme.
Ici encore, il s’agit d’une improvisation cadrée. Une trame narrative est perceptible, avec des évocations de nature mythologique et cosmologique, qui ont le mérite d’être assez oniriques pour ne pas enfermer l’imaginaire des deux artistes. Les dessins (avec autant d’interprétations que de spectateurs) peuvent évoquer la création du monde par un dieu mélancolique, avec d’abord une faune aquatique plus ou moins rêvée (méduses, poissons, bestioles à antennes…) puis une séquence plus végétale avec une jungle, des oiseaux, des singes, ou encore une description du ciel et des constellations qui se transforme en tortue (on sait que dans certaines cosmologies d’Asie, les tortues portent le monde sur leur dos).

Il m’a semblé percevoir aussi, dans ces dessins en noir et blanc réalisés par François Olislaeger, et qui trahissent parfois des influences orientales, une allusion au déluge, puis pour finir un univers urbain violent et agressif. Bref une suite de tableaux où chacun est libre de trouver la cohérence qui lui plaît, ou même de n’en trouver aucune, mais qui est un bon prétexte à la rêverie. Du reste, le style de dessin de François Olislaeger, avec leur grâce un peu naïve, concourt à ne pas trop figer les choses et à donner à ses évocations un caractère poétique.
Et Gaspar Claus dans tout cela? Son entrée en matière est plutôt minimaliste. Il travaille d’abord la matière brute, explorant tout le spectre des grattements et des grincements de son instrument, et jouant sur les frontières du bruit et du son. Ensuite, il adosse son violoncelle à de puissantes et massives distorsions, réverbes, pédales diverses qui donnent à son jeu une dimension orchestrale.
A plusieurs reprises, quelques séquences accoustiques, aussi brèves que bouleversantes interviennent comme si Gaspar Claus avait décidé de jouer une suite de Bach dans une jungle de sons saturés. C’est le cas par exemple dans ce moment où l’on voit apparaître sous le stylo de François Olislaeger tous les animaux, après le déluge, et où la vie triomphe de la mort.
A l’inverse, vers fin de la performance, au moment où le dessinateur François Olislaeger évoque des ambiances urbaines (voitures, routes, fils électriques) il exploite toutes les qualités expressives de son violoncelle (dissonances, craquements, sons saturés) pour faire monter la tension.
La performance finit dans des ambiances nuageuses esquissées par le dessinateur, tandis que Gaspar Claus martèle un petit motif répétitif. Dans ce très beau concert, l’image a sans doute un rôle plus moteur qu’avec le trio BEK ce matin. Après le concert, j’échange quelques mots avec Damien, habitué du festival, une des plus fines oreilles que je connaisse, qui regrette que l’accumulation d’effets ait un peu trop souvent noyé la sonorité accoustique de Gaspar Claus. A mon sens pourtant, ce parti pris découle des thématiques choisies pour cette performance, à savoir l’évocation de la création, du bouillonnement originel, la tentation du chaos. Quoi qu’il en soit, la manière dont Gaspar Claus maîtrise tous les registres de son instrument, de la poésie bruitiste des grattements aux grandes phrases mélodiques est impressionnante.
Le dernier concert du soir, der Verboten, réunit un quartet de fortes personnalités dont la première réunion remonte à 2016, lors du festival Météo de Metz.

Der Verboten, avec Cédric Piromalli (piano) Frantz Loriot (violon alto) Christian Wollfarth (percussions) Antoine Chessex (tenor sax), sous le chapiteau de Luz, 14 juillet 2018
Si les deux premiers concerts avaient un cadre ou une trame thématique plus ou moins lâche, celui-ci aborde l’improvisation dans son acception la plus radicale et la plus escarpée. Le concert commence par des sons minimaux, jetés en vrac comme les morceaux d’un puzzle, tout se passe comme si chaque instrumentiste, refermé sur lui-même, explorait la zone d’inconscient de son instrument. Seul se tient en retrait le saxophone d’Antoine Chessex.
Quand il intervient c’est comme si les morceaux épars du puzzle commençaient à se rassembler. Il possède une sonorité très particulière, un peu voilée, par moment très suave, qui s’épanouit surtout dans le grave et dans le médium. Sa douceur apparente ne l’empêche pas de développer une sorte de puissance cachée. C’est donc lui qui, progressivement, aimante et structure la masse sonore produite par les autres musiciens. Parfois, dans le tableau d’un peintre, il suffit d’un arbre pour organiser tout le paysage. Ce soir, parmi tous ces musiciens, l’arbre c’est lui. Après s’être positionnés les uns par rapport aux autres, tous ces musiciens élaborent différentes stratégies sonores, un peu comme des danseurs qui font progressivement connaissance, et qui pour se tester initient différents pas de danse, des plus simples aux plus compliqués. Dans ces configurations sonores diverses, la place du saxophone reste donc toujours toujours un peu spéciale. Il réussit à donner le sentiment que la musique ralentit, et même, par une sorcellerie qui tient plus à sa sonorité qu’à des effets spéciaux qu’il se trouve dans une autre pièce que les autres musiciens…
Et aux trois quarts du concert, tous ces musiciens, y compris Antoine Chessex, se retrouvent à pousser dans la même direction. Il s’ensuit un long crescendo au cours duquel la musique devient de plus en plus dense, de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Je ne sais pas exactement combien de temps a duré ce moment, si c’était cinq minutes, dix , ou douze, car j’ai a ce moment là cessé de prendre des notes, happé et bousculé par la force de cette musique. A deux ou trois reprises, j’ai pensé que l’improvisation avait atteint son pic de force, de violence, de véhémence, mais ce n’était pas l’avis des quatre musiciens qui avec obstination ont continué de faire bloc et de pousser tout ensemble, jusqu’à porter l’énergie à un paroxysme qu’ils ont maintenu quelques instants. Puis cette intensité est redescendue et les moments musicaux suivants furent comme une récupération ou une remise en ordre après un tremblement de terre. Admirable groupe, à faire écouter à tous ceux qui reprochent encore à la musique improvisée contemporaine d’être désincarnée et insipide. Ici, bien sûr les enjeux sont en apparence abstraits (recherche sur le timbre et la répartition de la masse sonore, explorations sur la manière de concilier la liberté de chacun avec des structures) mais l’enjeu profond reste de savoir comment se rencontrer musicalement, comment se rencontrer vraiment (d’où la notion de Treffpunkt, « point de rencontre » qui sert d’étendard au quartet) et les quatre musiciens répondent à cette question avec toute leur sensibilité, toute leur intelligence, toute leur force.
Le festival se termine par de la danse avec Francky goes to Point à Pitre, une véritable machine à danser qui plante ses palmiers en plastique sur scène pour bien afficher ses intentions. Le groupe propose un mélange improbable et imparable de zouk, de rock, de noise. Même quand il s’agit de danser, le festival de Luz sait dénicher des sons inédits. Au total, la 28e édition de ce festival décidément unique a proposé des moments musicaux de haute altitude, et fièrement assumé sa devise, « faire le pari de l’étonnement ».
Texte: JF Mondot
Photographies: Ludovic Florin et parfois mézigue