Le saxophoniste Stefano di Battista partage la scène de la Cité de la musique avec l’écrivain Erri De Luca
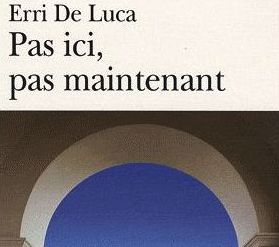
Voir et entendre l’écrivain, poète, militant, maçon et alpiniste Erri De Luca était une perspective aussi attirante que la présence à ses côtés du saxophoniste Di Battista suscitait ma perplexité. Ne sachant rien de la chanteuse Nicky Nicolai, j’ai tenté l’expérience.
Salle de concerts de la Cité de la musique, Paris (75), le 10 février 2017.
La musica insieme : Erri De Luca (récitant), Nicky Nicolai (chant), Stefano Di Battista (saxophones), Andrea Rea (piano), Daniele Sorrentino (contrebasse), Roberto Pistolesi (batterie).
On écoute parler et réciter Erri De Luca avec passion, comme on le lit. Dans un français lyrique et rocailleux, parole de conteur, de moraliste au sens noble du terme, un conteur de parabole, un fabuliste merveilleux, d’où suinte tout à la fois tendresse, rage de vivre, de dire, de clamer, humour, fantaisie, amour de la vie, de la nature, de l’humanité et de son histoire dont il a scruté en libre penseur agnostique les civilisations, les religions et les grands mythes de la Méditerranée qu’il nomme Mare Nostrum.
Puis soudain, on change de lieu, de temps, d’univers, pour sombrer dans une chanson de variété jazzy, un jazz de convention, bruyant, bavard, casant son petit solo entre deux refrains de radio-crochet, tantôt en italien sous-titré tantôt dans un français qu’il eût mieux valu sous-titrer. Au pays de – ratissons large – Giovanna Marini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Elena Ledda, Adriano Celentano, Gianmaria Testa, Lucilla Galleazi, Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Gabriele Mirabassi, Pino Minafra, Gianluigi Trovesi et Gianni Coscia, Paolo Fresu, Antonello Salis, Nino Rota, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti… – que sais-je ? –, on attendait une autre transposition musicale de l’univers d’Erri de Luca que ce kitsch de bateleur télévisuel, où toute magie, toute respiration poétique sont exclues au profit de l’efficacité médiatique, en attendant que la vérité de l’onirisme ne reprenne ses droits une fois que l’orchestre et sa chanteuse se soient tus pour laisser place à la seule voix du poète.
Mais peut-être le kitsch est-il nécessaire à Erri De Luca pour faire entendre son message, lui qui nous accueille en expliquant que le texte est statique et qu’il n’atteint pas son public sans les sabots de la musique pour galoper vers lui ? Est-ce que je pêche par excès de snobisme culturel ? Que n’a-t-on pas exclu du champ culturel au nom d’une culture non excluante ! Et d’abord la musique, trop abstraite dès lors qu’elle n’est plus réduite aux formats de l’audimat. Mais ne me regarde-t-on pas avec ce même soupçon lorsque j’écris sur le disque “Voulouz Loar” de la chanteuse bretonne Annie Ebrel et du contrebassiste Riccardo Del Fra dont la réédition est annoncée, lorsque j’annonce sur ce blog le prochain concert dans cette même salle, le 26 février, des concerts de la Cité de la musique du spectacle que les frères Molard consacrent à la Ceol Mor, la grande musique de cornemuse écossaise, lorsque je chronique le concert de Maria Laura Baccarini et Régis Huby sur les chansons de Giorgio Gaber… ou lorsque j’évoque la lecture d’Erri de Luca ?
Puisque l’on parle de Maria Laura Baccarini, et puisque son programme sur Gaber, io e le Cose est à l’affiche du Théâtre 71 de Malakoff le 21 Mars… je m’autoriserai à citer le compte rendu que j’en faisais il y a deux ans au sortir du Carreau du Temple, car c’est à ce niveau d’exigence musicale que j’attendais l’exigeant poète-militant Erri De Luca :
« Il faut d’abord saluer l’intelligence et la sensibilité avec laquelle, dans un préambule en français de quelques minutes, elle a su nous donner les clés de ce spectacle tout en italien et nous présenter l’œuvre de Giorgio Gaber, chanteur et compositeur (associé au parolier Sandro Luporini), né en 1939, formé au jazz, passé au rock, fasciné par Jacques Brel, avec une dimension satirique plus directement ancrée dans le terreau socio-politique, qui sut “filmer” cette sensibilité des trente glorieuses issues de la Victoire de 1945 sur le fascisme, que l’on célèbre alors que j’écris ces lignes (même si son œuvre phonographique s’étend jusqu’à sa mort en 2003).
La lumière change, le spectacle commence, Maria Laura Baccarini change de peau, d’un simple battement de paupière prend la distance d’avec son public, quitte la convivialité de cette efficace présentation et devient une bête de scène que plus rien ne peut distraire de son texte, tantôt parlé, tantôt chanté, de ces morceaux d’humanité comiques, bouleversants, colériques, attendris, grotesques, inquiets… À l’arrière-plan, de coups d’archet en pizzicati, tenant le plus souvent son violon comme une mandoline dont il tire soudain des sonorités de guitare électrique, Régis Huby “allume un projecteur”, puis un autre, éteint le premier, fait descendre un voile de tulle imaginaire, redessine le fond de scène, envoie un peu de fumigène mental, réajustant constamment la profondeur de champ de la voix, metteur en scène plus encore qu’arrangeur, ce qu’il est finalement toujours plus ou moins dans chaque formation où il est impliqué, le tout avec ses seuls violons, mais aussi une multitude de pédales grâce auxquelles il pilote les différents strates de sa dramaturgie polyphonique.
Je rentrai dans ma banlieue habité, peut-être à contresens, par ce rêve d’humanité de l’après 1945 que, tandis que tout semblait se passer entre Londres, New York et Los Angeles, l’Italie sut incarner notamment par son cinéma, de son éclosion (De Sicca, Rosselini) à son zénith (Fellini, Pasolini) au terrifiant constat de son interminable déclin (Moretti), et me revenait à l’esprit le titre d’Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, alors que je croisais le cerisier de l’angle de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue de Colmar. Il n’était plus en fleurs, mais peignant ses branches dans l’obscurité, je constatais que le temps des cerises était encore loin. » •Franck Bergerot
|Voir et entendre l’écrivain, poète, militant, maçon et alpiniste Erri De Luca était une perspective aussi attirante que la présence à ses côtés du saxophoniste Di Battista suscitait ma perplexité. Ne sachant rien de la chanteuse Nicky Nicolai, j’ai tenté l’expérience.
Salle de concerts de la Cité de la musique, Paris (75), le 10 février 2017.
La musica insieme : Erri De Luca (récitant), Nicky Nicolai (chant), Stefano Di Battista (saxophones), Andrea Rea (piano), Daniele Sorrentino (contrebasse), Roberto Pistolesi (batterie).
On écoute parler et réciter Erri De Luca avec passion, comme on le lit. Dans un français lyrique et rocailleux, parole de conteur, de moraliste au sens noble du terme, un conteur de parabole, un fabuliste merveilleux, d’où suinte tout à la fois tendresse, rage de vivre, de dire, de clamer, humour, fantaisie, amour de la vie, de la nature, de l’humanité et de son histoire dont il a scruté en libre penseur agnostique les civilisations, les religions et les grands mythes de la Méditerranée qu’il nomme Mare Nostrum.
Puis soudain, on change de lieu, de temps, d’univers, pour sombrer dans une chanson de variété jazzy, un jazz de convention, bruyant, bavard, casant son petit solo entre deux refrains de radio-crochet, tantôt en italien sous-titré tantôt dans un français qu’il eût mieux valu sous-titrer. Au pays de – ratissons large – Giovanna Marini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Elena Ledda, Adriano Celentano, Gianmaria Testa, Lucilla Galleazi, Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Gabriele Mirabassi, Pino Minafra, Gianluigi Trovesi et Gianni Coscia, Paolo Fresu, Antonello Salis, Nino Rota, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti… – que sais-je ? –, on attendait une autre transposition musicale de l’univers d’Erri de Luca que ce kitsch de bateleur télévisuel, où toute magie, toute respiration poétique sont exclues au profit de l’efficacité médiatique, en attendant que la vérité de l’onirisme ne reprenne ses droits une fois que l’orchestre et sa chanteuse se soient tus pour laisser place à la seule voix du poète.
Mais peut-être le kitsch est-il nécessaire à Erri De Luca pour faire entendre son message, lui qui nous accueille en expliquant que le texte est statique et qu’il n’atteint pas son public sans les sabots de la musique pour galoper vers lui ? Est-ce que je pêche par excès de snobisme culturel ? Que n’a-t-on pas exclu du champ culturel au nom d’une culture non excluante ! Et d’abord la musique, trop abstraite dès lors qu’elle n’est plus réduite aux formats de l’audimat. Mais ne me regarde-t-on pas avec ce même soupçon lorsque j’écris sur le disque “Voulouz Loar” de la chanteuse bretonne Annie Ebrel et du contrebassiste Riccardo Del Fra dont la réédition est annoncée, lorsque j’annonce sur ce blog le prochain concert dans cette même salle, le 26 février, des concerts de la Cité de la musique du spectacle que les frères Molard consacrent à la Ceol Mor, la grande musique de cornemuse écossaise, lorsque je chronique le concert de Maria Laura Baccarini et Régis Huby sur les chansons de Giorgio Gaber… ou lorsque j’évoque la lecture d’Erri de Luca ?
Puisque l’on parle de Maria Laura Baccarini, et puisque son programme sur Gaber, io e le Cose est à l’affiche du Théâtre 71 de Malakoff le 21 Mars… je m’autoriserai à citer le compte rendu que j’en faisais il y a deux ans au sortir du Carreau du Temple, car c’est à ce niveau d’exigence musicale que j’attendais l’exigeant poète-militant Erri De Luca :
« Il faut d’abord saluer l’intelligence et la sensibilité avec laquelle, dans un préambule en français de quelques minutes, elle a su nous donner les clés de ce spectacle tout en italien et nous présenter l’œuvre de Giorgio Gaber, chanteur et compositeur (associé au parolier Sandro Luporini), né en 1939, formé au jazz, passé au rock, fasciné par Jacques Brel, avec une dimension satirique plus directement ancrée dans le terreau socio-politique, qui sut “filmer” cette sensibilité des trente glorieuses issues de la Victoire de 1945 sur le fascisme, que l’on célèbre alors que j’écris ces lignes (même si son œuvre phonographique s’étend jusqu’à sa mort en 2003).
La lumière change, le spectacle commence, Maria Laura Baccarini change de peau, d’un simple battement de paupière prend la distance d’avec son public, quitte la convivialité de cette efficace présentation et devient une bête de scène que plus rien ne peut distraire de son texte, tantôt parlé, tantôt chanté, de ces morceaux d’humanité comiques, bouleversants, colériques, attendris, grotesques, inquiets… À l’arrière-plan, de coups d’archet en pizzicati, tenant le plus souvent son violon comme une mandoline dont il tire soudain des sonorités de guitare électrique, Régis Huby “allume un projecteur”, puis un autre, éteint le premier, fait descendre un voile de tulle imaginaire, redessine le fond de scène, envoie un peu de fumigène mental, réajustant constamment la profondeur de champ de la voix, metteur en scène plus encore qu’arrangeur, ce qu’il est finalement toujours plus ou moins dans chaque formation où il est impliqué, le tout avec ses seuls violons, mais aussi une multitude de pédales grâce auxquelles il pilote les différents strates de sa dramaturgie polyphonique.
Je rentrai dans ma banlieue habité, peut-être à contresens, par ce rêve d’humanité de l’après 1945 que, tandis que tout semblait se passer entre Londres, New York et Los Angeles, l’Italie sut incarner notamment par son cinéma, de son éclosion (De Sicca, Rosselini) à son zénith (Fellini, Pasolini) au terrifiant constat de son interminable déclin (Moretti), et me revenait à l’esprit le titre d’Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, alors que je croisais le cerisier de l’angle de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue de Colmar. Il n’était plus en fleurs, mais peignant ses branches dans l’obscurité, je constatais que le temps des cerises était encore loin. » •Franck Bergerot
|Voir et entendre l’écrivain, poète, militant, maçon et alpiniste Erri De Luca était une perspective aussi attirante que la présence à ses côtés du saxophoniste Di Battista suscitait ma perplexité. Ne sachant rien de la chanteuse Nicky Nicolai, j’ai tenté l’expérience.
Salle de concerts de la Cité de la musique, Paris (75), le 10 février 2017.
La musica insieme : Erri De Luca (récitant), Nicky Nicolai (chant), Stefano Di Battista (saxophones), Andrea Rea (piano), Daniele Sorrentino (contrebasse), Roberto Pistolesi (batterie).
On écoute parler et réciter Erri De Luca avec passion, comme on le lit. Dans un français lyrique et rocailleux, parole de conteur, de moraliste au sens noble du terme, un conteur de parabole, un fabuliste merveilleux, d’où suinte tout à la fois tendresse, rage de vivre, de dire, de clamer, humour, fantaisie, amour de la vie, de la nature, de l’humanité et de son histoire dont il a scruté en libre penseur agnostique les civilisations, les religions et les grands mythes de la Méditerranée qu’il nomme Mare Nostrum.
Puis soudain, on change de lieu, de temps, d’univers, pour sombrer dans une chanson de variété jazzy, un jazz de convention, bruyant, bavard, casant son petit solo entre deux refrains de radio-crochet, tantôt en italien sous-titré tantôt dans un français qu’il eût mieux valu sous-titrer. Au pays de – ratissons large – Giovanna Marini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Elena Ledda, Adriano Celentano, Gianmaria Testa, Lucilla Galleazi, Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Gabriele Mirabassi, Pino Minafra, Gianluigi Trovesi et Gianni Coscia, Paolo Fresu, Antonello Salis, Nino Rota, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti… – que sais-je ? –, on attendait une autre transposition musicale de l’univers d’Erri de Luca que ce kitsch de bateleur télévisuel, où toute magie, toute respiration poétique sont exclues au profit de l’efficacité médiatique, en attendant que la vérité de l’onirisme ne reprenne ses droits une fois que l’orchestre et sa chanteuse se soient tus pour laisser place à la seule voix du poète.
Mais peut-être le kitsch est-il nécessaire à Erri De Luca pour faire entendre son message, lui qui nous accueille en expliquant que le texte est statique et qu’il n’atteint pas son public sans les sabots de la musique pour galoper vers lui ? Est-ce que je pêche par excès de snobisme culturel ? Que n’a-t-on pas exclu du champ culturel au nom d’une culture non excluante ! Et d’abord la musique, trop abstraite dès lors qu’elle n’est plus réduite aux formats de l’audimat. Mais ne me regarde-t-on pas avec ce même soupçon lorsque j’écris sur le disque “Voulouz Loar” de la chanteuse bretonne Annie Ebrel et du contrebassiste Riccardo Del Fra dont la réédition est annoncée, lorsque j’annonce sur ce blog le prochain concert dans cette même salle, le 26 février, des concerts de la Cité de la musique du spectacle que les frères Molard consacrent à la Ceol Mor, la grande musique de cornemuse écossaise, lorsque je chronique le concert de Maria Laura Baccarini et Régis Huby sur les chansons de Giorgio Gaber… ou lorsque j’évoque la lecture d’Erri de Luca ?
Puisque l’on parle de Maria Laura Baccarini, et puisque son programme sur Gaber, io e le Cose est à l’affiche du Théâtre 71 de Malakoff le 21 Mars… je m’autoriserai à citer le compte rendu que j’en faisais il y a deux ans au sortir du Carreau du Temple, car c’est à ce niveau d’exigence musicale que j’attendais l’exigeant poète-militant Erri De Luca :
« Il faut d’abord saluer l’intelligence et la sensibilité avec laquelle, dans un préambule en français de quelques minutes, elle a su nous donner les clés de ce spectacle tout en italien et nous présenter l’œuvre de Giorgio Gaber, chanteur et compositeur (associé au parolier Sandro Luporini), né en 1939, formé au jazz, passé au rock, fasciné par Jacques Brel, avec une dimension satirique plus directement ancrée dans le terreau socio-politique, qui sut “filmer” cette sensibilité des trente glorieuses issues de la Victoire de 1945 sur le fascisme, que l’on célèbre alors que j’écris ces lignes (même si son œuvre phonographique s’étend jusqu’à sa mort en 2003).
La lumière change, le spectacle commence, Maria Laura Baccarini change de peau, d’un simple battement de paupière prend la distance d’avec son public, quitte la convivialité de cette efficace présentation et devient une bête de scène que plus rien ne peut distraire de son texte, tantôt parlé, tantôt chanté, de ces morceaux d’humanité comiques, bouleversants, colériques, attendris, grotesques, inquiets… À l’arrière-plan, de coups d’archet en pizzicati, tenant le plus souvent son violon comme une mandoline dont il tire soudain des sonorités de guitare électrique, Régis Huby “allume un projecteur”, puis un autre, éteint le premier, fait descendre un voile de tulle imaginaire, redessine le fond de scène, envoie un peu de fumigène mental, réajustant constamment la profondeur de champ de la voix, metteur en scène plus encore qu’arrangeur, ce qu’il est finalement toujours plus ou moins dans chaque formation où il est impliqué, le tout avec ses seuls violons, mais aussi une multitude de pédales grâce auxquelles il pilote les différents strates de sa dramaturgie polyphonique.
Je rentrai dans ma banlieue habité, peut-être à contresens, par ce rêve d’humanité de l’après 1945 que, tandis que tout semblait se passer entre Londres, New York et Los Angeles, l’Italie sut incarner notamment par son cinéma, de son éclosion (De Sicca, Rosselini) à son zénith (Fellini, Pasolini) au terrifiant constat de son interminable déclin (Moretti), et me revenait à l’esprit le titre d’Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, alors que je croisais le cerisier de l’angle de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue de Colmar. Il n’était plus en fleurs, mais peignant ses branches dans l’obscurité, je constatais que le temps des cerises était encore loin. » •Franck Bergerot
|Voir et entendre l’écrivain, poète, militant, maçon et alpiniste Erri De Luca était une perspective aussi attirante que la présence à ses côtés du saxophoniste Di Battista suscitait ma perplexité. Ne sachant rien de la chanteuse Nicky Nicolai, j’ai tenté l’expérience.
Salle de concerts de la Cité de la musique, Paris (75), le 10 février 2017.
La musica insieme : Erri De Luca (récitant), Nicky Nicolai (chant), Stefano Di Battista (saxophones), Andrea Rea (piano), Daniele Sorrentino (contrebasse), Roberto Pistolesi (batterie).
On écoute parler et réciter Erri De Luca avec passion, comme on le lit. Dans un français lyrique et rocailleux, parole de conteur, de moraliste au sens noble du terme, un conteur de parabole, un fabuliste merveilleux, d’où suinte tout à la fois tendresse, rage de vivre, de dire, de clamer, humour, fantaisie, amour de la vie, de la nature, de l’humanité et de son histoire dont il a scruté en libre penseur agnostique les civilisations, les religions et les grands mythes de la Méditerranée qu’il nomme Mare Nostrum.
Puis soudain, on change de lieu, de temps, d’univers, pour sombrer dans une chanson de variété jazzy, un jazz de convention, bruyant, bavard, casant son petit solo entre deux refrains de radio-crochet, tantôt en italien sous-titré tantôt dans un français qu’il eût mieux valu sous-titrer. Au pays de – ratissons large – Giovanna Marini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Elena Ledda, Adriano Celentano, Gianmaria Testa, Lucilla Galleazi, Daniele Sepe, Riccardo Tesi, Gabriele Mirabassi, Pino Minafra, Gianluigi Trovesi et Gianni Coscia, Paolo Fresu, Antonello Salis, Nino Rota, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti… – que sais-je ? –, on attendait une autre transposition musicale de l’univers d’Erri de Luca que ce kitsch de bateleur télévisuel, où toute magie, toute respiration poétique sont exclues au profit de l’efficacité médiatique, en attendant que la vérité de l’onirisme ne reprenne ses droits une fois que l’orchestre et sa chanteuse se soient tus pour laisser place à la seule voix du poète.
Mais peut-être le kitsch est-il nécessaire à Erri De Luca pour faire entendre son message, lui qui nous accueille en expliquant que le texte est statique et qu’il n’atteint pas son public sans les sabots de la musique pour galoper vers lui ? Est-ce que je pêche par excès de snobisme culturel ? Que n’a-t-on pas exclu du champ culturel au nom d’une culture non excluante ! Et d’abord la musique, trop abstraite dès lors qu’elle n’est plus réduite aux formats de l’audimat. Mais ne me regarde-t-on pas avec ce même soupçon lorsque j’écris sur le disque “Voulouz Loar” de la chanteuse bretonne Annie Ebrel et du contrebassiste Riccardo Del Fra dont la réédition est annoncée, lorsque j’annonce sur ce blog le prochain concert dans cette même salle, le 26 février, des concerts de la Cité de la musique du spectacle que les frères Molard consacrent à la Ceol Mor, la grande musique de cornemuse écossaise, lorsque je chronique le concert de Maria Laura Baccarini et Régis Huby sur les chansons de Giorgio Gaber… ou lorsque j’évoque la lecture d’Erri de Luca ?
Puisque l’on parle de Maria Laura Baccarini, et puisque son programme sur Gaber, io e le Cose est à l’affiche du Théâtre 71 de Malakoff le 21 Mars… je m’autoriserai à citer le compte rendu que j’en faisais il y a deux ans au sortir du Carreau du Temple, car c’est à ce niveau d’exigence musicale que j’attendais l’exigeant poète-militant Erri De Luca :
« Il faut d’abord saluer l’intelligence et la sensibilité avec laquelle, dans un préambule en français de quelques minutes, elle a su nous donner les clés de ce spectacle tout en italien et nous présenter l’œuvre de Giorgio Gaber, chanteur et compositeur (associé au parolier Sandro Luporini), né en 1939, formé au jazz, passé au rock, fasciné par Jacques Brel, avec une dimension satirique plus directement ancrée dans le terreau socio-politique, qui sut “filmer” cette sensibilité des trente glorieuses issues de la Victoire de 1945 sur le fascisme, que l’on célèbre alors que j’écris ces lignes (même si son œuvre phonographique s’étend jusqu’à sa mort en 2003).
La lumière change, le spectacle commence, Maria Laura Baccarini change de peau, d’un simple battement de paupière prend la distance d’avec son public, quitte la convivialité de cette efficace présentation et devient une bête de scène que plus rien ne peut distraire de son texte, tantôt parlé, tantôt chanté, de ces morceaux d’humanité comiques, bouleversants, colériques, attendris, grotesques, inquiets… À l’arrière-plan, de coups d’archet en pizzicati, tenant le plus souvent son violon comme une mandoline dont il tire soudain des sonorités de guitare électrique, Régis Huby “allume un projecteur”, puis un autre, éteint le premier, fait descendre un voile de tulle imaginaire, redessine le fond de scène, envoie un peu de fumigène mental, réajustant constamment la profondeur de champ de la voix, metteur en scène plus encore qu’arrangeur, ce qu’il est finalement toujours plus ou moins dans chaque formation où il est impliqué, le tout avec ses seuls violons, mais aussi une multitude de pédales grâce auxquelles il pilote les différents strates de sa dramaturgie polyphonique.
Je rentrai dans ma banlieue habité, peut-être à contresens, par ce rêve d’humanité de l’après 1945 que, tandis que tout semblait se passer entre Londres, New York et Los Angeles, l’Italie sut incarner notamment par son cinéma, de son éclosion (De Sicca, Rosselini) à son zénith (Fellini, Pasolini) au terrifiant constat de son interminable déclin (Moretti), et me revenait à l’esprit le titre d’Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, alors que je croisais le cerisier de l’angle de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue de Colmar. Il n’était plus en fleurs, mais peignant ses branches dans l’obscurité, je constatais que le temps des cerises était encore loin. » •Franck Bergerot