Christian Béthune jazzistique, Georges Burrows dans les nuages et Jacques Réda en cavalerie

Trois livres dont le titre ci-dessus ne vous dit rien, sinon peut-être les noms de leurs auteurs, auxquels on pourrait accoler ceux de Théodore Adorno pour Béthune, d’Andy Kirk (et ses Clouds of Joy) pour Burrows, et “Le Vers français” pour Réda qui considère son objet comme une personne physique. Trois livres lus dans la foulée… selon une chronologie qui aurait presque du sens.
Christian Béthune, L’Apothéose des vaincus (Philosophie et champ jazzistique)
Presses Universitaires du Midi (collection Jazz-U), 214 pages

L’Apothéose des vaincus : le titre est assez beau et Christian Béthune a le sens de la formule. Dans celle-ci, il faut comprendre un retournement entre l’aristocratie intellectuelle et artistique du monde occidental et ceux grâce au labeur desquels ces élites eurent tout loisir d’inventer et de produire “l’Œuvre d’art” indépendamment de toute valeur usuelle, laissant le soin aux “vaincus” de produire l’usuel et la richesse économique. L’avènement du jazz au sein de populations africaines déportées en esclavage, victimes exemplaires de l’Oppression, constituant ce retournement, avec une musique qui échapperait à la définition d’“œuvre d’art”. Et une bonne partie du livre consistera à revenir sur cette distinction entre le jazz et l’“Œuvre d’art”. Les notions d’œuvre, d’art et d’auteur étant ainsi considérées, et comme cadenassées, du point de vue strictement occidental qui, il est vrai, en a forgé les concepts depuis la Grèce antique.
Philosophie et champ jazzistique, le sous-titre, moins élégant, en dit long. On ne dit pas “jazz”, mais comme le ferait le docteur Diafoirus du Malade imaginaire de Molière transposé sur le terrain de la critique musicale, on dit “champ jazzistique” pour désigner ce vaste champ de réalités musicales que, du service marketing des multinationales phonographiques à la foule qui se presse à l’entrée de Jazz à Vienne ou Jazz à La Villette, on appelle “jazz” et qui n’en est plus vraiment. Alourdir l’occurrence du mot “jazz” d’un “champ” et d’un “jazzistique” nous avance-t-il à comprendre l’“ontologie” actuelle du jazz ? Voici en tout cas ce dernier affublé d’une toge et d’un grand chapeau pointu dont il n’a guère besoin en ces temps de grand désintérêt.
Certes, tout comme l’homme de loi, le chirurgien, l’informaticien, le physicien ou le mathématicien en leurs domaines, le philosophe se doit de disposer d’un vocabulaire précis, spécifique à sa discipline, balayant ici, de la Grèce antique aux néologismes des différentes écoles de la pensée contemporaine, tout un lexique qui échappe au commun des mortels, au risque de se placer sur le plan des “vainqueurs” pour en démonter les logiques. On s’est toutefois plongé entre patience et passion dans ces ingénieuses et admirables mécanismes à penser, actionnés d’une plume élégante, quoiqu’il nous soit arrivé parfois de perdre l’une et l’autre (la patience et la passion) lorsqu’il nous fallait relire six fois un même paragraphe sans parvenir à nous souvenir d’où nous étions partis, ou à simplement comprendre ce que nous venions de lire, portant alors l’œil sur la montre et la pile de livres dont la lecture, pendant ce temps, nous attendait en trépignant (car il arrive aux piles de livres en attente de trépigner jusqu’à s’effondrer en signe de protestation).
Quelle idée aussi de lire de la philosophie lorsque l’on n’a pas la tête formée à ça ! Toutefois, certaine idées (notamment cette réflexion sur la négritude qu’inspire à l’auteur la bévue de Roquentin prenant Sophie Tucker pour une chanteuse “nègre” dans La Nausée de Sartre), certains passages, voire chapitres entiers (Communauté mimétique et écoute pathique, l’un des moments forts de notre lecture) ont pu nous captiver mais, a posteriori, refeuilletant l’ouvrage abondamment annoté au crayon de bois, nous ne saurions plus dire lesquels, ou plus précisément ne saurions en reconstituer l’enchainement et les conclusions que nous pourrions en tirer, nous souvenant simplement que, bien souvent, parvenus au bout d’un long développement, qu’il nous soit paru obscur ou lumineux, nous en partagions le point de vue (pour ne pas dire les évidences), en nous disant : « Tout ça pour ça ?! »
C’est aussi que notre philosophe a tendance à parler “hors sol”, se référant plus souvent à la lecture de Theodor Adorno (pour nous dire qu’il avait tort, tout du moins sur le sujet du jazz, ce que l’on savait déjà peu ou prou) ou Walter Benjamin, plutôt qu’à Louis Armstrong ou John Coltrane. D’une part le destin du jazz est envisagé dans une apparente méconnaissance des autres traditions musicales populaires et / ou extra-européennes, comme si le jazz était le seul champ musical échappant au domaine savant-européen, et doté de qualités exclusives pourtant partagées avec bien d’autres dont il mériterait pourtant d’être distingué par une connaissance plus transversale. C’est ainsi même que Béthune voit dans les conditions du travail forcé l’origine de l’omniprésence de la danse dans le “champ jazzistique”, idée séduisante si elle ne concernait l’une des caractéristiques africaines qui a le mieux résisté à la déportation.
D’autre part, le jazz est envisagé d’assez loin et souvent, une fois revenu sur terre – avec une relative approximation en regard de la méticulosité avec laquelle l’auteur soigne son vocabulaire et décortique la pensée d’Adorno ou Benjamin –, colportant par ailleurs, avec une désinvolture soudaine, les légendes sans les relativiser (Freddie Keppard qui aurait refusé de se laisser enregistrer par peur d’être copié alors que l’on sait que la réalité fut plus prosaïque), parlant de “hat hut” (qu’il prend heureusement le soin de rappeler en note de bas de page qu’on l’appelle “aussi” hi-hat), caractérisant le fox trot par sa forme en douze mesures ou balayant d’un revers de main en dernière page, l’œuvre de Paul Whiteman qui mériterait pourtant au moins autant d’attention que celle d’Adorno rapportée au jazz.
Deux brefs chapitres plus terre-à-terre lui valent quelques jolis passages. Quelques lignes dans le bref chapitre Billie Holiday est un oxymoron… Quelques autres dans Trio Blues ou le jeu désœuvré qui voit l’auteur se pencher sur le Trio Blues de Count Basie du 14 juillet 1977 à Montreux … Hélas, il semble affecté d’un regrettable malentendu lorsqu’il constate l’absence de la forme canonique du blues “AAB” (titrant même ce passage La Forme introuvable), alors que, à part une démarcation hésitante entre l’introduction et un premier chorus, le morceau repose sur un très classique et lisible cycle de douze mesures répété neuf fois. Il est vrai que rechercher la forme poétique AAB du blues dans un blues instrumental (confusion que colportent de livre en livre de nombreux auteurs) peut être trompeur. Mais dès lors que l’on s’est souvenu que la forme harmonique du blues est un ABC, à la rigueur un AA’B lorsque l’on s’en tient au thème, et plus précisément un AA BA’CA” (voire, si l’on veut tenir compte des réminiscences de la structure originelle dialoguée voix-guitare, AB CB’ DB”, dont on trouve ici d’infimes traces dans le dialogue entre piano et contrebasse), la reconnaissance de cette forme canonique paraît plus aisée à une oreille peu exercée comme la nôtre et, visiblement, celle de notre auteur.
Et si ce dernier avait relevé les figures de boogie et de stride, examiné comme elles surgissent, ou tout simplement prêté attention à la présence dialoguée, au côté de Basie, de Ray Brown qu’il signale en passant, sans le nommer, s’il avait cherché à imaginer la façon dont avait été choisi le terrain du blues (Concertation ? Accord tacite ? Décision unilatérale de Basie qui impose la couleur du blues avant même que d’en annoncer la forme ?), s’il avait remarqué les hésitations initiales du morceau, avant que les deux hommes ne se mettent d’accord sur ce que sera le premier temps de leur cycle de douze mesures, s’il avait décrit cet “entendu” (au sens de consensus) par lequel les deux hommes acheminent le dernier chorus vers son évidente conclusion, s’il s’était interrogé sur une possible déférence du cadet pour son aîné et sur la façon dont il s’autorise – ou est autorisé – ici et là à passer au premier plan, s’il s’était rappelé cette différence générationnelle en termes stylistiques (et peut-être y aurait-il eu encore à dire sur l’extrême discrétion du batteur Jimmie Smith), Béthune aurait pu sans doute en déduire une foule d’arguments pour ses réflexions sur le “mimétique”, la “ritournelle” et l’impromtu, et ré-ancrer son ouvrage à la réalité. Encore que réduire l’observation du jazz in situ à ce seul blues impromptu dans un tel ouvrage dont la bibliographique comporte plus de deux-cent références d’Aristote à Stefan Zweig, nous paraît quelque peu désinvolte, comme s’il y avait là quelque revanche des Vainqueurs sur l’apothéose des Vaincus.
Enfin, si elle ne manque pas de questionnements opportuns, voire d’affirmations pertinentes sur le “champ musical noir-américain” (encore que, même dans ses généralités sur le “rap”, l’auteur donne l’impression d’en avoir un aperçu assez exigu lorsqu’il s’aventure du côté de ses formes les plus “commerciales” ou plus simplement “populaires”), cette observation vue du ciel ne nous est pas de grand secours pour considérer et comprendre ce fameux “champ jazzistique” dans son développement chronologique jusqu’à nos jours, sa conquête du monde, son appropriation d’éléments purement européens ou extra-européens et extra-africains, et l’on ne saurait se contenter des quelques remarques, si pertinentes fussent-elles, sur l’universalisme du jazz, sur “l’allégeance ontologique” qui relie à lui de nombreuses expressions musicales contemporaines ou historiques (allégeance dont il faudrait considérer d’ailleurs les circulations à double sens). Quant à ces franges esthétiques de plus en plus nombreuses qui privilégient l’improvisation et l’inédit sur l’idiome préexistant, Béthune semble même vouloir les exclure du champ jazzistique d’un revers de main (laissant la parole à Jean Slamowicz, caporal en chef de la Brigade du Swing, dans la ligne de Wynton Marsalis dont on sait qu’il apporta son soutien à un spectateur qui fit intervenir la police pour interrompre un concert du Rova Saxophone Quartet au prétexte qu’il ne jouait pas du jazz). C’est alors que le “champ jazzistique” inventé comme pour désamorcer les excommunications d’Hugues Panassié et ses descendants, semble soudain se refermer et se cadenasser à son tour, sans que l’on soit bien sûr que l’auteur ait une conscience très informée de ce qui s’est joué sous le nom de “jazz” depuis un bon demi siècle.
Signalons au passage, dans la collection où paraît cet ouvrage, dirigée par Ludovic Florin et Jean-Miche Court, l’ouvrage signé par ceux-ci Rencontres du jazz et de la musique contemporaine et Pixighinha ou la singularité d’une écoute de Virginie de Almeida Bessa.
The Recordings of Andy Kirk and his Clouds of Joy
Par George Burrows
Oxford University Press, Oxford Studies in Recorded Jazz, 254 pages
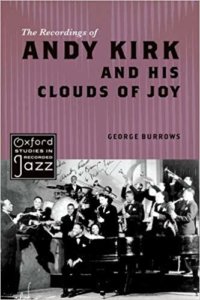
Pourquoi chroniquer sur une même page le livre de Christian Béthune et celui de George Burrows ? Parce que tous deux, (chacun à sa manière) se livrent à une ontologie du jazz, mais Béthune selon ce regard hors sol, vu d’avion, que nous remarquions ci-dessus, Burrows avec une vision microscopique, l’objectif collé à une minuscule parcelle de terrain : les enregistrements d’Andy Kirk “et ses nuages de joie”. Un regard au ras des pâquerettes pourraient ironiser ses détracteurs. Nous aurions pu être de ceux-ci, mais les informations résultant de ses observations et rapportées dans une prose (anglophone) sans élégance particulière, ne nous en ont pas laissé le loisir.
Rappelons, l’existence de la collection Oxford Studies In Recorded jazz, où l’on peut lire les très précises analyses de Louis Armstrong’s Hot Five and Hot Seven Recordings de Brian Harker, The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-1968 de Keith Waters, Benny Goodman’s Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert de Catherine Tackley, Keith Jarrett’s The Köln Concert de Peter Elsdon, Thelonious Monk Quartet Featuring John Coltrane at Carnegie Hall de Gabriel Solis et Pat Metheny : The ECM Years, 1975-1984 de Mervyn Cooke.
Certes, le ton de George Burrows est rébarbatif, évoquant ces mémoires de maîtrise où le candidat se doit de marteler les différents points de sa méthode, en tête d’ouvrage, en tête de chapitre, ses conclusions étant elles-mêmes martelées en fin de chapitre de telle sorte, que l’on se demande s’il n’en a pas forcé quelque peu les arguments pour coller à l’objet de sa thèse. Laquelle, dans le cas de Burrows, en réaction à la façon dont la critique – Gunther Schuller en tête – a dénigré les enregistrements des Clouds of Joy pour leurs tendances commerciales, s’attache à démonter la façon dont les musiciens de jazz ont dû louvoyer avec une industrie phonographique, une critique spécialisée et une communauté des jazzfans avide d’authenticité “nègre”, en déjouant – et en jouant – avec les masques de la négritude.
Pour ce faire, Dr. George Burrows, qui n’est pas en fait le premier étudiant venu – Maître de conférence à l’Université de Portsmouth, spécialiste des arts de la scène entre les deux guerres, co-fondateur de The Song and Screen International Conference en 2006 et des Studies in Musical Theatre en 2007 –, s’est immergé dans l’œuvre d’Andy Kirk et de son orchestre dont il livre en annexe une discographie détaillée de 1929 à 1949, quelques relevés d’extraits d’arrangement parsemant le texte. Dès l’exposé initial de son sujet, nous est revenu en mémoire cette amertume rencontrée dans les propos de nombreux musiciens afro-américains d’avoir dû “faire le nègre” lorsqu’ils voulaient juste jouer leur musique, laquelle n’était pas nécessairement le jazz. Nina Simone en est l’emblème ; mais on la retrouve chez Fats Waller dont on peut soupçonner qu’il ait forcé sur la bouteille afin de surmonter cette blessure ; chez cet autre blessé de l’existence, Bud Powell, qui aspira – et c’était l’espoir de ses parents – à une carrière classique ; ou chez Harry Pace qui, en 1920, créa le premier label phonographique noir, Black Swan (d’après le surnom de la cantatrice noire Elizabeth Taylor Greenfield) pour faire enregistrer les compositeurs symphonistes afro-américains, notamment William Grant Still, par le Black Swan Symphony Orchestra, frisant la réalisation du rêve de Jim Europe d’un “national negro symphony orchestra”. Mais cette partie du catalogue fut rapidement débordée par le succès des fox-trots et one-steps du Black Swan Dance Orchestra et surtout la nécessité de répliquer à la vogue des chanteuses de blues lancée par Mamie Smith, en enregistrant Ethel Waters qui enseignera les bases du genre à Fletcher Henderson auquel ses camarades de l’Atlanta University avait promis une carrière à la Rachmaninov. D’où cette amertume chez Fletcher Henderson et ses musiciens de n’être pas autorisé à enregistrer en studio la musique de salon (valses, marches et tangos) sur lesquels ils faisaient danser le public blanc du Roseland Ball Room et ce fragile slogan publicitaire annonçant les débuts du Fletcher Henderson Orchestra : « un orchestre de musiciens des nuits de Broadway, pratiquant une étrange et sauvage mixture de jazz et de douce symphonie. »
Ce sont les oscillations de cette délicate balance transposée dans le middle west que met au jour George Burrrows en explorant la genèse de l’orchestre d’Andy Kirk sous la direction initiale de Terence Holder auprès du public des ballrooms blancs, et en évoquant la fierté conçue par ses musiciens de pratiquer un répertoire de “white society band”. D’où leur désappointement lorsque certains de leurs employeurs, pour éviter toute ambiguïté auprès de leur clientèle, les annoncèrent sous le nom des “Black Clouds of Joy”. Nom que conserva Andy Kirk lorsque, Holder parti avec la caisse, il se vit confier la direction de l’orchestre, mais en supprimant le mot “black”. Les Clouds of Joy n’en furent pas moins repérés par Brunswick pour enregistrer dans la tranche 7000 de son catalogue réservé aux “race records”. Dès lors, aux yeux du label management, leur répertoire parut “trop blanc”.
« Notre orchestre n’insistait pas sur le jazz, bien que nous en jouions. On mettait l’accent sur la musique de danse – ballades romantiques, airs populaires et valses viennoises ou valses populaires standards comme Kiss Me Again et Alice Blue Gown. J’aime jouer les valses. […] Notre popularité grandissant nous jouions dans deux salles de danses réservées aux Blancs [à Kansas City], le Pla-Mor et l’El Torreon. Nous étions célèbres auprès de ces publics blancs. En fait, nous étions souvent considérés comme un orchestre blanc, à cause de notre style doux et l’importance de nos ballades et de nos valses dans le répertoire. » Mais lorsque les Clouds of Joy sont enfin invités à enregistrer en novembre 1929, le ton change : « Souvenez vous, Bennie Moten était LE band sur Okeh [principal concurrent de Vocalion/Brunswick] Ce qu’il faisait était ce que Brunswick et Vocalion attendait de nous. » Et c’est là qu’entre en scène la jeune pianiste, compositrice et arrangeuse Mary Lou Williams dont la puissance de travail et l’application à assimiler ce qu’elle entend autour d’elle permet à l’orchestre de faire le pas demandé par ses producteurs vers le “jazz hot”. D’où le caractère symbolique que prendra avec le recul ce titre qu’elle signe et que l’orchestre enregistre le 30 avril 1930, Mary’s Idea.
George Burrows décrit très précisément l’évolution de l’orchestre en constante balance entre ces deux identités, sweet et hot, selon des lignes de partage d’autant plus mouvantes et floues que l’on ne tarde pas à passer du hot au swing qui triomphe bientôt devant le public blanc (le public-même de Kirk), et que la modernité du jazz entre en tension avec les sensibilités populaires de la communauté noire. Où l’on voit notamment, en 1936, Andy Kirk accepter d’enregistrer Christopher Columbus à condition de pouvoir graver une ballade (Until the Real Things Comes Along) dont Jack Capp, le producteur de chez Decca, rejettera une première version au profit d’une seconde plus à son goût. Un parcours qui permet à l’auteur d’intéressantes observations sur les rapports du swing à la danse (et l’étroitesse de l’interaction entre musiciens et danseurs), la sexualisation des chanteuses noires, l’avènement des crooners noirs condamnés par la jazz critic dans un amalgame qui fait fi de la signification et de l’authenticité du falsetto tel qu’il perdure des minstrels aux chanteurs soul, la façon enfin dont Gunther Schuller survalorise les solos improvisés, notamment avec l’arrivée des boppers Howard McGhee et Fats Navarro… C’est là que l’on soupçonne l’auteur de forcer le trait dans sa dénonciation de l’industrie phonographique et la critique spécialisée, que l’orchestre noircisse ou blanchisse son style, au risque de nous détourner des légendaires faces avec McGhee et Navarro au profit refrains sucrés de Terrell Pha… Et nous voici pris au piège du racisme et de ses masques.
Mais, il faut bien l’avouer, le jeu de masque et de miroir est tel, qu’il nous fait perdre parfois la raison. D’autant plus qu’il est quelque peu vain de lire cet ouvrage sans avoir les enregistrements à portée de main. Ils sont tous disponibles sur les plateformes de streaming, à condition de privilégier la série de Gilles Pétard “In Chronology” (équivalent en ligne de la collection “Chronological” autrefois parue en CD sous label Classics) en ce qu’il est le seul à préciser la date d’enregistrement de chaque face 78-tours. Mais il reste encore à mettre la main sur les rares enregistrements publics des Clouds analysés et/ou signalés par Burrows (émissions de l’hiver 1937 au Trianon Ballroomm de Cleveland, les captations de 1940 au Cotton Club, et les transcriptions au profit des forces armées de 1943-1944), pour les comparer aux enregistrements studio “sous influence”.
Quel avenir pour la cavalerie ? (Une histoire naturelle du vers français)
Par Jacques Réda
Buchet Chastel, 215 pages.

Et que vient faire ici Jacques Réda et sa cavalerie (et son vers français), si ce n’est que nous avons acquis son livre au moment où nous étions le nez dans les ouvrages de Béthune et Burrows. Rappelons à ceux qui l’aurait oublié ou aux nouveaux venus dans nos pages que cet écrivain, qui ne dédaigne par le vers, fut aussi l’une des plus très grandes plumes de Jazz Magazine et l’auteur, à coté d’une œuvre purement littéraire, d’un certain nombre d’ouvrages qui l’étaient guère moins quoique consacrés au jazz. Ce dernier livre et sa réflexion sur l’art de la versification renvoie d’ailleurs constamment à celle que, publication après publication, il a mené sur le rythme et les particularités du swing et de la syncope, jusqu’à Battement (Fata Morgana, 2009) et Une civilisation du Rythme (Buchet Chastel, 2017).
Si, comme Béthune, Réda fait preuve de panache avec son titre “Quel avenir pour la Cavalerie ?”, son sous-titre laisse deviner que, s’il a le sens de l’humour et l’esprit métaphorique malin, son exploration du vers français ne se fait pas hors sol. Il explore l’Histoire de la poésie française comme un vieux sanglier solitaire, le groin au ras du vieil humus qu’elle a laissé sur son passage. Histoire de la poésie ? Ce serait mal lire ce sous-titre. Ni Histoire des poètes, ni Histoire de la poésie… mais Histoire du Vers français, auquel il nous faut nous autoriser à ajouter une lettre capitale à l’initiale du mot “Vers”, tant il est vrai que c’est bien le Vers qui est moins l’objet que le sujet de cette “histoire naturelle”. Le Vers qui n’appartient qu’à lui-même, que Réda tend parfois même à affranchir de toute appartenance à quelque auteur. Et quoiqu’il s’attarde plus particulièrement sur certains cénacles, voire sur certaines individualités (recommandons notamment ce qu’il dit de Paul Claudel, le méconnu et mal aimé de nos générations, pour beaucoup de mauvaises raisons), abordant le XIXe siècle, passé l’âge du rang serré de l’Alexandrin et pressentant la débandade de “La Cavalerie”, Réda précise : « Dans la limite de mon projet, les noms sont secondaires. C’est le vers qui m’intéresse, dans la mesure où il a été l’élément de base d’un seul poème dont l’auteur est la langue française qui, dès ce XIXe siècle, a commencé à y perdre un peu son latin. » Evidemment, là où nous signalions un groin au ras du sol, la pensée des sociologues dénoncera à son tour une observation hors sol. Nous éviterons d’entrer dans ce débat et en resterons à la notion, certes un peu bourgeoise, de plaisir.
Et oui, Jacques Réda renifle le vers avec gourmandise, s’y bauge et s’y délecte. Comme je me suis… – tombons le faux-nez de la première personne du pluriel que m’imposait jusqu’ici l’intimidante posture universitaire – … comme je me suis moi-même toujours délecté de sa prose, qu’il décrive le tambourinage des gouttes de pluie sur son casque de moto en pédalant contre le patinage du galet sur la roue de son vélosolex ou qu’il compare le phrasé du saxophoniste Benny Carter à l’art du patinage. Et, quoique n’ayant guère de talent pour l’abstraction et n’y comprenant parfois guère plus qu’à la lecture de certaines pages de Béthune, étant le parfait représentant d’une génération contemporaine « d’un français aujourd’hui affaibli dans la faculté de finesse et d’exactitude qui avait fait à bon droit sa réputation », je me souviens de pages de Réda faisant appel à la Physique et à la théorie de cordes dont la lecture m’avait procuré un plaisir inouï alors même que je n’en entravais que dale, au point d’avoir suggéré dans un article que leur auteur n’y comprenait lui-même pas grand chose… ce qui sous ma plume était une sorte de compliment adressé à la musicalité de son écriture et à sa puissance de ses métaphores en dépit ou en vertu de leur gratutité. Il n’avait pas du tout apprécié d’être ainsi considéré et me l’avait fait vertement savoir.
Alors précisons ici que, dans cet ouvrage, la gourmandise et le plaisir ne sont pas seuls à l’œuvre. C’est qu’il s’y connaît le Réda. Le vers français et ses ancêtres latins et grecs, il y est chez lui, jusqu’à ceux de ses contemporains. Et si, moi, je n’y connais pas grand chose, m’étant toujours tenu à distance de cette écriture millimétrée que constitue la versification, par son intimité avec cet art et leurs auteurs, par l’appétit qu’il en a en fin gourmet, ce goût qu’il a d’en détailler les plaisirs, cette imagination mise en œuvre pour nous faire partager son érudition et l’acuité de son regard en jouant de la métaphore avec une exquise élégance, un humour toujours pertinent quoique volontiers truculent, il aura forcé mes réticences et j’aurai refermé ce livre en me promettant de le rouvrir souvent, désormais avec quelques bons recueils de poésie à portée de main. Franck Bergerot