L’intranquille félicité de Régis Huby
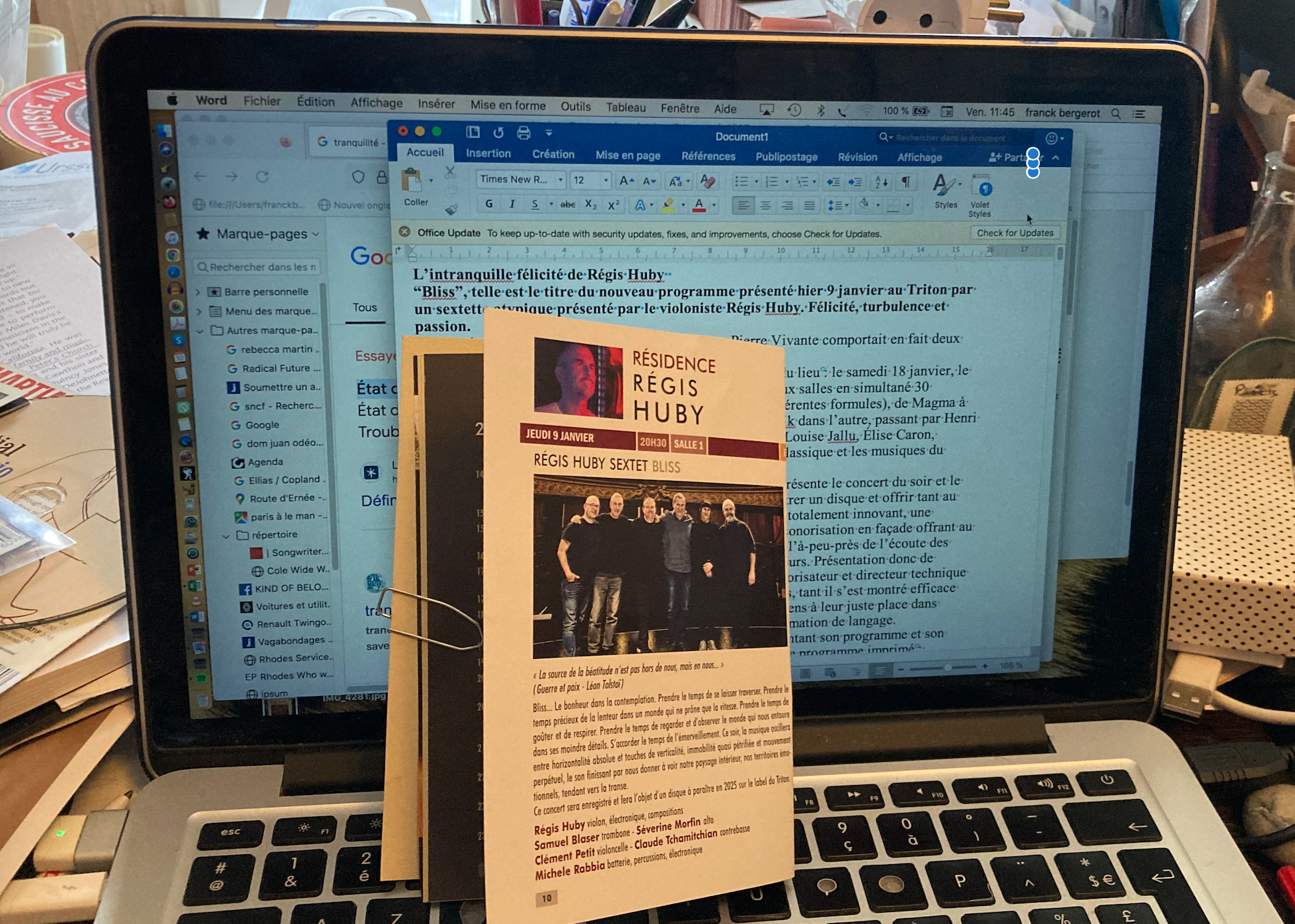
“Bliss”, telle est le titre du nouveau programme présenté hier 9 janvier au Triton par le violoniste Régis Huby à la tête d’un sextette atypique. Félicité, turbulence et passion.
Deux préambules, voire trois. Le premier de Jean-Pierre Vivante comportait en fait deux volets.
Premier préambule – premier volet, le 25e anniversaire du lieu : le samedi 18 janvier, le Triton sera en fête de 14h à minuit, accueillant dans ses deux salles en simultané 30 programmes (certains réunissant en une même séquence différentes formules), de Magma à Band of Dogs dans l’une, de Mathias Lévy à Nima Sarkechik dans l’autre, passant par Henri Texier, John Greaves, Médéric Collignon, Jimi Drouillard, Louise Jallu, Élise Caron, Kamilya Jubran… Pas que jazz, débordant vers le rock, le classique et les musiques du monde.
Premier préambule – Deuxième volet : le patron du lieu présente le concert du soir et le dispositif tout particulier mis en œuvre pour filmer, enregistrer un disque et offrir une sonorisation en immersion, tant au public en salle qu’aux artistes sur scène, selon un dispositif totalement innovant. Soit, non plus ce pis-aller de la sonorisation en façade offrant au public une écoute « à plat » rarement satisfaisante, non plus l’à-peu-près de l’écoute des musiciens entre eux par l’intermédiaire d’approximatifs retours. Présentation donc de l’efficacité de ce nouveau dispositif mis en œuvre par le sonorisateur et directeur technique du lieu, Jacques Vivante. Et sur ce point, je ne reviendrai pas, tant il s’est montré efficace jusqu’à se faire oublier au profit de la musique et des musiciens à leur juste place dans l’image sonore… si l’on peut encore recourir à cette approximation de langage.
Deuxième préambule : celui de l’artiste, Régis Huby, présentant son programme et son titre, “Bliss”, ce qui signifie “félicité” ? Ou, pour reprendre le programme imprimé : « prendre le temps précieux de la lenteur dans un monde qui prône la vitesse. […] Le temps de l’émerveillement. Ce soir, la musique oscillera entre horizontalité absolue et touches de verticalité, immobilité quasi pétrifiée et mouvement perpétuel, le son finissant par nous donner à voir notre paysage intérieur, nos territoires émotionnels, tendant vers la transe. »
Un vocabulaire et un idéal qui ne sont pas les miens (si ce n’est celui de la verticalité et du mouvement). Suscitant chez moi la crainte d’une supercherie… que je ne vais pas tenter de définir ici, parce que dès les premières notes de violon, en dépit des “effets spéciaux” dont Régis Huby fit le tour de la pointe du pied sur les nombreuses pédales le cernant lors d’une introduction “a capella, il était évident qu’il ne s’agissait pas de cela que j’aurais pu craindre, une sorte de new age music, mais d’abord d’exigence du geste et du son qui en résulte, qu’il provienne de l’archet ou de ses prolongements électroniques. Loin de tout engourdissement contemplatif, un discours, une mobilité, un voyage sonore et formel, une écriture tramée par l’initiative improvisée entre ces protagonistes : Séverine Morfin (violon alto), Samuel Blaser (trombone), Clément Petit (violoncelle), Claude Tchamitchian (contrebasse) et Michele Rabbia (batterie, percussions, électronique).
Le concert : Six virtuoses chacun de son instrument, assumant l’héritage de celui-ci, où l’on retrouve l’attachement à la grande écriture chambriste pour cordes des siècles passés qui hante Régis Huby depuis l’expérience du Quatuor IXI et qui s’exprime tant dans les premières pages d’écriture que dans la première grande improvisation collective offerte, peu après l’ouverture, à un quatuor où le trombone aurait pris la place du second violon. Le geste instrumental s’ouvre ici au vocabulaire gestuel et timbral du jazz, mais aussi aux “extensions” de la musique dite “contemporaine” et à d’autres lyrismes provenant des “musiques du monde” avec ces pizzicati “monnayés” par Clément Petit avec des accents de joueur de oud ; ou ces glissandi de l’alto que Séverine Morfin semble soudain ramener de l’Inde du Sud. Plus, lorsque la contrebasse de Claude Tchamitchian entre en jeu, des tirés de l’archet qui pourraient passer pour autant d’hommages à Barre Phillips quelques jours après sa disparition. (Là c’est moi qui divague, mais n’y sommes-nous pas invités ?) Et enfin, Michel Rabbia et cette rudimentaire sophistication qui le fait passer d’un fagot frappé sur une peau à une électronique à laquelle il semble livrer combat, comme pris d’une frénésie crépitant sous l’effet d’électrocutions du rythme et des sons, jusqu’à ce climax onirique où, ayant fait symboliquement “sauter les plombs”, il achève sa folle improvisation en plongeant les mains dans un grand sac de sport rempli d’un farfouillis d’objets qu’il tripote frénétiquement à l’abri de notre regard.
Tout cela dans un grand souci de la texture et de l’écoute mutuelle, ces évènements s’organisant en un grand récit, un grand déploiement orchestral, d’une continuité inexorable où la grâce de l’intranquillité ne cède jamais totalement le pas à la béatitude promise, passant par toutes les phases, du chaos – tout au bord du chaos, jamais ou rarement au-delà – au lyrisme, notamment lorsque émerge une sorte d’hymne à la joie. Il y aura un genre de sacre du printemps traversé dedéflagrations free. On croit la fin arrivée mais elle est suivie de quelque chose que d’aucuns trouveront « de trop » et que, insatiable, je prend volontiers comme un rappel non réclamé/non annoncé se concluant en un élégiaque allegreto que, relisant mes notes, j’ai peut-être rêvé. Mais qu’est-ce, hier soir au Triton, qui ne relevait pas du rêve ? Existe-t-il encore en ces jours sombres pour la création quelque salle susceptible de donner, au-delà du disque promis, l’occasion de vivre, de s’affiner, de s’épanouir, les plus attentifs des programmateurs qui s’affichèrent autrefois innovants (pas toujours pour le meilleur) ayant aujourd’hui tendance à répondre aux sollicitations : formidable ce projet, très émouvant… mais tu vois, ce n’est pas pour notre public ? Adieu les créateurs et place aux ambianceurs. Franck Bergerot