70 ans en 70 disques, bonus vol.2

Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

Miles Davis
Someday My Prince Will Come
C.B.S.
Extrait de Jazz Magazine n° 94, mai 1963
Dès le départ, j’annonce ma couleur : avec Miles Davis, je suis volontairement et lucidement partial. Depuis tant d’années déjà, il appartient à mon domaine le plus intime. Si je devais citer un nom de musicien depuis la mort de Charlie Parker, celui de Miles Davis me viendrait spontanément aux lèvres. C’est peut-être pourquoi je n’en parle qu’avec appréhension : je sais à l’avance que mes efforts pour en dire la grandeur aboutiront à un échec. Pourtant, l’une des plages de cet enregistrement, celle qui donne son titre à l’album, me semble la plus propice à le cerner : on sait la mièvrerie de tout ce qui s’attache au nom de Walt Disney et Un jour mon prince viendra pourrait presque en être l’archétype. Un thème veule, pleurard et visant bas. Et voilà un disque digne, austère et s’adressant à la part la plus noble de l’homme. Tout est affaire d’écriture. Et de noblesse naturelle. Miles évite sans effort l’effusion geignarde qui se dissimulait derrière chaque note, domine le thème puis l’oublie, ne gardant que l’idée directrice. On nous dit que Lester Young lisait toujours très attentivement les paroles des ballades sur lesquelles il devait improviser. Miles n’a lu que le titre et c’est à partir de là qu’il va bâtir son chant d’amour et de solitude, d’une tristesse et d’une pudeur viriles et profondes. Davis est peut-être le seul musicien de jazz, aujourd’hui, qui puisse, sans ridicule, s’affubler du titre de Prince. Car il est Prince par la grâce, la distinction, la qualité. (On aura compris que dans le terme Prince, je ne vois aucune discrimination sociologique : ceux qui, parfois, me lisent, savent que je ne suis précisément pas du côté des princes. Et les seuls princes que je connaisse intimement sont tous des prolétaires. Et des militants.) La qualité, ai-je dit : la note de qualité, l’accord de qualité, la phrase de qualité au prix d’une ascèse poursuivie sans relâche. C’est une musique qui vient de l’intérieur, comme dirait Robert Bresson. Et comme les films de Bresson, l’exacte dimension de la musique de Miles Davis requiert beaucoup d’attention, beaucoup d’abandon et beaucoup d’amour. Il faut savoir entendre entre les notes. C’est le contraire même d’un jazz de digestion ou de divertissement. La place me manque pour parler comme il conviendrait des autres thèmes : du reste, je répugne à détailler les enregistrements. S’il est vrai que, compte tenu des erreurs, Miles est plus à l’aise dans certains morceaux, il n’en reste pas moins vrai que chaque thème est brassé dans le collimateur davisien. Tout est à entendre, et à méditer. D’autant qu’un des sidemen de Miles était à l’époque notre cher John Coltrane, un Coltrane qui sentait déjà poindre en lui l’explosion des années suivantes. C’est là qu’on se rend compte de tout ce que Coltrane a retenu de son séjour chez Miles. Lui aussi est un musicien pudique : son aventure esthétique pourrait s’accompagner d’un exhibitionnisme, d’une logorrhée qu’à aucun moment on ne sent chez lui (alors que chez ses imitateurs…). Chez lui non plus, il n’y a pas rupture entre le passé et le présent : il suit simplement une route logique sous le signe de la beauté. Miles, maître de lui et de son art : la conclusion s’impose d’elle-même. Jean Wagner

John Coltrane
A Love Supreme
Impulse
Extrait de Jazz Magazine n° 132, juillet 1966
Nous l’avons vu à Antibes, le Pascal de la musique de Nègres, trépignant sur l’estrade, flottant entre les deux infinis du lyrisme et de la fureur, hors de lui et d’une certaine musique coltranienne que nous croyions savoir. Ce fut une messe très noire, avec Elvin, l’enfant de cœur dément qui agitait les cymbales de l’apocalypse. Les quatre cavaliers dans la nuit chaude, à cheval sur le tonnerre, couchés sur l’encolure de leurs bêtes, Trane mêlé à son instrument et la mer par derrière, impuissante, oubliée et perdue dans la transe et le suprême amour du jazz. Nous fûmes engloutis. Cette fois, John ne peut nous prendre à l’improviste, et nous donner son Bon Dieu sans confession. Nous avons refait surface, nous avons pris nos distances.
Il y a ici moins de folie. L’oiseau est dans la cage même si la cage est immense. Équilibre ? Certes, et même stabilisation. La musique s’introspecte avec lucidité, regarde en arrière, se cite elle-même en exemple et décrit dans l’intemporalité un cercle majestueux, parcouru indifféremment dans un sens ou dans l’autre : ainsi Resolution, qui semble éveiller l’écho de quelques thèmes familiers. Coltrane n’a pas osé – ou voulu – se trahir, comme à Antibes. Il a défini lui-même son classicisme, afin que nul n’en ignore : ce disque s’inscrira dans son œuvre comme dans celle du Bird les sessions en quartette (avec Al Haig et Max Roach). Il n’est pas aisé alors de s’avouer insatisfait (d’autant plus que cette insatisfaction-là laisse loin derrière elle la plupart des contentements) et c’est un scrupule seulement – de dire tout mon sentiment – qui me force à parler. J’ai eu du dépit, au milieu du plaisir extrême, à voir cette œuvre se laisser disséquer et comprendre sans défense ; j’ai eu du dépit à voir Trane se refuser à toutes les iconoclasties, la plus belle surtout, celle de sa légende. Tel qu’en lui-même il s’est voulu ici, statue grandiose et marmoréenne… Je préfère qu’il prête le flanc à l’incertitude et s’interroge sur la possible vanité de son art. N’est-ce pas ainsi – déchiré – qu’il nous est apparu naguère, brisant furieusement les conventions, arrachant au jazz ce que jusqu’alors il s’était toujours refusé à dire, empêcheur monstrueux des habitudes de la beauté ?
Comme celle d’Antibes, son exaspération d’alors dépassait la mesure d’un mode d’expression. Elle ne se regardait pas faire et ne prenait pas le temps de surveiller sa mise, au prix, parfois, de l’inquiétude et du chaos. Ce n’était pas payer trop cher le feu sauvage du jazz recommencé. Mais on se consolera, comme moi, dans la vaste et multiple splendeur d’un des plus beaux microsillons que le jazz jusqu’ici nous ait offerts. Il lui sera beaucoup pardonné : Trane vaut bien une messe. Alain Gerber
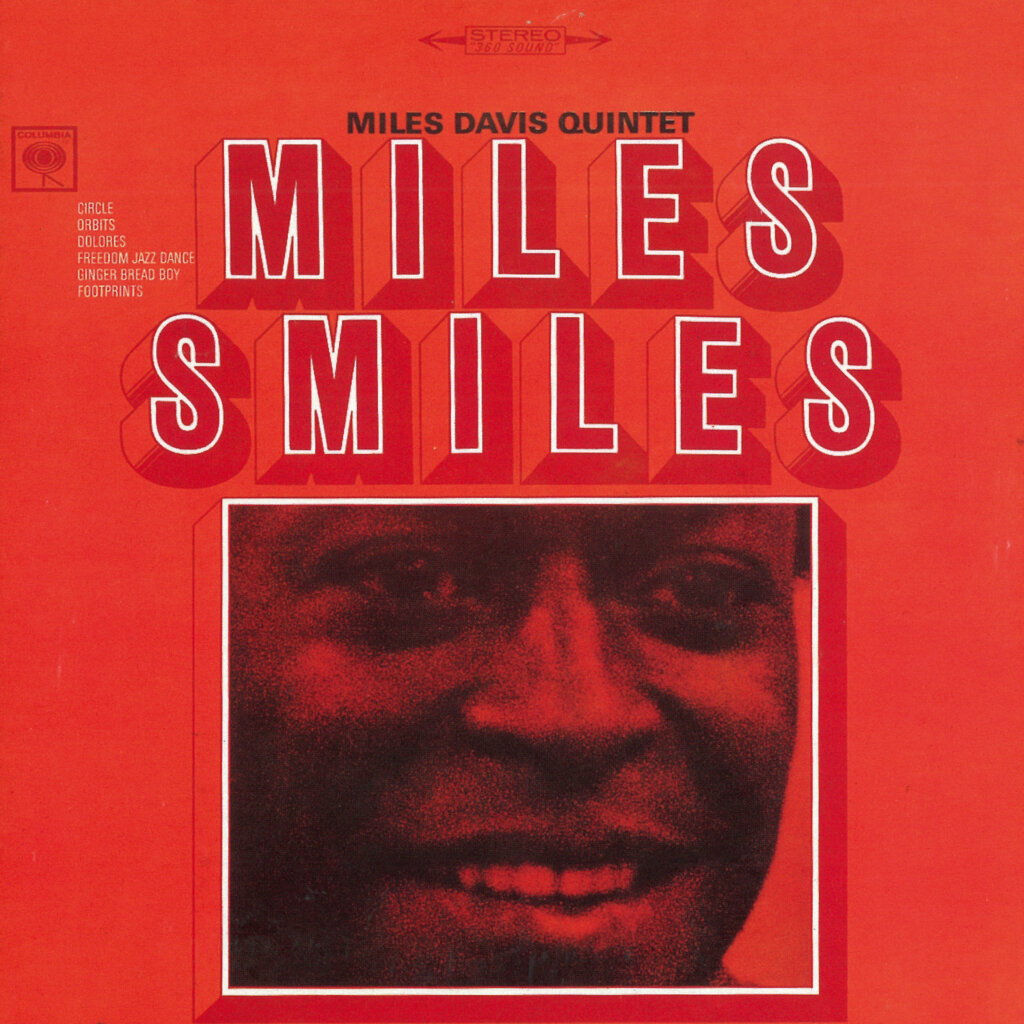
Miles Davis
Miles Smiles
CBS
Extrait de Jazz Magazine n° 147, octobre 1967
9/10. Le sourire de Miles : il n’est guère présent que sur la pochette, pour justifier un de ces jeux de mots dont l’industrie du disque fait grand cas. En tait, cette musique se déploie dans une région altière qui se situe bien au-delà de l’expressivité du rire ou des larmes. Peut-être même avons-nous ici un des disques les plus austères de Miles, dont le destin a toujours reposé sur cette contradiction féconde : qu’il est, naturellement, un des musiciens les plus lyriques de toute l’histoire du jazz, mais que, par pudeur et par exigence créatrice à la fois, il n’a eu cesse de dépersonnaliser ce lyrisme, d’y rechercher, plutôt que les moyens d’une confidence, les éléments objectifs d’une aventure musicale à laquelle il a toujours su rallier des compagnons de premier plan. Processus constant où l’on peut, toutefois, observer un discret mouvement pendulaire, qui accentue légèrement l’un ou l’autre aspect : à l’expressionisme “bop” succède ainsi, à travers les années “cool”, le rêve d’un jazz plus formalisé ; à la musique, directe et souvent enjouée, du quintette du milieu des années cinquante fait suite, à partir de 1957, une période d’exploration du sortilège sonore.
Cette évolution d’une grande rigueur intérieure, on voit cependant qu’elle demeure extrêmement attentive au mouvement historique du jazz, un mouvement qu’elle n’a pas manqué, au reste, d’accélérer. Mais il est très caractéristique de Miles que sa voie soit toujours demeurée parallèle aux grands courants sans jamais s’y confondre. Sans doute est-il trop secret pour dresser sa tribune aux carrefours de l’histoire ; et surtout, les motivations psychologiques, les exigences esthétiques personnelles et l’art instrumental for-ment-ils, chez lui, un ensemble trop complexe : on joue aux côtés de Miles, on participe, plus ou moins longtemps, à l’entreprise qu’il définit, mais on ne se définit pas à partir de lui. En fin de compte, sa musique, on le voit, s’établit au point de concours d’une double transposition : celle, nous l’avons dit, de son lyrisme naturel, et celle du jazz contemporain du moment où il crée, un jazz où il puise ce qui le concerne et qu’il enrichit, en retour, d’une voix originale et toujours à l’heure. jazz où il puise ce qui le concerne et qu’il enrichit, en retour, d’une voix originale et toujours à l’heure. “Miles Smiles”, c’est le Miles d’aujourd’hui : on dirait qu’il a regardé du côté d’Ornette Coleman et de Don Cherry.
Non point qu’il fasse, à proprement parler, du “free jazz”, mais parce que, répudiant toute cette quête d’une architecture temporelle du son, qui semblait avoir été la fin poursuivie ces dernières années, il sacrifie ici, au discours, c’est-à-dire à un ordre qui s’y oppose comme le continu s’oppose au discontinu, et qu’il privilégie au détriment du contexte harmonique, peu déterminant et, pratiquement, presque toujours sous-entendu : Herbie Hancock, ainsi, ne parait avoir aucun jeu de main gauche. Seulement, à la différence de celui de Don Cherry, le discours de Miles ne prétend nullement serrer au plus près une sorte de parole intérieure ; il s’attache, au contraire, à cultiver sa propre organisation, où alternent, notes détachées, courts fragments qui se déploient en imitation et longues lignes en valeurs brèves. La qualité sonore, ici, parvient à une sorte de neutralité qui trahit sa disgrâce : elle ne conserve un rôle original que comme pôle du discours, soit cet aigu éclatant et crispé vers lequel converge presque toujours la succession des phrases, soit, plus rarement, ce grave qui s’exténue comme au terme d’une décompression, sons, notons-le, jamais établis, tout de suite dissipés par leur excès même, car leur rôle unique est de figurer les extrêmes d’un champ dis cursif. Et tel est le pouvoir du jeu de Miles que Wayne Shorter et Herbie Hancock ne savent que le prolonger : jamais, peut-être, n’avons-nous entendu, dans une session en petit groupe, des successions de solos s’emboîtant si exactement, comme si une seule voix parlait, à travers quelques caractéristiques accidentelles – le toucher subtil de Hancock, l’accent coltranien de Shorter.
Cette voix, cependant, dans l’attention extrême qu’elle porte à son propre déploiement, témoigne de soucis formels qu’on ne trouve guère chez les apôtres de la spontanéité. Chacun des musiciens mélodiques est, on le sent, initialement inspiré par le sentiment qu’il a de l’espace de son propre jeu ; et les thèmes apparaissent moins comme des supports de séquence harmonique que comme des jalons plantés à l’origine d’une aventure qui cristallisera à partir d’eux. Ces thèmes sont, en général, du même type : système discontinu de trois segments (Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy, Dolores) enraciné sur une figure rythmique immuable qu’énonce la basse et plongeant dans une sorte de matière percussive établie par la batterie. Improviser sur ce système, c’est, on le voit, marier la circularité (propulsés par la basse, les solos se déploient autour du thème en couches concentriques) et la périodicité (le discours des improvisateurs se fondant sur des alternances d’extension et de concentration, de style lié et de style détaché, de valeurs brèves et de valeurs longues). Ce souci, les titres, au demeurant, l’attestent : Orbits, Circle – la seule plage, par ailleurs, où Miles, jouant en bouché dans l’esprit de la ballade, rejoint, par instant, sa veine lyrique. En revanche, Freedom Jazz Dance superpose à la circularité une sorte de dynamisme linéaire assez martial, qui tient, essentiellement, à ce que Tony Williams y marque tous les temps : le solo de Miles, étagé par les ponctuations, régulières et violentes, de Herbie Hancock, prend ici un véritable caractère de harangue.
Cette musique, on le voit, qui ne se cherche pas de raison hors de sa propre cérémonie, nous entraîne loin de l’idée d’un jazz expressif et chantant. Elle est comme l’illustration de l’incessante dialectique du même et du divers au sein d’un discours. Mais par une dialectique ultime, qui achève et assoit cette musique, ce discours lui-même est confronté à son contraire : une masse sonore dynamique et en perpétuel mouvance qu’instaure, avec un très subtil génie, Tony Williams. A la pure efflorescence formelle répond, de la sorte, une matière savoureuse qu’anime aux balais et aux baguettes, une exceptionnelle qualité de frappe : cette matière en habite les creux et, par des variations de tempo, en fait contraster les énoncés. Ainsi voit-on, avec ce disque, à Miles le lyrique puis Miles l’enchanteur, succéder Miles le démiurge. Il a, aujourd’hui, dépouillé son jeu de tout ce par quoi il pouvait suggérer un univers à lui seul. Il a, aujourd’hui, dépouillé son jeu de tout ce par quoi il pouvait suggérer un univers à lui seul.
C’est à l’idée de son jeu qu’il se tient, et celle-ci est comme le centre d’un cercle en mouvement à partir duquel tout s’engendre et se hiérarchise, suivant la procession oppositions. Miles est la forme qui féconde et en retour toute cette musique reflue sur lui : toujours plus présent et toujours plus absent. Michel-Claude Jalard
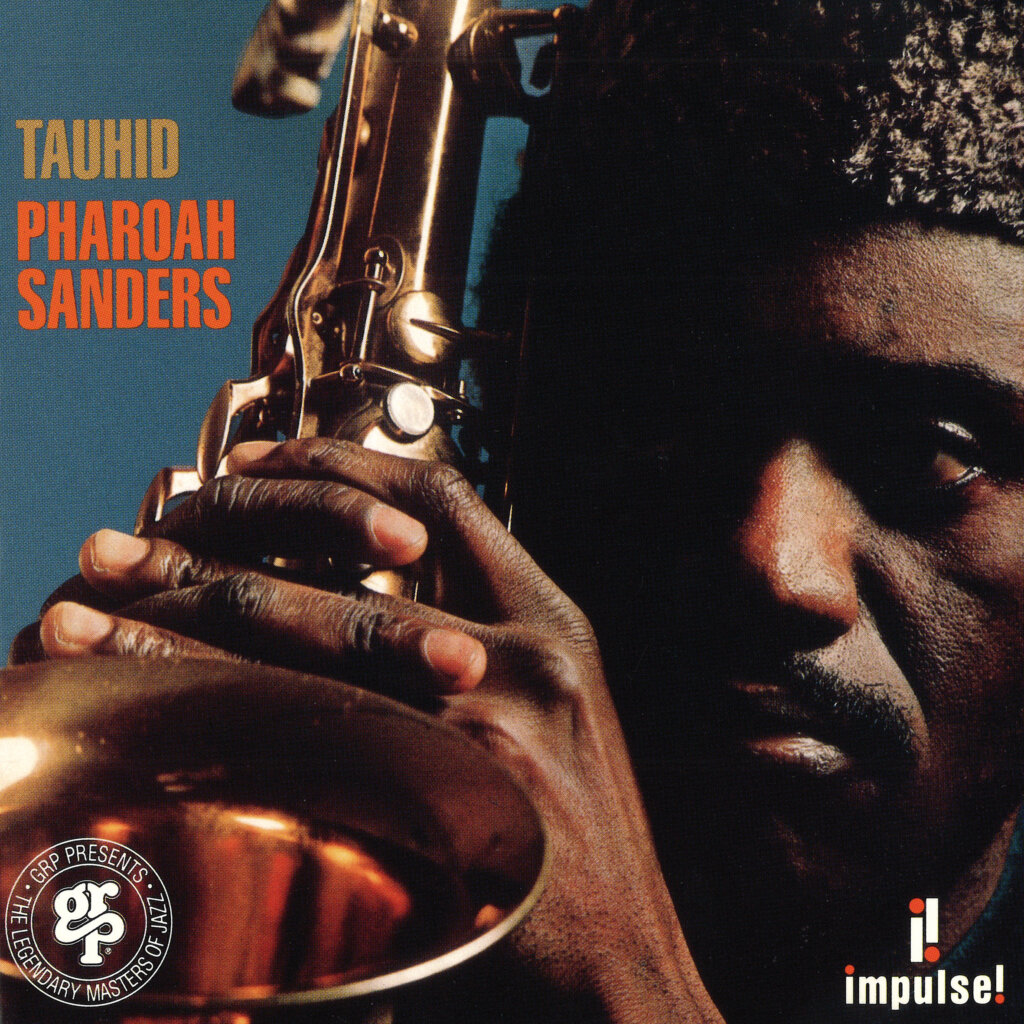
Pharoah Sanders
Tauhid
Impulse
Extrait de Jazz Magazine n° 155, juin 1968, p. 42
10/10. Lorsque Coltrane était là, on eût dit que Sanders assurait près de lui le rôle d’un tentateur en modernité ; aujourd’hui qu’il n’est plus, Sanders réinvestit dans les dissidences le sortilège coltranien. Tandis que Shepp, par-delà sa brûlante ferveur et contre elle, ne craint pas d’endosser l’ingrate livrée de l’iconoclaste (on accordera cependant que, dans une large mesure, il ne fait malgré tout en cela que suivre Coltrane lui-même, premier des diseurs de messes noires aux marches de son culte), Pharoah réarme l’orthodoxie et fomente une croisade. L’heure qui vient est pour lui celle d’une rédemption des teigneuses incertitudes du libre jazz par ce lyrisme où s’enchâssait chez Coltrane le chant jusqu’en ses tortures. Un lyrisme à la mesure de ce temps piétiné : fervent avec mysticisme, dolent avec passion. Tantôt (puisque l’homme ici n’est point seul) il en appelle à Dieu – qu’il invoque sa pitié ou déchiffre simplement le monde avec émotion. Tantôt, crevé de rongé par l’amertume et la révolte (encore) impuissante, il semble se dévorer lui-même – mais il refait ses forces en ce terrible festin. Du choc de ces deux attitudes – l’adoration et l’exaspération – naît une musique où le contemplatif et l’incantatoire le disputent au torride et à l’exa-cerbé. L’extase est furieuse mais ce jazz, cependant, reste immobile au milieu de ses houles. L’élan se ravale dans son propre bond mais tout se passe comme si cet échec l’invitait à se déployer encore. Ainsi jusqu’au bout de cet étrange statisme peuplé ou grondent, à fleur de derme, d’extrêmes bouleversements (cf. Upper Egypt ou Aum, singulièrement). Derrière son chef et suivant les couleurs de sa passion, l’orchestre se partage. Il y a ceux de l’incantation (Burrell, Grimes) et celui de la colère (Sharrock, dont, en solo, la technique de guitare participe d’une agression : il faut avoir entendu l’agonie superbe de l’instrument écorché vif, étranglé dans ses cordes pour mesurer la distance qui sépare le jazz qui agit de celui qui se souvient). Tous, cependant, ne songent qu’à porter le lyrisme à incandescence, qu’il soit épanoui ou convulsé, délassé ou rebiffé contre so1.
Il vit d’ailleurs, on l’a vu, de la superposition de ces états hostiles les uns aux autres de sorte que, parfois, 1l se livre et se reprend dans un même cri dont on ne sait trop s’il est d’espérance ou d’inquiétude, s’il est plainte ou ricanement. C’est aussi que l’imprécision elle-même féconde le mystère où s’enracine l’extase. Tout ici vise à la transe. Non la transe vomie par le corps saoûl, mais cette transe sèche encerclée par son propre drame (lors-qu’elle ne peut échapper à l’instant) ou pétrifiée dans sa jubilation (lorsqu’elle ne veut pas que l’instant lui échappe). Transe exaspérée du son ou transe opiniâtre du rythme (abritée dans les replis d’une menteuse monotonie), elle nous paraît déjà indispensable aux cérémonies du jazz neuf. C’est par elle assurément que ces œuvres – sauf Japan qui fait tache mais sur quoi l’on peut bien fermer les yeux – s’installent avec Juno Sé Mama, au premier rang de celles, peu nombreuses, qui savent nous déposséder le mieux de nous-mêmes et, partant, de nos insupportables exigences envers le jazz qui se fait sans – ou malgré – nous. Alain Gerber

The Jazz Composer’s Orchestra
The Jazz Composer’s Orchestra
J.C.O.A. Pathé
Extrait de Jazz Magazine n° 165, avril 1969
10/10. La première question posée par l’entreprise du J.C.O. celle même, posée et reposée jusqu’au ressassement par tous les grands orchestres de jazz, du rapport écriture/ improvisation. Mais question plus brûlante encore ici, puisque, improvisation ou écriture, il s’agit de free-jazz. A part en effet les constellations de mu-siciens gravitant autour de Sun Ra, à part surtout les grands rassemblements guidés par John Coltrane pour Ascension, à part certaines éphémères tentatives en concert des free jazzmen français, l’exercice du free jazz s’est le plus souvent pratiqué en comités restreints, la “liberté” de quelques-uns étant moins utopique, sans doute, que celle de tous. Or le problème du nombre était résolu dans Ascension par une sorte de fuite en avant éperdue de tous les mu-siciens, donnant l’impression que chacun, sourd aux autres, jouait pour soi seul. Et cela pouvait sembler être la seule issue praticable pour une grande formation free : assaut et enchère de sons, multiplication des délires, accumulation et mise en vrac des qualités spécifiques des musiciens, la seule résultante formelle d’un tel brassage étant dès lors l’alternance des phases de flux et des phases de reflux sonore, des crescendo et decrescendo, ascensions et récessions. Frappent ici, tout au contraire, cohérence et clarté de l’ensemble, le souci de construire les rapports masse orchestrale/soliste, et ce jusque dans les moments d’éruption générale (exemple : le Preview qui oppose Pharaoh Sanders et l’ensemble de l’orchestre : une structure très précise régit leurs poussées respectives, celle d’une sorte de boogie…). Joueraient donc tout à la fois une certaine survivance de l’empreinte classique. et la prédominance de l’écrit (ou du moins du construit) sur l’improvisé (le délire de masse). Plus précisément, c’est la forme et le fonctionnement du concerto (pour piano : Taylor ; guitare : Coryell ; trombone : Rudd ; trompette : Cherry) qu’évoquent les compositions de Mantler.
Mais un “concerto free” ? Sans doute, et ce ne serait pas le moindre paradoxe de cette aventure, ou vont de pair, et comme tout naturellement, des notions réputées inconciliables : concerté-débridé, cadre-évasion, etc. Car Cherry-Barbieri, Taylor, Sanders n’ont rien perdu de leur habituelle turbulence. Et même, le fait de jouer les compositions de Mantler n’altère en rien leurs caractères spécifiques : ni le rapport au compositeur, ni le rapport à l’orchestre ne changent leur jeu, leur ordre propre. Tout se passe comme si le tissu imaginé par Mantler était à la fois assez fort pour résister à tous craquements et déchirures, assez lâche pour autoriser écarts, inventions, sauts. Une sorte de perfection, donc, d’équilibre entre l’individu et le collectif, et, à l’intérieur même du collectif, entre les invidus, dont les grands orchestres de jazz, – à l’exception de certains enregistrements de Gil Evans, Oliver Nelson, et bien sûr de ceux d’Ellington où hommage est rendu à tel musicien de l’orchestre – n’avaient que rarement approché, préférant à toute liberté surveillée carrément le plus totalitaire des régimes. Mais sans doute il était normal que ce soit le free jazz qui fasse la preuve de la compatibilité, au sein du grand orchestre, du calcul et de la liberté. Par quoi le “Jazz Composer’s Orchestra” ouvre au jazz (et non seulement au free jazz) des perspectives non négligeables. Jean-Louis Comolli

Bill Evans
Alone
Verve
Extrait de Jazz Magazine n° 179, juin 1970
10/10. I Got It Bad, Waltz For Debby, My Romance (dans “New Jazz Conceptions”), Lucky To Be Me, Epilogue, Peace Piece (dans “Everybody Digs Bill Evans”), Solo (dans “Bill Evans At Town Hall”), ce sont les très rares improvisations sans accompagnement gravées par Bill Evans depuis 1956. On aurait dit qu’il lui était difficile de se priver d’interlocuteurs. Livré à lui-même dans certains albums, il tournait la difficulté grâce au procédé du re-recording qui témoignait ainsi de son angoisse d’être seul. Tant s’en faut, cependant, que les pièces qu’on vient de citer accusent des faiblesses qui donnent raison aux répugnances du pianiste. Au contraire, il est avéré que quelques-unes d’entre elles – Epilogue et Peace Piece, tout particulièrement – sont au nombre des plus abouties qu’il ait jamais signées. Il fallait donc bien qu’un jour, il s’abandonne aux jeux de ce narcissisme qu’on lui reproche et qui est en fait ce dont il s’effraie le plus. Il fallait qu’il affronte le silence – non pas cette sorte de silence à quoi il s’était accoutumé, et qui n’est que le degré le plus apaisé de la musique, aussi plein et aussi parlant qu’elle, mais bien ce silence qui n’est que béance, menace muette ou indifférente insondable, ce silence-là dont Miles Davis, poétiquement, s’est fait un complice. Et voici “Alone” où Bill, attentif mais complètement détendu, réduit à l’impuissance les chimères du silence à force de dédain. Un autre à sa place eût peut-être donné dans le piège et fait jacasser son instrument, comme un enfant dans le noir qui parle pour halluciner sa peur. Il a préféré l’indifférence et il a trouvé la sérénité, en refusant de précipiter son débit ou de boucher à toute force les fissures obligées du discours, par où le doute aurait pu s’engouffrer. De la sorte, cet album est l’un de ses plus équilibrés et l’un de ses mieux remplis. C’est à peine si, dans A Time For Love, on parvient à soupçonner en certains tours de phrase l’envie d’une contrebasse. Partout ailleurs, il a accepté sans tricher les obligations de la solitude, finissant lui aussi par contraindre le silence à collaborer et à confesser cette musicalité qu’il aurait voulu intimider. Scellant la réconciliation de Bill Evans avec ses plus intimes pudeurs, “Alone” accomplit à sa manière une révolution de palais. Il s’avère ainsi à la fois comme le couronnement (espéré) et le rebond (inattendu) d’une œuvre qui jusqu’alors avait paru aux plus pressés des auditeurs ne présenter ni degrés, ni accidents, ni aventure. Alain Gerber

Freddie Hubbard
Red Clay
CTI
1970
Après avoir publié sept vigoureux albums hard bop pour le légendaire label Blue Note et trois autres plus commerciaux chez Atlantic, le fougueux trompettiste Freddie Hubbard est entré pendant trois jours, fin janvier 1970, dans le studio de Rudy Van Gelder pour enregistrer son premier disque pour le label CTI fondé en 1967 par le producteur américain Creed Taylor. Pour cette séance bouillonnante il est accompagné de trois anciens partenaires du label d’Alfred Lion et Francis Wolff : l’audacieux saxophoniste ténor Joe Henderson, Herbie Hancock toujours habile et malin au Fender Rhodes et l’indispensable et très sûr Ron Carter à la contrebasse et à la basse électrique. Pour compléter ce casting de trentenaires surdoués, il fait appel au batteur des sessions “Bitches Brew” de Miles Davis, Lenny White qui venait tout juste de fêter ses vingt ans. La musique écrite par Hubbard pour ce fabuleux quintette est en majeure partie modale. Elle offre de larges espaces pour développer de longs solos dynamiques d’une belle férocité. Hubbard perce les nuages et se livre à des acrobaties pyrotechniques sauvages. Henderson creuse des improvisations gorgées de groove. Hancock stimulé par une rythmique infaillible fait preuve d’une dextérité stupéfiante. Un album flamboyant de haute intensité ! Paul Jaillet