Noé Huchard et ses comparses, le contrebassiste Clément Daldosso et le batteur Donald Kontomanou ont subjugué le public du One More Time à Genève dans le cadre du festival JazzContreBand qui se déroule tout le mois d’octobre de part et d’autre de la frontière franco-suisse.
Hier, on n’avait que l’embarras du choix : au Parvis des Fiz à Passy, une duo réunissant les joueurs de oud et chanteurs Mohamed Abozekry et Ersoj Kasimov ; au Caves de Versoix, le trio du pianiste Gabriel Zufferey avec deux musiciens remarqués les années passées au tremplin du JazzContreband, le contrebassiste Yves Marcotte et le batteur Nathan Vandenbulcke ; au One More Time, le trio du pianiste Noé Huchard avec le contrebassiste Clément Daldosso et le batteur Donald Kontomanou. J’ai jeté mon dévolu sur ces derniers. Encore fragile en 2018, âgé de 19 ans, dans un répertoire solo, alternant avec Hervé Sellin son professeur au CNSM et sous l’œil sévèrement analytique de Martial Solal, le tout dans la maison de Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye, il m’avait semblé très prometteur. Depuis, il s’est incontestablement imposé sur la scène française.
One More Time est la vitrine de l’AGMJ (Association genevoise des musiciens de jazz) qui rassemble un public, pour partie de musiciens eux-mêmes, dont l’âge n’a d’égal que l’enthousiasme et l’érudition (je désigne ici le premier carré des membres les plus assidus rassemblés au premier rang, hélas représentatifs du public des scènes de jazz aux têtes de plus en plus chauves ou blanches, pour des musiciens de plus en plus jeunes et toujours plus aptes à actualiser de mille manières le message du jazz. Certes, au deuxième set de Noé Huchard, surpris par l’air de déjà entendu de Little Willie Leaps de Miles Davis et/ou John Lewis (la première séance de Miles en 1947 pour Savoy), ils s’accordent pour l’attribuer à Bud Powell. Mais ils n’étaient pas loin et j’ai moi-même hésité, le tempo plus vif que que celui de la version de Miles étant trompeur. Et Bud Powell en fit lui-même quelque chose de totalement powellien en 1953 au Club Kavakos de Washington avec Charles Mingus et Roy Haynes (le prodigieux “Inner Fire” paru en 1982 chez Elektra Musician). N’empêche que l’un de nos vétérans – ce “vétéran” dit sans ironie, je suis à quelques années près l’un des leurs –, m’a fredonné à la sortie du concert l’exposé de ce thème rare qui ne fait qu’une cinquantaines d’apparitions dans la discographie générale du jazz de Tom Lord, contre 300 pour Confirmation de Charlie Parker, 900 pour How High The Moon. Gobalement, ce public témoigne un enthousiasme à Noé Huchard plein d’à propos, notamment lorsqu’un autre vétéran y glisse une petite, très petite réserve à la sortie du concert : « un peu trop jamalien à mon goût ». Assez bien vu, j’avais pensé à Jarrett, sans les maniérismes, mais on sait que le Jamal de l’Alhambra et du Pershing est l’une des seules influences que le trio de Jarrett se reconnaisse. Aussi la réserve de notre interlocuteur met-elle le doigt mieux que je ne ferai moi-même sur l’une des qualités – moi, je n’en fais pas une réserve – du trio de Noé Huchard dans sa gestion de l’espace, du temps et de la forme.
L’Association publie son périodique Jazz-One More Time, au format identique au Bulletin du Hot Club de France, mais nettement plus dans le coup. Longs interviews de musiciens locaux (dans le numéro 420 septembre-octobre, le guitariste Christian Graf et Jean-Claude Rochat, pianiste et programmateur du Chorus de Lausanne qu’il a ouvert en 1988), actualités, news, chroniques de concerts et de disques… et ce mois-ci, Noé Huchard en couverture, plus, cerise sur le gâteau un portfolio de photos de la grande photographe Danny Ginoux (cette fois-ci des témoignages du séjour de David Murray et Craig Harris à La Havane en 2001 pour l’enregistrement du Latin Big Band “Now Is Another Time”).
Mais venons-en aux concerts hebdomadaires organisés le vendredi au Centre Artistique Adéléa de Genève, avec hier soir le trio annoncé plus haut. Dès la première longue suite enchainant deux compositions originales, Noé Huchard nous embarque dans son univers, avec un sens de l’économie, de l’espace, de l’architecture et du développement qui fait que l’on passe de l’un à l’autre morceau sans s’en apercevoir si l’on n’y prête pas attention, le pianiste pratiquant un art subtil du glissement, jouant de la fausse fin pour relancer une nouvelle phase ou introduire un solo de batterie ou de contrebasse que l’on n’attendait pas. Tandis qu’il sait se montrer économe de la main gauche, dans un art du comping contrôlé voire muet pour lâcher la bride à sa main droite, dans une interprétation pleine d’émotion de La Passionaria de Charlie Haden, il combine les deux mains dans une évocation de Bach. Il amène How High the Moon en contournant l’exposé – à moins que je n’ai succombé à une petite sieste qui m’est coutumière vers 21h30 – pour en ramener la mémoire dans ses harmonies jusqu’à l’exposé conclusif, et ce sera l’occasion pour ses comparses de jouer à fond la carte du classicisme et du swing-walking-chabada, solo de batterie mesuré, avec cette petite touche postmoderne qui tient notamment à la connaissance encyclopédique de l’histoire de la batterie de Donald Kontomanou.
Nous en parlons à l’entracte, je lui cite Jo Jones et Roy Haynes qui me paraissent deux bornes évidentes de son jeu, et il me cite Charlie Johnson des Versatile Four ! Orchestre de ragtime new-yorkais issu du Clef Club de James Reese Europe, et qui s’installa à Londres en 1915. Il me dit le plaisir qu’il a de jouer évidemment avec Noé, mais aussi avec Clément Daldosso, en qui il trouve un complice parfait avec cet enracinement dans l’histoire au sens large, passant de la stricte walking bass, à un jeu plus “en l’air”, mais avec toujours une belle profondeur. C’est dire que tous deux participent de cette architecture que j’évoquais ci-dessus à propos du jeu de piano. Le premier set se termine sur un hommage du pianiste à Eric Dolphy où la main droite peut exprimer toute sa faconde.
Deuxième set (celui où sera joué Little Willie Leaps : j’ai cessé de prendre des notes pour me consacrer à mon seul plaisir. Demain, je filerai au Chorus pour assister à la finale du 2ème Concours international de piano du Chorus (inspiré du Concours Martial Solal qui en est le président d’honneur et dont Noé Huchard remporta la première édition l’an passé). Puis en soirée, je rejoindrai le JazzContreBand à Ferney où Dan Tepfer est attendu à la Comédie. Franck Bergerot
…à propos du programme “Brain Songs” inspiré de recherches en neurosciences cognitives, créé en 2022 par Christophe Rocher et l’ensemble Nautilis et qui avait fait l’objet d’un compte rendu au Émouvantes de Marseille.
L’ayant rédigé dans un train remontant de Marseille, avec la ferme intention d’y avoir posé le point final et de l’avoir posté sur le site de jazzmagazine.com avant l’arrivée en gare à Paris, tout en m’accordant une sieste pour compléter une nuit trop courte, j’ai gardé l’impression d’avoir quelque peu bâclé mon compte rendu de la dernière soirée du festival Les Émouvantes (le 23 septembre), notamment concernant le concert de l’Ensemble Nautilis qui m’avait procuré un vif plaisir resté inexpliqué, tout en m’ayant un peu dépassé par la “nervosité” de l’événement et par l’apparente complexité du rizhome conceptuel attaché à son programme “Brain Songs”. Ça n’est pas la première fois que je rencontre cette impression de bâcler un compte rendu, mais Nautilis, orchestre à géométrie variable né à Brest et animé avec une paisible ténacité par le clarinettiste Christophe Rocher, loin de jouir d’une couverture médiatique exemplaire, méritait mieux.
Saurai-je faire mieux, profitant de ce nouveau train qui m’entraine vers Genève pour le festival transfrontalier JazzContreBand (ce soir, parmi une affiche qui, tout au long du mois d’octobre, n’offre certains soirs que l’embarras du choix : Noé Huchard au One More Time à Genève même ; demain samedi 14 : Dan Tepfer à la Comédie de Ferney ; dimanche 15 : Tremplin JazzContreband à la Ferme Asile de Sion) ? Saurai-je donc faire mieux qu’il y a un mois, le cerveau quelque peu tétanisé par les informations en provenance d’Israël et Palestine, alors que résonne encore les propos ce matin sur France Culture du réalisateur israélien Nadav Lapid (Prix du jury à Cannes en 2021 pour Le Genou d’Ahed) et de l’anthropologue et romancière palestinienne-canadienne (autrice de Je suis Ariel Sharon publié en 2018) cheminant douloureusement entre sidération et colère dans leur quête désespérée d’une sagesse aujourd’hui désertée.
Une demie heure plus tôt sur cette même chaîne, le neurologue Lionel Nacache invoquait les neurosciences cognitives sur le même sujet dans une rubrique qui, si elle ne m’a pas paru le propos le plus éclairant de cette matinale sur le drame en cours en Moyen-Orient, m’a ramené, très loin de cette actualité, au point de départ du projet de Christophe Rocher, “Brain Songs”. Et donc plutôt que revenir par moi-même sur le concert de Nautilis à Marseille, je renverrai le lecteur vers deux documentaires diffusés sur le média en ligne Kub – Kultur / Bretagne et une conférence, documents cinématographiques qui ne sont pas sans entrer en résonnance avec le dossier “Electro” à la une de Jazz Magazine ce mois-ci, et que l’on ne recommandera ni aux amateurs exclusifs de bebop ni aux adeptes d’une vision bien calibrée des relation entre musique et technologie à laquelle on réduit trop souvent le qualificatif d’electro.
Qu’est-ce qu’improviser ?
C’est la question que se sont posée à partir de 2018 Christophe Rocher et le chercheur en neurosciences cognitives et en intelligence artificielle (vibraphoniste à ses heures perdues) Nicolas Farrugia, tous deux au cœur du documentaire de 15’ Qu’est-ce qu’improviser ? du réalisateur Sylvain Bouttet. On y voit Christophe Rocher, un bandeau autour du crâne, équipé d’électrodes, se prêter à des séances d’encéphalogramme (EEG dans le jargon professionnel) ayant pour but d’enregistrer et d’analyser l’activité cérébrale du musicien lorsqu’il improvise. Et ce dans deux contextes, l’un en studio et en duo avec l’accordéoniste Céline Rivoal, l’autre en trio avec le contrebassiste Fred B. Briet et le batteur Nicolas Pointard. On note que seul Christophe Rocher est équipé, la technologie utilisée ne permettant pas pour l’heure de tirer parti d’un encéphalogramme collectif, le résultat obtenu servant à comparer les traces enregistrées de l’activité cérébrale d’un seul sujet et la réalité sonore de ce qu’il a joué.

Lors des échanges, on comprend que Christophe Rocher poursuit une sorte d’utopie à travers la mise en évidence de corrélations possibles entre l’espace mental de l’improvisateur et celui du rêveur ; où s’ouvrirait une porte entre ces deux domaines permettant à l’improvisateur de passer de l’un à l’autre, de les investir simultanément voire de n’en faire qu’un seul. L’expression choisie par lui-même et les improvisateurs auxquels Rocher fait appel est ici non idiomatique, dans une quête du lâcher prise et une défiance de l’approche analytique qu’il compare à la conduite automobile (à un moment du film il répond d’ailleurs à une interview tout en conduisant en ville). Métaphore qui jette le trouble et m’inspire l’usage du mot “utopie” : le fonctionnement d’une voiture et la conduite sur route répondent à des codes précis par des réflexes. Et les réflexes sont là, qu’ils soient ceux du bopper improvisant sur grille ou ceux de l’improvisateur non idiomatique.
Quand le cerveau improvise
Quand le cerveau improvise est le titre d’une conférence filmée le 14 avril 2021 à l’Atelier de la Comédie de Reims. Donnée par Nicolas Farrugia, elle donne lieu à une question sur le hasard, à laquelle Christophe Rocher répond sans vraiment la résoudre. Il écarte l’éventualité du hasard, dès lors qu’il y a interaction, mais reconnaît le sentiment de “n’importe quoi” qui peut résulter d’une non préparation du public à ce genre de musique ou d’une faiblesse de l’improvisateur cédant à la facilité du réflexe pour compenser, cette dernière occurrence ne relevant donc pas du hasard. Mais il évoque aussi cette sensation partagée avec d’autres artistes, comme les écrivains, qui leur fait dire : « ce n’est pas moi qui ait improvisé / écrit ça. » moments d’entière satisfaction qui nous ramène au concept romantique d’inspiration. « Cette forme de lâcher prise, précise Rocher, ne relève pas du hasard. Et même le “n’importe quoi” peut aussi relever d’une décision, par exemple sous la forme d’une provocation, qui n’est donc pas “n’importe quoi”. Je crois que c’est Joëlle Léandre qui dit : “On peut faire n’importe quoi, mais pas n’importe comment.” »

Plus tard (voir à 1:17:04 du film), en conclusion de la même conférence, Christophe Rocher est invité à improviser en duo avec l’ingénieur du son Sylvain Thévenard (ces dernières années passé de la pure sonorisation à la création sonore électronique) à partir des relevés de Nicolas Farrugia, selon un processus qui ne donne hélas lieu qu’à un commentaire succint.
Oublier le reste du monde
C’est ce qu’ont fait trois jours durant les musiciens de Nautilis en s’installant sous les caméras de Sylvain Bouttet à la Fiselerie de Rostrenen. D’où ce titre Oublier le reste du Monde pour cet autre documentaire diffusé sur Kub – Culture / Bretagne. Trois jours d’isolement pourtant livrés à notre regard et notre écoute, à commencer par l’arrivée à l’ancien garage Duro, hangar qui accueillit fest noz et match de box, en cours de réhabilitation par l’association La Fiselerie, organisatrice chaque fin août du festival Fisel, du nom de la danse du pays Fisel, territoire qui englobe un quinzaine de commune à l’ouest et au nord de Rostrenen. Témoignage de ce que peuvent être les conditions et les méthodes de travail d’un tel orchestre, Nautilis étant ainsi constitué, du cuivre à la percussion : Sylvain Bardiau, remplacé depuis par Christian Pruvost (trompette), Christophe Rocher (clarinettes soprano et basse), Stéphane Payen (sax alto droit), Christelle Séry (guitare électrique), Céline Rivola (accordéon chromatique clavier boutons), Frédéric B. Briet (contrebasse), Nicolas Pointard (batterie)… et j’allais oublier Claudia Solal (voix) qui est au cœur du projet orchestral “Brain Songs” dont ces trois journées sont les prémisses. Découvrant, alors qu’il étudiait avec Nicolas Farrugia sur les façons dont les différentes zones du cerveau se trouvaient impliquées dans les processus d’improvisation, Rocher avait eu l’occasion d’échanger avec Claudia Solal alors en plein projet d’écriture autour du cerveau. C’est tout naturellement qu’elle fut invitée à produire du texte et donner de la voix dans le projet en cours.

Première journée commençant dans le fracas d’un rideau métallique qui s’ouvre, organisation de l’espace parmi ce qui reste de l’ancien garage, automobiles en état ou vieilles carrosseries, caravanes que l’on redispose à la façon d’un campement… Sur l’espace de jeu que l’on recouvert de tapis, on s’installe en cercle, chacun côte-à-côte ou faisant face à l’autre, bien emmitouflé, écharpes et tricots, la voix de Claudia Solal nimbée d’un discret nuage de buée. On remarque l’absence de Céline Rivoal. Ce soir, on improvise, pour paraphraser Pirandello : improvisation non mesurée, non idiomatique, volontiers bruitiste, Claudia Solal improvisant textes, sons purs timbres, hauteurs, débits… on apprend à s’écouter dans ce nouvel espace, avec cette voix nouvelle.

Deuxième journée : l’accordéon de Céline Rivoal a fait son apparition, ainsi que des partitions. Textes articulés, couleurs sonores, rythmes et cellules mélodiques s’articulant les unes aux autres évoquant déjà ces lacis polyphoniques, parfois se nouant en tutti, qui, à Marseille, les yeux fermés, me laissaient imaginer un orchestre beaucoup plus fourni qu’un simple septette plus voix.

Troisième journée, les partitions ont à nouveau disparu, remplacées par un tirage au sort de petites fiches mélangées dans une passoire métallique : trio Sylvain / Christelle / Stéphane, trio Claudia / Céline / Christophe, duo Frédéric / Nicolas. Dernière séquence, pupitres à nouveau en vue, autour d’un poignant lamento où viendra s’incruster le générique : un film de Sylvain Bouttet avec la complicité de Serge Steyer, réalisateur lui-même directeur général de Kub. Et constamment, au cours de ces trois journées, la maïeutique douce, discrète et tranquille qui caractérise le travail de Christophe Rocher.
A l’Improviste : le concert
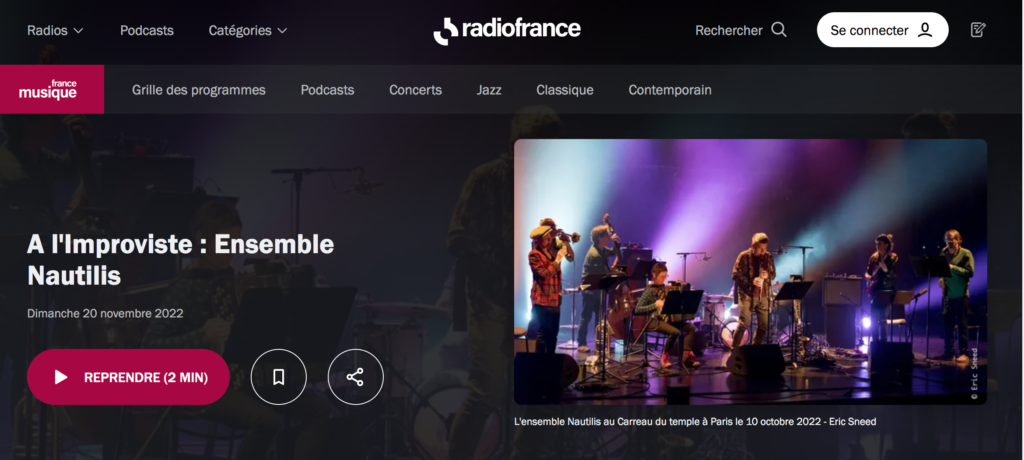
Brain Songs fut créé au printemps 2022 au Théâtre Jean Bart et à L’Estran de Guidel. La page de Kub où figurent les trois journées de travail décrites ci-dessus renvoie sur le site de France Musique à la page du 20 octobre 2022 de l’émission L’improviste d’Anne Montaron où fut diffusé le concert “Brain Songs” du 10 octobre précédent au Carreau du Temple à Paris. J’y retrouve ce que n’ayant su décrire je vous laisse découvrir et m’attarde juste sur les portions d’interview qui ponctuent le concert, notamment celle de Christophe Rocher qui, commentant le nom du groupe, se positionne par rapport à l’expression “non idiomatique” dont j’ai qualifié certaines séquences entendues dans les films mentionnés ci-dessus. Car, avec tout le respect qu’il lui accorde, Rocher ne se réclame pas de cette démarche, sa musique n’étant pas hermétique aux langages musicaux du passé et de l’ailleurs. Également interrogée, Claudia Solal raconte comment sa démarche d’écriture s’est rapprochée de celle des surréalistes, en puisant, en copiant en collant dans un vaste répertoire de textes scientifiques et poétiques, textes et musiques bénéficiant d’une lisibilité plus grande que celle offerte par la sonorisation aux Émouvantes en septembre dernier. Les fans d’André Hodeir ne manqueront pas le final de cette “cantate” qui n’est pas sans évoquer celui de la fameuse “jazz cantata” Anna Livia Purabelle Franck Bergerot
Le trio du saxophoniste Matthieu Donarier est sur les routes de la Bretagne en avant-première de l’Atlantique Jazz Festival. Premiers concerts ces samedi 7 et dimanche 8, à la MJC de Morlaix avec l’Association Get Open, puis à la Grande Boutique de Lagonnet. Avec le guitariste Manu Codjia et le batteur Joe Quitzke.
Il m’est arrivé de dire dans ces pages que pour aller écouter Matthieu Donarier, je ferais des kilomètres. Et j’ai tenu parole ces derniers jours, puisque j’ai quitté Poitiers en train (2 correspondances, certes avec une étape au Pannonica de Nantes pour la version 2.7 de The Bridge initiée par Gilles Coronado) et rallié le Morbihan d’où je me suis rendu en voiture à Morlaix, 3 heures aller-retour dans la soirée hier, et aujourd’hui à Langonnet, 1h15 aller-retour aujourd’hui-même. Certes, comme les jours précédents dans le Poitou, ces déplacements furent ponctués de quelques écarts : un détour avant Morlaix par Lamneur pour visiter la fascinante crypte de l’église Saint-Melar où l’on tient à peine debout parmi ses énormes piliers ornés d’étranges végétaux ; et à Langonnet où, avant de gagner La Grand Boutique, s’impose un passage par l’étrange mélange de genres de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et notamment ses étonnants chapiteaux romans.
Mais venons-en à l’essentiel : le trio de Matthieu Donarier. Bientôt 25 ans que le saxophoniste propose des partitions à Manu Codjia et Joe Quitzke et que ceux-ci s’en emparent, les font leurs, les ajoutant aux précédentes pages de leur cahier. Aussi navigue-t-on de surprises en retrouvailles dans ce répertoire, avec cependant, si l’on fréquente le trio depuis des lustres, le sentiment d’être chez soi, c’est-à-dire bien chez eux. Il y a d’abord ce son de ténor que Donarier fait sonner comme une cloche en ouverture du concert de Morlaix, quelque chose de clair, de franc, de limpide, d’une justesse infaillible ; celle délicatesse avec laquelle il aborde les angularités de Psalm (Paul Motian) comme il le ferait d’une comptine pour accueillir le public de Langonnet ; ces effets de transparence qui nous font deviner dans une introduction vagabonde et a capella la mélodie de Le Temps ne fait rien à l’affaire (Georges Brassens), puis la bravoure avec laquelle il fonce comme la crue d’un torrent à travers les échos harmoniques qui en restent passé l’exposé ; la narquoiserie de ses slaps lorsqu’il lance Le Roi des cons (du même Brassens) sur un tempo de reggae également assumé par ses comparses. Beaucoup d’emprunts, ceux que l’on sait nommer ici, notamment à l’étrange, visionnaire et crépusculaire Nuage gris du dernier Liszt (dont il nous avait déjà offert, non moins fascinante, La Lugubre Gondole), ou à une Gnosienne de Satie.
Lorsque le trio s’attaque à Thelonious Monk avec la pantalonnade de We see, on pense évidemment au fameux Trio de Paul Motian avec Joe Lovano et Bill Frisell, références évidentes pour chacun des trois membres du groupe, et pourtant la comparaison s’oublie vite, tant les trois musiciens ont su prendre leur distance d’avec ce qui n’auraient pu être pour eux que des modèles. Manu Codjia est d’une intériorité impressionnante, concentré sur son admirable travail de voicings, d’énoncé polyphonique où l’on voit sa main se dédoubler entre le pouce dévolu aux lignes de basse et les autres doigts sur les cordes aigües, jusqu’à d’effarants dérapages contrôlés. C’est une attention toute aussi grande qu’il porte aux sons : si sa valise d’effets porte bien mal son nom, rien n’étant ici gratuit, la pédale de volume mérite bien cet autre nom de pédale d’expression. Joe Quitzke est admirable de rigueur dans la plus grande liberté (choix des frappes, choix des sons, choix des volumes, choix des non-dits), toujours “à côté” tout en étant totalement “dedans”, endossant soudain une parfaite partie de chabada aux balais sur Wee See et réinventant la partie de Ben Riley sur les solos. Tout est bon chez eux, il n’y a rien à jeter, et l’on peut s’attacher à la partie de l’un ou l’autre, mais c’est toujours pour mieux entendre l’ensemble tant ces trois musiciens sont solidaires. Et ils le seront plus encore au fil des concerts de cette tournée en avant-première de l’Atlantique Jazz Festival : le 12 au Café Théodore de Trédrez-Loquémeau, le 13 à l’Améthyste de Crozon, le 15 à Run ar Puns de Châteaulin. Franck Bergerot
Deuxième concert de la Saison pour le Pannonica, deuxième concert de la tournée de The Bridge 2.7 réunissant les saxophonistes Molly Jones et Léa Ciechelski, le guitariste Gilles Coronado et le batteur Tim Daisy. Impro totale, work in progress et succès.
Mon projet initial était un séjour dans le Poitou, chez Gérard Teillay, photographe tendre et sans indulgence du handicap et du grand âge, qui photographia le jazz autrefois, “collabora” avec Francis Paudras, et qui vit dans un quadrilatère géographique où vécurent Johnny Griffin, Maurice Vander, Eddy Louiss… et où vit encore le batteur Lolo Bellonzi. Séjour ayant pour but de visiter églises (les étonnants livres d’images que consituent les statuaires de Saint-Hilaire à Melle, de Saint-Nicolas à Civray et Notre Dame La Grande à Poitiers) et sites néolithiques (la Pierre Pèze de Saint-Saviol également appelée Pierre folle, ce qui nous donne à penser que l’entendement se trouve quelque peu défié par l’équilibre de cette table de quelques 30 tonnes sur la fine dentelure de ses trois orthostates aux allures de frêles canines de calcaire ; le site somptueux de Bougon, ses grandioses tumulus et allées couvertes, le calme de son parc, l’élégance et la richesse de son musée) ; et partant de Poitiers après avoir visité ses rues et Notre Dame La Grande, l’idée était donc de prendre le train pour ma maisonnette du Pays Pourlet au nord de Lorient, base de départ pour me rendre dans la journée de ce samedi 7 octobre à Morlaix où le Trio de Matthieu Donarier, Manu Codjia et Joe Quitzke est attendu à la MJC de Morlaix en avant-première de l’Atlantique Jazz Festival. Mission impossible, sauf à repasser par Paris ce qui me paraissait totalement déraisonnable. Observant que la seule solution, moyennant deux correspondances, consistait à passer par Nantes, je consultai l’affiche de ce vendredi 6 octobre du Pannonica ? Et j’y trouvai une occasion d’y entendre, dans sa dernière version 2.7, The Bridge, dispositif orchestral qui a ses habitudes au Pannonica.

Je débarquai donc hier soir à Nantes, après une escale à Saint-Pierre-des-Corps pour prendre un train en provenance de Lyon Perrache qu’avait peut-être emprunté les musiciens de ce Bridge 2.7 gagnant la côte Ouest après leur premier concert au Périscope du 3 octobre.
On connaît le principe de The Bridge lancé en 2013 par le chercheur et universitaire Alexandre Pierrepont : mettre en contact les musiciens français avec l’un des principaux foyers de créativité de la musique afro-américaine, la scène chicagoane telle qu’elle a grandi depuis la création de l’AACM il y a près de 60 ans ; et constituer un orchestre pour une série de concerts de part et d’autre de l’Atlantique. Concert précédé hier d’un échange animé par l’homme de radio Henri Landré avec Alexandre Pierrepont, Tim Daisy et Gilles Coronado.

On y découvre l’histoire dramatique de cette édition 2.7 de The Bridge. Comment – ainsi que cela se produit en amont de chaque édition de The Bridge – Gilles Coronado se vit proposer de choisir parmi deux listes de 35 musiciens américains et 35 français. Comment son choix s’arrêta sur la trompettiste Jaimie Branch, non sans quelque appréhension, mais avec une réelle sympathie pour ce personnage et cette musique farouche. Comment il choisit également le saxophoniste Isaiah Collier pour imprimer à cette front line qui n’en serait pas une quelque gènes de cette Great Black Music grandie à Chicago. Il raconte encore comment il choisit Tim Daisy pour batteur et comment se déroulèrent les premiers concerts Outre-Atlantique et la séance d’enregistrement à l’Experimental Sound Studio. Et Tim Daisy d’expliquer à son tour combien ce studio est exigu, inconfortable, et combien, en dépit de cet inconfort, le groupe s’y trouva à son aise et y produisit d’emblée une authentique narration sonore, totalement organique. Réalité que je découvre en rédigeant ces lignes le casque sur les oreilles avec, glissé dans mon lecteur de CD externe, l’album “Stembells” qui en résulte sur le label de The Bridge www.acrossthebriges.org, et sa plage unique de 37’24 d’improvisation.
Nous étions alors en avril 2022 et, hélas, née le 17 juin 1983, Jaimie Branch devait mourir le 22 août. Aussi, Henri Landré nous fit-il entendre le témoignage de Scottie McNiece (co-fondateur du label International Anthem), concernant Jaimie Branch, puis, diffusa sur le système de sonorisation du Pannonica, un enregistrement de la trompettiste : une poignante fanfare funèbre de trois trompettes en re-recording en écho à laquelle se mit bientôt à flotter une sorte de traine sonore, d’abord frêle comme du tulle puis de plus en plus organique, non comme un parasitage externe, mais – pour reprendre la métaphore utilisée par Scottie McNiece – comme un zoom sur la matière sonore de la trompette de Branch, métaphore qu’il m’est souvent arrivé d’utiliser pour décrire des musiques telle celle d’Evan Parker pouvant se rapporter à celle de John Coltrane, comme certaines œuvres picturales contemporaines paraissent être le résultat d’une observation à la loupe, voire au microscope, de certains détails des œuvres de Rembrand ou de Turner.
Jaimie Branch disparu et, de surcroît, Isaiah Collier indisponible, il fallut pour la phase française de l’opération réimaginer une distribution. Ce serait les deux saxophonistes : Molly Jones de Chicago habituée des transgressions entre jazz, musiques du monde, musique de chambre et expérimentations sonores électroniques (sax ténor, flûte) et Léa Ciechelski (sax alto, flûte) qui nous avait déjà fait forte impression avec Big Fish (Julien Soro, Gabriel Midon et Ariel Tessier) ainsi qu’avec l’ONJ de Fred Maurin.
Comment se fit la collusion de ce quartette qui a joué sa première deux jours auparavant au Périscope de Lyon et comment ont-ils mis à profit leur séjour nantais pour se préparer au concert de ce soir ? La réponse me sera donné après le concert au bar du Pannonica par Alexandre Pierrepont et Gilles Coronado qui résume ainsi : « On s’est parlé, on s’est promené, on a été voir la mer, on a mangé et bu ensemble, on s’est marré, on a appris à se connaître. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir improviser ensemble. » Ainsi est né, après “Stembells”, ce nouveau quartette baptisé “Cloud Hidden”, expression empruntée aux carnets de notes de Jaimie Branch.

Comment sont-ils entrés dans ce qui allait constituer ces trois quarts d’heure d’improvisation, je ne saurais plus le dire, mais on pourrait affirmer qu’ils ont commencé par s’écouter et c’est cette qualité d’écoute qui servi de colonne vertébrale à leur improvisation, chacun prenant connaissance de la proposition de l’autre dans l’ostinato, le pianissimo ou le silence, cette qualité d’écoute qui fut un peu la marque de musiques improvisées à Chicago depuis l’émergence de l’AACM et de l’Art Ensemble par comparaison aux urgences et aux plénitudes du free jazz new-yorkais et qui fut revendiquée par la génération dite des “Loft” dans les seventies soucieuse de concilier l’héritage lyrique d’Albert Ayler avec le souci mingusien des dynamiques sonores et structurelles.
Ainsi tandis que l’une des soufflantes pourra filer d’amples phrases mélodiques, de délicates nappes sonores ou de furieux bourdonnements, l’autre viendra s’y glisser dans les manques par petites touches pour y donner du relief ou/et apprivoiser ce qui naît à son côté jusqu’à pouvoir s’y joindre, s’en faire complice dans des jeux de contrepoint. Sur le flux modulé de la batterie d’où résulte des tempos plus évoqués que formulés, pulsés plutôt que mesurés, Coronado assume un héritage instrumental de stimulus orchestral, de l’antique pompe aux “cocottes” du funk, en passant par les martèlements rythmiques du hard rock, l’énervement du punk et les nappes hendrixiennes, rôle d’accompagnement, d’écoute, d’adhésion, voire de fusion aux propos venus de ce qui n’est pas une front line, mais une sorte de “side line”, les deux soufflantes étant disposées de façon à lui faire face, jusqu’à s’emparer du premier plan du discours derrière lequel les deux comparses s’effacent, dans lequel elles glissent ou plantent leurs flèches musicales, auquel elles se joignent au contraire dans de prodigieux crescendo collectif. Comme il recommandé par les grands metteurs en scène au théâtre, chacun n’est pas là pour jouer son rôle, mais pour jouer la situation et, alors que nous vient cette image, la musique retombe d’un paroxysme jusqu’à son extinction naturelle.
Applaudissements nourris. Rappel ? Rappel évidemment, et ce n’est pas ici le public qui décide mais les musiciens. C’était trop bien, retournons y de suite pendant que c’est chaud, voir si l’on peut aller un peu plus loin encore. L’un après l’autre chacun se jette à l’eau, y trempe l’orteil, jusqu’à la taille, puis s’immerge entièrement dans un espèce de tutti polyphonique ascendant parcouru de décharges électriques rappelant ces petits orages qui se multiplient lors des manœuvres de tramways dans les terminaux. Puis, comme électrocutée, la tension s’effondre et de l’alto s’élève un arpège modulant autour duquel les autres voix se tissent l’une à l’autre le temps d’un petit nocturne orchestral crescendo decrescendo que la guitare conclura en plaquant l’accord de guitare résolvant cet arpège, mais d’un résolution se refusant à toute solennité, une touche d’autodérision, moins un point final qu’un point-virgule, voire un point de suspension. Comme pour dire « à demain, chez Jean-Luc Capozzo », le trompettiste chez qui ils seront ce soir pour un concert “chez l’habitant”, puis le 8 à la Maison Max Ernst à Huismes, le 9 au Petit Faucheux à Tours, le 10 à Jazzdor à Strasbourg (avec Emilie Lesbros en invitée), le 12 à Poitiers au Confort moderne, le 13 au Cirque électrique à Paris, la guitariste Tatiana Paris pouvant s’ajouter (Tours et Paris) ou se substituer (Strasbourg et Paris) à Léa Ciechelski.
Tandis que mon train roule vers Lorient d’où – bus, puis voiture – je monterai vers Morlaix pour retrouver le Matthieu Donarier Trio, je tire de ma valise le recueil “dits et maximes” de James Joyce dans la collection ainsi parlait chez Arfuyen (« abordons Joyce, non par le côté savant, écrit l’éditeur et préfacier Mathieu Jung, mais par le versant du plaisir, le nom de joyce touchant lui-même à joie. ») et je lis ceci: « Ulysse, je l’ai fait avec des riens. “Work in Progess” [état premier de Finnegans Wake], je le fais avec rien. Mais il y a des coups de tonnerre. » Faute d’imagination pour titrer ce compte rendu, j’en tirerai cette métaphore qui pourrait correspondre à certains moments de ce concert. Franck Bergerot
Prochains temps forts au Pannonica: “Finis Terrae” de Vincent Courtois le 13 octobre, Edward Trio le 17, David Chevallier / Sébastien Boisseau le 27. Pensez-y si vous souhaitez vous rendre par le train de Poitiers en Bretagne sans passer par Paris.
Du fait de quelques obligations récréatives et professionnelles, voici avec presque une semaine de retard le compte-rendu de la dernière soirée du festival marseillais Les Émouvantes programmé par Claude Tchamitchian. Avec le duo de Louis Sclavis et Keyvan Chemirani, et l’Ensemble Nautilis dirigé par Christophe Rocher dans son programme Brain Songs.
Un musicien installé à mes côtés, lors du concert de 18h de la 2ème journée du festival Les Émouvantes, me faisait part de son admiration pour le trio Suzanne que nous avions entendu la veille – qualité de l’exécution instrumentale et vocale, des trames orchestrales et des modes de jeu entre improvisation et écriture. Il exprimait cependant une certaine réserve face à une versatilité esthétique constante. Et si j’ai pu constater cette même versatilité à l’écoute de nombreux groupes apparus au cours de ces dernières années et pour m’en réjouir en admirant la multiplicité des compétences sur lesquelles elles reposaient, il m’est parfois arrivé d’éprouver cette même réserve jusqu’au malaise. Rien à voir avec les hybridations conflictuelles à portée satyrique chez Frank Zappa, ni avec les effarants zappings zorniens. Plutôt le fait de générations surinformées par des moyens de communication illimités, et une précise étude sociologique nous permettrait d’entrevoir comment cette surinformation opère selon les classes sociale et les structures éducatives fréquentées. On peut s’inquiéter d’une sorte d’identité atone ou se réjouir de ce qui résulte de cette instabilité esthétique qui permet à tel musicien de quitter un orchestre baroque pour rejoindre un groupe de hip hop ou de trash metal, voire de passer de l’un à l’autre à l’intérieur d’un même programme ; et l’appréciation critique, se fera au cas par cas, comme le fit notre musicien témoin qui une heure plus tard applaudissait à tout rompe la prestation du duo Super Klang témoignant d’une même capacité à « passer par cheminées et placards » comme les personnages de carnaval dans la Tarentelle de Caruso de Charles Trenet.
Mais ces phénomènes d’hybridation sont-ils si récents ? Ils ont été l’œuvre de manière plus ou moins étendue depuis les origines du jazz, mais ils ont pris des dimensions considérables avec les générations Michel Portal et Louis Sclavis, incitant à des allers et venues toujours plus amples et rapides. C’est justement Sclavis qui, en duo avec Keyvan Chemirani, ouvrait la soirée de clôture des Émouvantes ce 23 septembre. Mais le concernant, je parlerais moins d’instabilité esthétique – phénomène accentué chez Suzanne par le contraste sans transition entre la teneur salée-poivrée des passages les plus abstraits et le sucré des chœurs pop-folk, – que d’hybridation totale et réussie, même si l’on identifie ici et là les sources de son folklore imaginaire, comme des arômes diffus se mêlant au seuil de la cuisine d’un grand chef. S’y mêlent mille traces de folklores européens, méditerranéens et orientaux à des gestes hérités de Dolphy ou Giuffre, de Stravinsky ou Scelsi, qui peuvent parfois se laisser identifier mais parfaitement fondue dans des programmes d’une cohérence parfaite et d’une rigueur presque ascétique dans la précise texture où se trament écriture et improvisation.
Parenthèse polémique
Certes – autorisons nous ici une petite parenthèse qui n’est pas sans gravité –, on pouvait s’agacer de voir Sclavis jouer à guichets fermés lorsque les autres concerts de ce même festival peinaient à combler la petite salle offerte par le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (avec la bénédiction de son directeur, le saxophoniste Raphaël Imbert). Mais on peut aussi se dire que, par-delà cette sorte d’atavisme des publics à sélectionner, parmi l’offre esthétique toujours plus riche, une ou quelques stars autour desquelles faire foule, ces générations qui eurent le loisir de connaître le travail de Sclavis et ses pairs par la presse et les médias radiophoniques, sont coupées, depuis une bonne vingtaine d’années et de façon toujours plus dramatique, de toute information concernant les renouveaux successifs et réels de la scène jazz ; tant il est vrai que ces radios nationales ont exclus le jazz et, de manière générale, les musiques instrumentales. À l’exception de France Musique assigné à un rôle de ghetto et désormais soumis à de sévères impératifs de bonne humeur et de consensualité. Ailleurs, pour être admise sur les ondes radiophoniques les musiques se doivent d’être clairement scandées d’une battue sur tous les temps dans les formats mélodiques restreints du couplet-refrain, obéir à de stricts critères de consonance et être asservies à un texte qu’il soit chanté ou rappé-slammé. Diffusé gratuitement à l’accueil des Émouvantes, le numéro 44 de juin dernier de Les Allumés du jazz a inscrit à son sommaire un article assez réaliste sur les dérives du Centre national de la musique et les ambiguïtés du terme « LA filière musicale » pour laquelle, dans un rapport commandé par Élisabeth Borne, le sénateur Julien Bargeton rêve d’une « stratégie offensive » sur le modèle de la K-pop par la Corée du Sud. Peut-être qu’un jour, pour définir ce que doit être la musique, Julien Bargeton et les penseurs de « la filière musicale » s’inspireront des dix règles émises par un Gauleiter nazi pendant l’occupation de la Hongrie – rapportées par l’écrivain tchèque Josef Škvorecký dans Le Saxophone basse – qui réglementent le pourcentage de syncope, la longueur des breaks de batterie, les tempos, l’interdiction des trompettes et des saxophones, etc.

Illustration: Copuli-Copula © X.Deher (Fictional Cover)
Retour à Sclavis et Chemirani
Mais revenons à notre sujet et réjouissons-nous de ce que Louis Sclavis ait contribué à faire progresser le budget des Émouvantes vers l’équilibre avec un programme au-dessus de tout soupçon de démagogie. D’autant plus que, abordant ce concert sans aucun doute sur sa qualité ni sur la droiture de son intention artistique, je me suis une fois de plus laissé surprendre par l’onirisme des idées musicales et de leur “scénographie” que le public commente à la sortie du concert, chacun en comparant les images qui l’ont habité ; moi par cette nuée que j’ai évidemment vu grandir à l’écoute de Dresseur de nuages jusqu’à explosion d’un orage, ou ces oiseaux que j’ai entendu en ouverture de Les Saisons du Delta. À son côté, Keyvan Chemirani est de ceux qui savent aussi susciter le rêve. À l’unisson, en contrepoint, en commentaires ou répliques aux improvisations de son comparse, il fait crépiter les rêves de Sclavis sur les peaux du zarb ou de grands tambours sur cadre, s’emparant soudain de la dimension mélodique en quittant les peaux pour les cordes d’un petit cymbalum sur une composition de son cru. Et lorsque Sclavis retire le bec de sa clarinette, il est difficile de ne pas penser à ces voix que Barney Wilen avait autrefois copiées-collées sur son album « Moshi » à partir de l’un de ces disques de collectage Ocora qui nourrirent le folklore imaginaire des improvisateurs dans les années 1970.
Les Brain Songs de l’Ensemble Nautilis
La deuxième partie de la soirée consacrée à l’Ensemble Nautilis était une autre affaire. Commençons par énoncer le personnel : Claudia Solal (chant et textes), Christian Pruvost (trompette), Christophe Rocher (clarinette, composition), Stéphane Payen (sax alto), Marc Ducret (guitare électrique), Céline Rivoal (accordéon), Fred B. Briet (contrebasse), Nicolas Pointard (batterie) et… hé bien c’est tout ? J’aurais cru qu’ils étaient deux fois plus nombreux.

Illustration: Perceptron arachnéide © X.Deher (Fictional Cover)
L’Ensemble Nautilis est né en 2011 en Bretagne sur l’initiative de Christophe Rocher et autour d’un noyau dur – Rocher, Rivoal, Briet, Pointard –, et a élargi son périmètre de recrutement. Demandeur de rencontres et collaborations extérieures, la formation a engagé un travail de réflexion avec le chercheur Nicolas Farrugia sur l’échange de sensations qui circulent entre les musiciens et leur public, les partitions qui ont été soumises aux musiciens par Christophe Rocher ayant été confiées à Claudia Solal pour la rédaction d’un livret qu’elle interprète entre aria et récitatif. Pour qui connaît le travail de Claudia Solal notamment en duo avec Benjamin Moussay, on l’imagine incarnant la circulation même de ces flux de sensations qui relient les cerveaux stimulés par une œuvre musicale qu’ils la mettent en œuvre ou qu’ils l’écoutent, excitant cette corde sensible, ou plus exactement ce réseau de fils ténus, fragiles, où se jouent drames et jubilations. Et l’orchestre réagit en mille échos au stimuli de ce texte, passé les épisodes de limpidité vocale évoquant l’école de Canterburry et/ou de projections improvisées solitaires, les tutti explosent comme un plat en pyrex, se disperse en mille éclats qui se rassemblent comme balayés par l’écriture ; et nos cerveaux se brisent et jubilent avec eux, la cohésion du tout reposant sur la décontraction du tandem Briet-Pointard. On pourrait faire remarquer une sonorisation un peu problématique et se demander même si elle est nécessaire et s’il ne faudrait pas la réduire au stricte minimum, un peu comme le faisait Charles Caratini avec le Caratini Jazz Ensemble, afin de mieux faire ressortir la profusion plutôt que le magma. Et l’on imagine un accordéon plus strictement monodique dans ces tutti, avec un registre plus limpide.
C’est Marc Ducret qui ouvre en solo le rappel. Non guest star, mais remplaçant de la titulaire, Christelle Séry, il a étudié et assimilé en rien de temps les partitions, avec la rigueur qu’on lui connaît et en a assumé les difficultés sans se faire remarquer. Et il emmène désormais ce concert vers sa fin et vers la fin du festival comme s’il avait toujours joué dans cet orchestre qu’il nous tarde cependant d’entendre avec sa vraie guitariste et au-delà de cette première impression frontale, à la lumière des captations audio ou vidéo qui apportent sur internet une lisibilité plus grande de passionnant tissu sonore. Franck Bergerot
Deuxième journée du festival organisé par Claude Tchamitchian, avec hier 22 septembre la création du Transatlantic 4 imaginé par Sylvain Kassap et Benjamin Duboc, après la prestation de Super Klang.
Super Klang… quésaco ? Un drôle de duo qui fait « Klang » et beaucoup d’autres sons, constitué de Frédéric Aurier (violon, nyckelharpa, klang, pfff, etc.) et Sylvain Lemêtre (zarb, klang, tssst, etc.). Nous les avions déjà rencontrés dans ces pages, le 7 mai 2011, à la même affiche que le trio de Matthieu Donarier*. Ils étaient les deux partenaires du violoneux et conteur auvergnat Jean-François Vrod dans un “concert conté” étourdissant titré La Soustraction des fleurs. Puis nous avions retrouvé Sylvain Lemêtre dans Tower Bridge de Marc Ducret en 2012 à Reims, dans Printemps de Sylvaine Hélary en 2013 à Paris à l’Atelier du Plateau. Frédéric Aurier était quant à lui réapparu dans ces pages en 2022 à l’occasion du concert de Marc Ducret et du Quatuor Bela à l’Underground de l’Opéra de Lyon où nous nous étions souvenu de sa familiarité avec la musique traditionnelle auvergnate et avions remarqué qu’il était le seul du quatuor à improviser.

Illustration: Mouchette © X.Deher (Fictional Cover)
C’est cependant par une partition que débuta le concert, partition de frappes à l’origine, Lemêtre l’ayant d’abord écrite pour le zarb avant d’y ajouter des hauteurs de note pour le violon, unisson exigeant une précision diabolique tant ses contours sont virtuoses, intitulée Bonsoir en ouverture du concert et, moyennant quelque variante, Au revoir fin de programme. Avec quelque chose évoquant le côté ludique de la troisième des trois pièces pour clarinette solo d’Igor Stravinsky ou Joyce composé par Peter Eötvös pour le même instrument. La lecture et l’improvisation seront en concurrence tout au long de ce programme réglé justement comme du papier à musique où l’on voit Lemêtre quitter le zarb au premier plan pour disparaître derrière un capharnaüm de percussions et idiophones en tous genre, de ceux que l’on trouve au magasin de musique comme aux rayons ustensiles et bricolage, dont une petite table de cuisine où durant tout le concert Lemêtre passera son temps à « mettre et remettre la table », disposant, échangeant, redisposant bols et assiettes en divers matériaux.
Dans Trois Totems, oscillant entre mémoire auvergnate et abstractions sonores, les thèmes et variations du violon dialoguent avec un délicate polyrythmie déployée autour de trois percussions graves « enclavées » l’un à l’autre qui nous incitent à scruter le dispositif du percussionniste à la recherche de quelque séquenceur jusqu’à ce que l’on se rende à l’évidence de ce que ces frappes sont trop humaines pour avoir été programmées en boucle et que l’on découvre dans l’obscurité sous la table – un toile tendue sur cadre qui est elle-même percussion – un diabolique jeu de pieds actionnant un ingénieux montage de pédales actionnant grosse caisse, cajon et autres calebasses.
Tout relève dans leur déplacement d’une précise mise en scène, chaque nouveau morceau nécessitant de redisposer l’espace des percussions, temps mort durant lesquels le percussionniste lance quelque automatisme naturel, laissant descendre un boulot le long d’une longue tige fileté dressée devant sa table ou lançant un jeu de balles pendulaires, distribuant enfin quelques frappes éparse au fil de son installation. Aurier n’est pas en reste qui use du violon avec des gestes de violoneux imaginaire et d’interprète de Bartók et Ligeti, remplaçant l’instrument ici et là par la vièle à archet suédoise, le nyckelharpa, dont il explique que si l’on laisse un violon alto à proximité d’une vielle à roue par une nuit sans lune et il probable que l’on trouve au petit matin un nyckelharpa.
On retrouve là l’esprit de La Soustraction des fleurs, l’humour et le théâtre étant au rendez-vous, également millimétré et pince sans rire, avec quelque chose qui tient de la rencontre entre le clown Grock et Maurizio Kagel. Et si l’on invoque ici le monde de la musique contemporaine, on se souvient des propos de Barre Phillips dans un ancien numéro de Les Allumés de jazz où le contrebassiste s’était lassé de faire des scratch et de pouing sur l’injonction d’un compositeur tout puissant et que, des scratch et des pouing l’instrumentiste était bien capable de les improviser tout seul ou avec ses copains. Et nos deux Super Klang de mêler à leur coups d’archet et de cymbales digitales, à leurs pizzicati et à leur flexatone des tsssst et des pffff produit d’entre leurs lèvres. Vous avez dit « chiant » ? Triomphe à l’applaudimètre de 7 à 77 ans.

Illustration: Bon voyage © X.Deher (Fictional Cover)
Rien des univers évoqués ci-dessous ne sont étrangers au clarinettiste Sylvain Kassap qui éprouvait cependant le besoin d’une sorte de réancrage dans la tradition afro-américaine telle qu’elle a engendré le free jazz et ses dérivés et telle qu’il a pu la fréquenter à travers une relation suivie avec le batteur Hamid Drake. D’où ce Transatlantic 4 dont Les Émouvantes accueillaient la création. Pour ce faire, il garde à ses côtés un complice de longue date, Benjamin Duboc, contrebassiste combinaison solidité et esprit libertaire et lui adjoint en partenaire de rythmique le batteur Chad Taylor, Chicagoan familier des aventures de Rob Mazurek, Jeff Parker, Fred Anderson, Nicole Mitchell et du tromboniste Steve Swell. On avait fait connaissance avec ce dernier aux Banlieues Bleues au siècle dernier au sein d’un explosif trio l’associant à Ellery Eskelin et Joey Baron. Depuis, il est devenu un tromboniste plébiscité par ses confrères comme par presse qui salua en 2018 sa « Music for Six Musicians : Homage à Olivier Messiaen. Soit un pari prometteur entre improvisation free et partitions sous forme de parcours fléchés, quartette hier encore trop frais pour susciter un commentaire éclairé, au-delà d’évidentes qualités individuelles; à moins que la fatigue n’ait joué quelque tour à mon niveau d’attention. Après tout le concert de son Sextette “Octobres” m’avait laissé muet lors de sa création à D’jazz Nevers en novembre 2021, mais m’avait enchanté l’année suivante lors de la sortie sur disque du même programme. À suivre “in progress”, le 29 à Cherbourg.
Ce soir, encore des clarinettes : à 19h le duo de Louis Sclavis et Keyvan Chemirani ; à 20h l’Ensemble Nautilis, formation à géométrie variable opérant à partir Brest et animée avec clairvoyance et détermination par Christophe Rocher, avec : Claudia Solal, Christian Pruvost, Stéphane Payen, Céline Rivoal, Marc Ducret, Fred B. Briet et Nicolas Pointard. Franck Bergerot
* Le trio de Matthieu Donarier (vingt ans et quelques au compteur avec Manu Codjia et Joe Quitzke) tournera en Bretagne en avant-première de l’Atlantique Jazz Festival du 7 au 14 octobre : le 7 à Morlaix, le 8 à Langonnet, le 12 à Trédrez-Locquémeau, le 13 à Crozon, le 15 à Châteaulin.
Retour au Émouvantes, le festival du contrebassiste Claude Tchamitchian. Avec deux trios Suzanne et Poetic Power du maître de céans en compagnie de Christophe Monniot et Éric Échampard.
On finit toujours par prendre des habitudes. Avec les artistes comme avec les lieux. Partialité ? Copinage ? Affinité plutôt avec une certaine conception de la musique, de l’audace et du son, de la proximité des peaux, des métaux, du bois, de l’anche et des tampons, et des êtres qui les commandent, dans un rapport au silence et à l’espace, éventuellement soutenu par un sonorisateur qui se fait oublier, lui et ses haut-parleurs, hier au son Matteo Fontaine crédité pour la durée du festival dans le programme imprimé. Avec toute la délicatesse que mérite le trio Suzanne, son violon alto (Maëlle Desbrosses), sa clarinette basse (Hélène Duret), sa guitare acoustique (Pierre Tereygeol) et des voix (toutes trois).

Déjà rendu compte de ce programme il y aura bientôt un an, à Nevers. Comment ne pas se répéter ou paraphraser les confrères et consœurs dont les écrits circulent abondants à leur propos. Il y a quelque chose de littéraire dans cette musique qui inspire la plume ou l’intimide lorsque l’on s’y réessaie de peur de courir les clichés qu’elle ne mérite pas. Pop, folk, polyphonies de la Renaissance, musique de chambre classique et “contemporaine”… tous trois circulent dans ces cultures avec aisance, sans effet de collage, parce qu’il ne s’agit plus d’emprunts mais d’une culture contemporaine, commune, cohérente, authentiquement métissée, avec ce goût du son et des matières qui le produisent évoqué plus haut. On part de Leonard Cohen auquel le nom du Trio rend hommage à Frank Zappa (le Frank du morceau final, Where Is Frank, compositeur de musique de chambre, voir l’album tardif “Yellow Shark”) ; et s’il y avait quelque chose à ajouter à mon compte rendu de Nevers sur le même programme, c’est la fluidité acquise depuis qui fait s’estomper la partition (en majorité de la plume du guitariste) derrière le geste improvisé, dans une conception du rapport écriture-improvisation où la césure s’efface, où l’une et l’autre s’envahissent l’une l’autre, où l’élément thématique se fond d’autant plus dans le récit musical qu’il n’est pas un prétexte et cadre mesuré bridant l’improvisation, faisant l’objet d’une exposé mélodique réexposé en conclusion ; au lieu de quoi, il sert de fluide à un développement continu qui emporte l’auditeur. Comme il emportera le public parisien, le 6 octobre, en ouverture du festival Jazz sur Seine, au 38 Riv’, avec Émile Parisien, l’invité de leur nouveau disque “Travel Blind” dont ils célébreront la sortie.
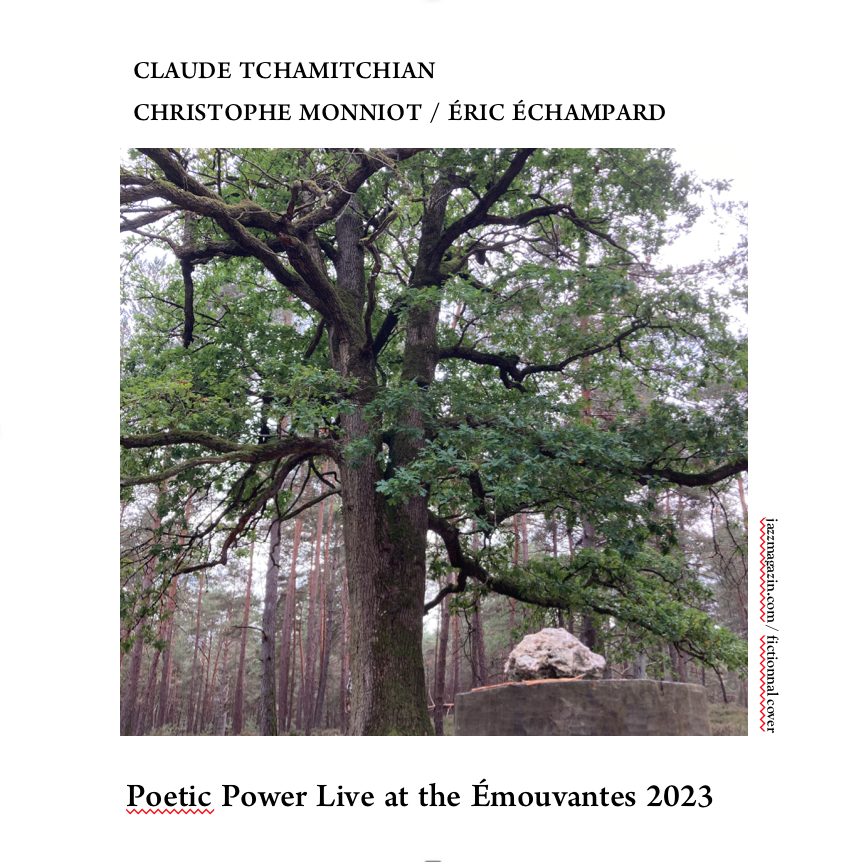
Ce rapport au son et à la proximité a toujours fait partie des préoccupations de Claude Tchamitchian, tant dans son métier de contrebassiste que dans celui de compositeur, de producteur (label Émouvance) ou de programmateur (ce festival Les Émouvantes désormais accueilli par le Conservatoire de Marseille). Plus une préoccupation pour le récit auquel il aime donner un sens et offrir à son public une clé d’entrée : pour ce nouveau programme “Poetic Power”, la vision offerte par la nature d’une « multitude d’éléments qui interagissent les uns avec les autres », éléments, espèces végétales ou animales, sa contrebasse assurant l’enracinement de cet arbre orchestral dont Éric Échampard (batterie) serait le tronc et Christophe Monniot la ramure.
Et il faut dire que, là-haut, ça bouge follement, les branches dansent et se tordent sous le souffle impatient du saxophoniste qui s’aide de différentes pédales parfois utilisées à contre-emploi pour exprimer ce qui l’agite. Dans sa hâte, il lui arrive de s’interrompre comme pour se repasser ce qu’il vient de jouer et décider comment il va poursuivre, ou de se tourner vers ses comparses comme pour les prendre à témoin de ses émois. Le tronc assuré par Échampard est parfois jeune et tendre, comme dans cette grande introduction toute en souplesse et décontraction, où il semble tester le son de ses peaux et cymbales et en éprouver la sensibilité, mais toujours avec ce sens de l’architecture rythmique et timbrale qui fait son art ; et tantôt il gagne en puissance et en fermeté, et c’est toute une culture rock qui ressurgit. Alors Tchamitchian fait monter des grooves puissants des racines de sa contrebasse, voire une colère qui inspire à Monniot des effets de pédales cauchemardesques lorsque Les Combats Inutiles rend un hommage désespéré aux Arméniens du Haut-Karabarkh. Mais la contrebasse sait aussi ramener l’orchestre à l’art de la complainte qui inspire à Monniot de prodigieux et lents épanchements où la batterie ne se fait plus que feuillage.
Ce soir 22 septembre, les Émouvantes continuent d’émouvoir avec le duo du violoniste Frédéric Aurier du percussionniste Sylvain Lemêtre, et le Transatlantic 4 de Sylvain Kassap (clarinettes) et Benjamin Duboc (contrebasse) invitant Steve Swell (trombone) et Chad Taylor (batterie). Franck Bergerot
En 1969, deux labels européens indépendants naissaient en Allemagne, sur des territoires esthétiques d’abord pas très éloignés qui tendront à diversifier leurs points de vue sur la carte du jazz post-sixties, le développement de leurs acronymes disant déjà quelque peu leurs différences : ECM (Edition of Contemporary Music) créé par Manfred Eicher et FMP (Free Music Production) créé par Jost Gebers. Le lecteur de Jazz Magazine connaît forcément quelque nom de l’immense catalogue ECM de quelque côté qu’on l’aborde. Il connaît aujourd’hui plus rarement celui de FMP. Un test, que ceux qui connaissent les noms suivants lèvent la main : Manfred Schoof, Peter Brötzman, Alexander von Schlippenbach, Peter Kowald, Globe Unity Orchestra, Willem Breuker, Han Bennink, Fred Van Hove, Sven Åke-Svensson, Rudiger Carl, Ulrich Gumpert, Hans Reichel, Irene Schweizer… parmi lesquels on reconnaîtra aussi quelques Américains expatriés ou non (de Steve Lacy à Cecil Taylor ou Sam Rivers). Jost Gebers est mort le 15 septembre dernier. Jean Rochard qui fait, à sa façon, ce même métier de producteur phonographique, lui rend hommage sur son Glob. Franck Bergerot
Hier, 16 septembre, à La Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois dans le cadre de Musiques au Comptoir, le violoncelle de Vincent Courtois et les anches de Robin Fincker et Daniel Erdmann nous ont tenu hors d’haleine.
Je trouve ce matin un mail envoyé tard dans la nuit par l’amie que j’ai entrainée hier soir à ce concert : « J’ai écouté d’autres de leurs CD, j’ai l’impression qu’ils n’ont jamais été aussi bons que ce soir ! » Charme particulier du concert, de la présence réelle, ou réalité ? Il y aurait-il des extrémités indépassables ?
Aléas de la circulation automobile, nous étions arrivés le concert commencé. Entrés dans le noir sur la pointe des pieds presque à tâtons, assis sur les premières chaises se présentant à nous sur le côté de la scène, et comme projetés dans la musique qu’ils sont en train d’inventer tous trois – Vincent Courtois (violoncelle), Robin Fincker (clarinette et saxophone ténor), Daniel Erdmann (saxophone ténor). Ils marchent pas à pas l’un vers l’autre dans une approche indéfiniment recommencée, non qu’ils ne parviennent à se trouver, mais refusant le kitsch de la sainte communion qui serait l’achèvement de leur progression et exigerait quelque tombée de rideau, leur rapprochement constamment recommencé et régulièrement remis en cause, leur improvisation constamment au travail, les inventions individuelles constamment à l’écoute des autres dans une attention réciproque qui, les faisant constamment réinventer leurs cheminements, les font, sinon se fuir, du moins s’éviter.
Voici 12 ans qu’ils arpentent ainsi les scènes, d’abord sur des partitions noires sur blanc, des programmes d’improvisation précisément balisés, aux ouvertures de plus en plus larges au fur et à mesure qu’ils apprenaient à se connaître et à partager leurs habitudes, les possibilités qu’ils se donnaient et les impossibilités rencontrées constituant de nouveaux défis, de nouveaux paris. Il y a deux ans, je commentais ce même trio entendu à Lyon, sur le répertoire que leur avait inspiré le roman Martin Eden de Jack London, mon écoute et mon commentaire partiellement embarrassés par la référence à cette œuvre littéraire qui m’était inconnue, et cependant émerveillé par la souplesse de cette écriture chambriste dont les partitions semblaient non plus lues, ni même sues, mais rêvées ; l’an dernier à Marseille (au festival Émouvances où je serai de retour jeudi prochain), ayant lu entre temps Martin Eden et ainsi délivré de cet embarras, je redécouvrais la musique du trio elle-même déliée de son propos initial. Les partitions avaient-elles été déjà définitivement oubliées ?
Un an plus tard, on n’en trouve plus trace, sinon la connaissance réciproque qu’ils en ont gardée, l’acuité qu’ils ont l’un de l’autre, un sens de l’anticipation, et lorsque cette aptitude s’est laissée surprendre par quelque inattendu, la faculté de faire d’une fausse route la voie royale. C’est une question mélodique, harmonique, rythmique, mais aussi orchestrale, de son, de timbres, de densité, d’intensité, de nuance, de contraste… Courtois allant de l’archet au pizzicato avec une grâce de soliste classique passant d’étude en partita, de suite en sequenza, les deux saxophones contrastant leurs discours, Daniel Erdman dans l’estompe de la mémoire du saxophone velu de Lockjaw Davis à Archie Shepp, Robin Fincker plus dans le velours de la clarinette au ténor (on pense à Jimmy Giuffre), griffant cependant ici et là la trame orchestrale de sonorités slappées, percutées, soufflées, growlées. Il y a du minimalisme dans cette musique, mais sans le systématisme de la répétition, les ostinatos de l’un constamment remis en cause par les propositions des comparses, avec en outre quelque chose de chorégraphique tant dans leur présence sonore (idéale telle que discrètement sonorisée dans l’acoustique habillée de l’ancienne halle Roublot) que scénique tant leur musique est visuellement habitée.
Nous étions arrivés en retard, espérant n’avoir que manqué que le premier morceau. Il n’y avait qu’un morceau (plus un rappel d’apparence plus écrite). « Je pars d’un point et je vais le plus loin possible » disait John Coltrane. La musique du trio s’est ainsi déployée d’un point au plus éloigné qu’il leur soit possible d’atteindre en un seul grand mouvement continu, laissant son public ébahi, le public de la Halle Roublot, pas plus spécialisé que ça, simplement curieux, ayant pris l’habitude de se laisser surprendre par les programmations de Sophie Gastine pour Musiques au Comptoir *. Auraient-ils pu aller plus loin ? Pourront-ils jamais aller plus loin. Ont-ils atteint la fin de la musique ? La fin atteinte hier soir était-elle définitive ? S’insinue dans le message émerveillé de mon amie évoqué au début de cette chronique comme une pointe d’angoisse, dont je me rassure en écoutant avec un émoi renouvelé le disque du trio que Vincent Courtois a glissé dans ma poche hier soir, “Nothing Else”, enregistré en janvier 2022 à Budapest et publié cette année sur BMC (Budapest Music Center), deux suites de formats courts (de 2’39 à 7’11) destinées à être écoutées comme deux entités distinctes. Franck Bergerot
* Mardi 19 au même endroit, les doux dingues de No Mad dans leur programme “Des Oiseaux la nuit” ; Vendredi 22, le quartette de Christophe Monniot avec Sopia Domancich, Sarah Murcia et Denis Charolles.
« Les Jours rallongent », c’est nom du trio et/ou le titre de l’album dont la tromboniste Christiane Bopp, la pianiste Sophia Domancich et le batteur Denis Charolles célébraient la publication ce vendredi 15 septembre au studio Sextan.
Concert presque privé devant un public intime où l’on reconnaît notamment Anne Montaron pour l’émisssion de qui (L’Improviste sur France Musique) le trio joua pour la première fois, le 12 février 2018. Concert acoustique au plus près du son – une réalité qui se perd avec la généralisation de l’écoute au casque ou de l’assommoir des sonos –; concert filmé par Igor Juget pour Les Musiques à ouïr à fin de promotion, dans ce studio où Sextan, le label Pee Wee et l’école de vidéo EMCD propose périodiquement des mini-concerts dans la série « Pause ».
La chronique du CD « Les Jours rallongent » a fait l’objet d’une chronique sous ma plume dans notre numéro d’août et je suis frappé comme le charme opère de manière similaire, se dérobant à tout autre description que de pure métaphore. Rouvrant les pages d’août pour les comparer au premier jet de cette chronique, j’y retrouve les mêmes facilités métaphoriques, avec des impressions d’intimité et de plein air où alternent apaisement et menace mais où même la violence se fait discrète, entre les deux pièces initiale (Evening de Sophia Domancich) et finale (As Sleigh Bells de Christiane Bopp). Evening a ce côté doux amer du crépuscule lorsque nous y abandonne le coucher de soleil, avant que de ne s’impose la secrète sauvagerie de la nuit ici traquée par les harmonies infra-rouges de Sophia Domancich. À l’issue de cet abandon à la rêverie auquel nous sommes invités, As Sleigh Bells (qui n’est pas la pièce finale du disque) plante une sortet d’enclos secret de verdure sauvage où s’est perdue une âme signalant sa présence par une complainte éperdue mêlée au chant que fait la chaine de quelque puits éolien, tandis que sous les feuillages (sur les peaux et métaux de Denis Charolles) se devine une intense activité de vies minuscules qui soudain s’exacerbe comme si quelque drame venait de détruire la grande fourmilière. Franck Bergerot