Alain Gerber, “enfin de retour”
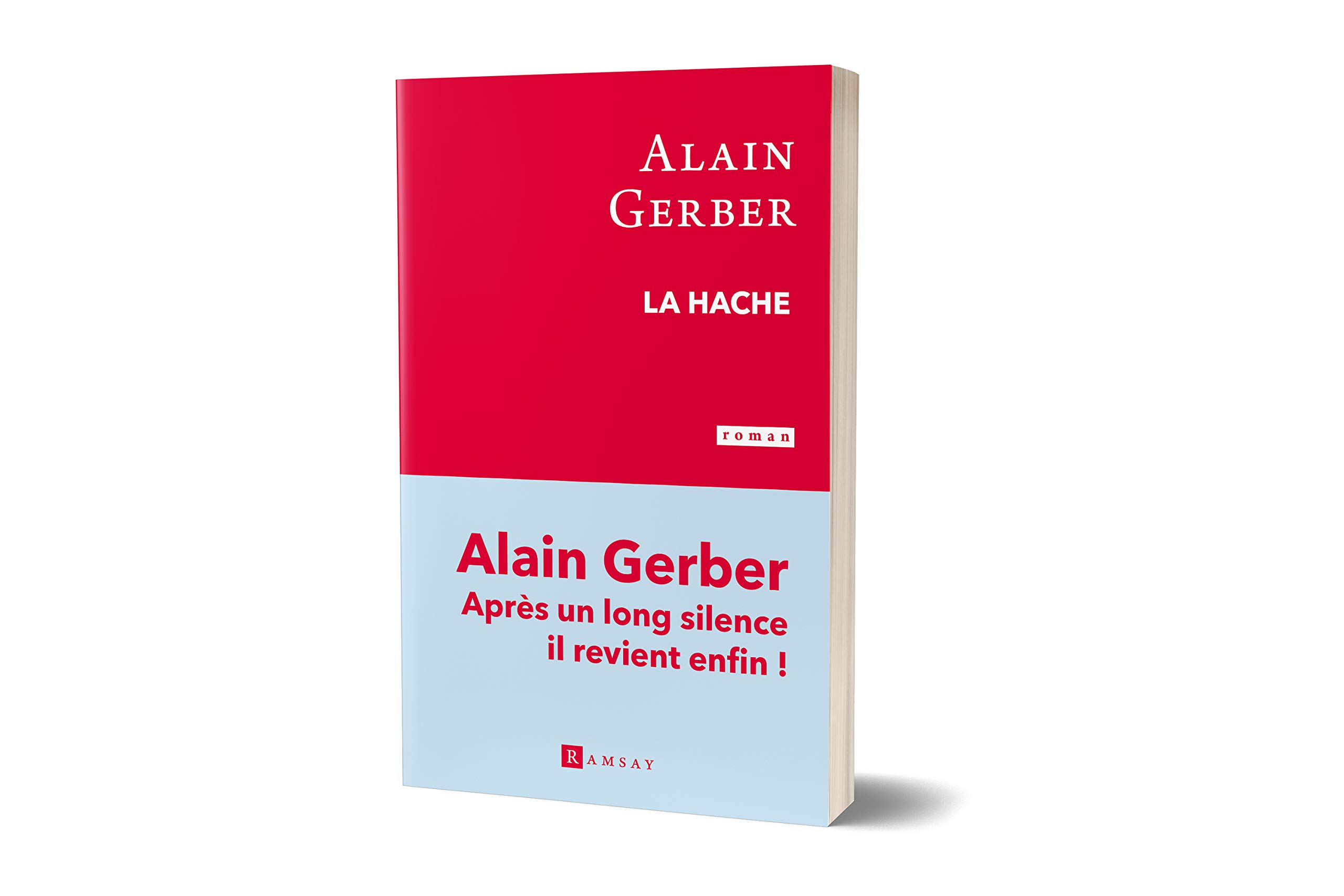
Ce titre, c’est ce que l’on peut lire sur le bandeau promotionnel qui a attiré mon regard sur le roman La Hache parmi les nouveautés chez mon libraire.
Effectivement, voici sept ans – depuis Le Central (2012) – que je n’avais rien lu d’Alain Gerber et il faut croire que ce bandeau est aussi mal informé que je le suis, ou qu’il s’adresse aux ignorants parmi lesquels je ne ferais donc pas figure d’exception. Car, en cherchant un peu, on découvre que l’écrivain, fidèle à cette productivité qui ne l’a jamais laissé inédit plus de trois années de suite depuis son premier roman La Couleur orange (1975), ne s’est guère laissé aller ces dernières années : Une années sabbatique (Editions de Fallois, 2013, inspiré de Sonny Rollins), Souvenirs d’une invisible (Marivole, 2018 et déjà doté d’un bandeau “Le retour d’Alain Gerber”, d’après la vie de la fille d’un ancien sergent du tsar Nicolas II)… et je découvre, chroniqué par notre ami Jacques Aboucaya sur le site de L’Intern@ute en date du 21 avril 2018, trois autres ouvrages parus en 2017 aux Editions Ovadia : Dans la lumière qui se retire, série de portraits de grands bluesmen dans l’esprit des biographies romancées qui font aujourd’hui grand défaut à France Culture, station radiophonique aujourd’hui désertée par le discours et le commentaire sur et de la musique ; Astakos, vie de l’illustre Crétois Astakos pionnier de la percussion moderne (Ovadia), fantaisie fabuleuse et désenchantée à laquelle fait écho Fumées d’automne que lui inspire une cité qui lui est chère, Venise.
Et voici donc La Hache, où l’on partage la vie d’une patrouille de trois casques bleus et leur officier assignés, dans un village que l’on imagine en ex-Yougoslavie, à la surveillance d’un charnier en attendant le dégel qui en permettra l’examen par les envoyés d’un tribunal international. Ici, pas plus de jazzman que de bluesman… alors pourquoi donc en relater ici la parution, nous demanderons les plus jeunes de nos lecteurs. Il est bon de rappeler qu’Alain Gerber fut, avec Jacques Réda, l’une des très belles plumes de Jazz Magazine au tournant des années 1960-1970, auteur d’études restées fameuses sur des artistes encore mal connus, telles Tony The Kid (sur Tony Williams encore tout juste sorti de l’adolescence), C’est ça qu’est Chick (sur Chick Corea dont on venait de découvrir “Now He Sings, Now He Sobs”), Prelude To A Keith (sur un Keith Jarrett qui n’avait pas encore enregistré chez ECM), des écrits auxquels certains d’entre nous doivent une bonne partie de leur passion pour le jazz, si ce n’est leur vocation pour la presse jazz.
On entendit également abondamment sa voix d’homme de théâtre sur les ondes nationales, notamment sur France Culture en tandem avec Lucien Malson dans l’émission Black And Blue, puis dans une série de grands feuilletons dont il tira ses biographies en délicat équilibre entre étude et roman : Chet, Louie, Charlie, Lady Day, Miles… Bref, Gerber nous est cher, même quand il interroge, loin des terres du jazz, comme dans La Hache, l’attente et l’ennui, l’innocence et la culpabilité, la grandeur et la petitesse, le désir et le dégoût, l’héroïsme, la vanité et la lâcheté…
On pense parfois au temps suspendu et à l’absurdité qui pèse sur Le Désert des Tartares de Dino Buzzati, sauf que ce n’est pas le sable qui permet de mesurer l’étirement du temps, mais le gel qui le fige et la neige qui le recouvre. Et de ma retraite bretonne où j’essaie de m’accorder quelques instants de paresse estivale – et de fraîcheur –, je laisserai à Jacques Aboucaya le soin de la chronique, mais ne résisterai pas – dans la veine élargie de notre rubrique “Le Jazz mais pas que” – à la facilité de retranscrire ci-dessous quelques lignes, parmi les plus belles que j’ai pu lire sur la neige. Un peu comme les étudiants des beaux arts recopiaient autrefois les tableaux des grands maîtres, même si l’apprentissage à mon âge est une démarche quelque peu vaine. Franck Bergerot
« S’il neige, après tant de ciels immobiles, c’est que l’hiver se détend. Que le gel desserre son emprise sur le monde. Que l’armure de glace est en train de se fendre. Ce qui rend mélancolique, c’est l’indifférence de cette neige. Elle ne s’occupe pas de vous. Elle ne songe par plus à vous charmer qu’à vous donner de l’inquiétude. Elle s’acharne sans précipitation, comme inattentive à ce qu’elle provoque. On la dirait absente d’elle-même. Pourtant, elle ne rêve à rien : elle est simplement ce phénomène, en train de se produire, qui n’a pas l’intention de s’arrêter, sinon pour satisfaire son bon plaisir. Droite et lente, régulière, absolument monotone, elle a sous ses dehors cotonneux quelque chose d’implacable, pour ne pas dire farouche. Elle pourrait continuer ainsi, tout aussi douce, tout aussi belle, tout aussi discrète, tout aussi résolue, et en quelques jours recouvrir le paysage jusqu’au dessus de la cime du plus grandes des arbres, jusqu’au-dessus du point le plus élevé qu’atteint le vol des aigles. Elle vous étoufferait sans haine, sans scrupule, sans remords. Sans même garder le souvenir de son acte. Et elle pourrait continuer encore, la neige aux reflets bleus, absorber avec la même patience le reste du monde, le rouler dans les flocons jusqu’à ce qu’il devienne une boule énorme, grossissant à l’infini dans l’infini sans limites. On en vient à se demander pourquoi, par le passé, elle s’est toujours arrêtée avant d’avoir tout aboli. […]»