Le Brotherhood Heritage et l’Erik Truffaz Quartet ouvrent le 30ème D’jazz Nevers Festival
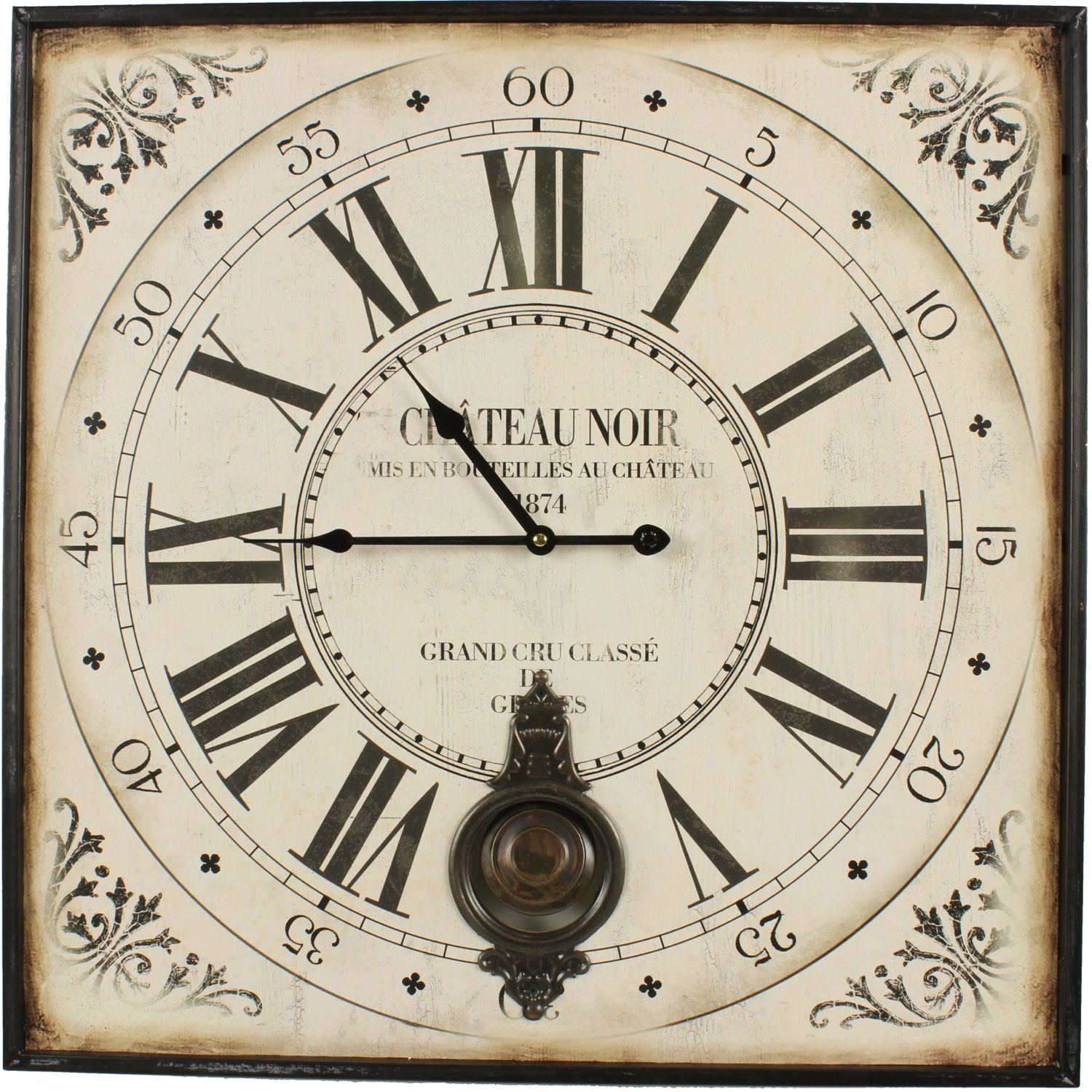
Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
 La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
 Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
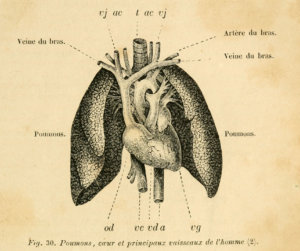 L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes aussi, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme du 19 janvier 1973 à Brême (“Travelling Somewhere”, Cuneiform) que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
 Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
 C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
 Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
 Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes) , Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer. L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée déployée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit au festival de Nancy tard dans la nuit devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce bout de la musique, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme de la compilation live “Travelling Somewhere” que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
John Surman, qui fit partie des premières moutures du Brotherhood et que l’on peut entendre sur le premier album paru sur Neon, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de ce dernier associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert en pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait l’indicatif de l’orchestre. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe). Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
 La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
 Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
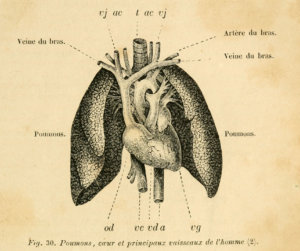 L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes aussi, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme du 19 janvier 1973 à Brême (“Travelling Somewhere”, Cuneiform) que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
 Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
 C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
 Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
 Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes) , Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer. L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée déployée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit au festival de Nancy tard dans la nuit devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce bout de la musique, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme de la compilation live “Travelling Somewhere” que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
John Surman, qui fit partie des premières moutures du Brotherhood et que l’on peut entendre sur le premier album paru sur Neon, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de ce dernier associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert en pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait l’indicatif de l’orchestre. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe). Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
 La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
 Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
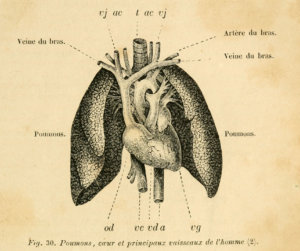 L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes aussi, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme du 19 janvier 1973 à Brême (“Travelling Somewhere”, Cuneiform) que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
 Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
 C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
 Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
 Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes) , Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer. L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée déployée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit au festival de Nancy tard dans la nuit devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce bout de la musique, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme de la compilation live “Travelling Somewhere” que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
John Surman, qui fit partie des premières moutures du Brotherhood et que l’on peut entendre sur le premier album paru sur Neon, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de ce dernier associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert en pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait l’indicatif de l’orchestre. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe). Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
 La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
 Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes), Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune appelé au service militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer.
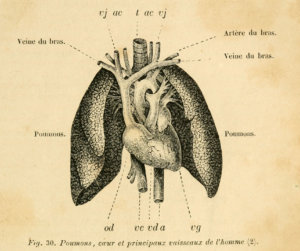 L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit aux Nancy Jazz Pulsations, tard dans la nuit, devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce “bout de la musique”, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes aussi, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme du 19 janvier 1973 à Brême (“Travelling Somewhere”, Cuneiform) que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
 Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
Présent dans les premières moutures du Brotherhood et sur le premier album paru sur Neon/RCA, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
 C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée en plus et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de Levallet associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert à pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait autrefois l’indicatif de fin de concert du Brotherhood of Breath. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
 Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette, mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe. Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
 Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque à une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière lui une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot
|Un hommage au Brotherhood of Breath créé en 1969 et dont le fondateur, Chris McGregor, disparut en 1990, précédait un concert d’Erik Truffaz à la tête d’un quartette fondé il y a plus de vingt ans. Une invitation à la nostalgie ?
Brotherhood Heritage : Michel Marre, Alain Vankenhove (trompette), Jean-Louis Pommier, Matthias Mahler (trombone), Chris Biscoe (sax alto), Raphaël Imbert (sax ténor), François Corneloup (sax baryton), François Raulin (piano, arrangements), Didier Levallet (contrebasse, arrangements), Simon Goubert (batterie).
La nostalgie, comme me disait l’autre jour mon réparateur de machine à coudre qui a des lettres, « il faut l’arracher aux arts d’agrément, lui enlever son parfum de violette et lui rendre son grondement de forge. Lui conférer une qualité d’art majeur, et féroce, pour que la force de l’âge puisse redevenir une force d’entraînement. » C’est de Régis Debray, on aura reconnu les oriflammes et les roulements de tambour. Alors que nous devisions de part et d’autre d’une vieille Singer dont l’homme de l’art – mon réparateur de machine à coudre, par Régis Debray – était en train de remplacer le pied de biche, je lui citais en retour Milan Kundera qui, remplaçant l’oriflamme par le scapel, écrivit : « la vocation de la broderie n’est pas de nous éblouir par une idée surprenante, mais de faire qu’un instant de l’être devienne inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie. » Ayant la mémoire qui flanche, je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il n’ai pas utilisé le mot “poésie” plutôt que celui de “broderie”. Mais foin des machines à coudre, j’y mets celui de “musique” et, ce faisant, je ferais bien miennes ces deux citations. C’est ce que j’étais venu vérifier à Nevers à l’écoute de la musique du Brotherhood of Breath revisitée par Didier Levallet et François Raulin, du quartette d’Erik Truffaz remanié depuis la dernière fois que je l’ai vu sur scène, et John Surman… À savoir, ces musiques d’un instant chacune à sa façon devenue « inoubliable et digne d’une insoutenable nostalgie », confèrent-elles à « la force de l’âge de redevenir une force d’entraînement. » ?
Imaginé par Didier Levallet et François Raulin avec le soutien des festivals Jazz sous les pommiers (Coutances), Europajazz (Le Mans), Les Rendez-vous sur l’Erdre (Nantes) , Jazzdor (Strasbourg), La Forge (Grenoble) et d’Jazz Nevers, le Brotherhood Heritage pouvait-il se confronter au souvenir ? La nostalgie ne serait-elle pas son pire ennemi (la question se posera également, pour Truffaz et pour le concert solo que John Surman donnera tout l’heure, à 17h ce dimanche 6 novembre où j’écris ces lignes, en la cathédrale Saint-Cyr / Sainte-Juliette). Or qu’est-ce que le souvenir ? Le mien, c’est celui d’un jeune militaire de vingt ans, encore novice dans la connaissance du jazz, qui rentra en avance de sa permission de 72h dans sa ville de casernement, Reims, pour assister à un orchestre dont il ne savait rien mais dont le nom – La Confrérie du souffle – promettait beaucoup. Ce 17 mars 1975 (l’affiche ci-contre que m’a dénichée Jean-Delestrade de l’association reimoise Jazzus, atteste), l’orchestre de Chris McGregor était à l’affiche à Tinqueux, dans la banlieue de Reims. Le souvenir que j’en ai ? Je n’ai jamais trouvé les mots pour le dire. Une bourrasque, un typhon, un tremblement de terre… Plus précisément, une locomotive folle lancée à toute vapeur, fumant de toutes ses bielles et de tous ses pistons, empanachée d’une nuée d’escarbilles, qu’alimentaient en charbon une dizaine de personnages se bousculant impassiblement quoique dans un désordre indescriptible autour du foyer. L’impassibilité – d’Evan Parker, Kenny Wheeler (ici mon souvenir m’égare… il ne figure ni sur l’affiche, ni sur aucun enregistrement live du Brotherhood), Mark Charig, Elton Dean, Mongezi Feza (dont je n’ai curieusement gardé aucun souvenir et qu’il me semble avoir découvert à Angoulême l’année suivante, avec Johnny Dyani en doublure d’Harry Miller, le bassiste régulier)… – est aussi présente dans mon souvenir que la dépense énergétique démesurée déployée, à laquelle seul s’identifiait physiquement Dudu Pukwana. Ce dernier courait de l’un à l’autre pour stimuler l’ardeur de chacun à grands coups de sifflet, tandis que Chris McGregor et sa rythmique (Harry Miller et Louis Moholo) poussait imperturbablement la pression aux limites de l’explosion de chaudière. Et du désordre que produisaient ces grands diables alignés sur un seul plan en front de scène, il résultait une impression de puissance, de force de pénétration irrésistible. Et je me souviens encore de ce qu’en disait Jean-Claude Fohrenbach qui n’était pourtant pas très amateur de free music mais qui se souvenait, des pépites plein les yeux (et certes un rien d’amertume), de s’être produit au festival de Nancy tard dans la nuit devant un public qui venait d’être balayé par le souffle dévastateur de la “Confrérie du souffle” : « Il n’y avait plus rien à jouer. Ils avaient été au bout de la musique. » Et de ce bout de la musique, j’étais rentré vers ma caserne sous une neige de décor de théâtre, volant plus que marchant, glissant tel un bienheureux aéroglisseur sous les yeux incrédules du sous-officier de permanence au poste de garde qui me vit passer comme un songe (et peut-être dormait-il à poings fermés dans sa guérite et son étonnement à mon passage n’appartient-il qu’à mon songe à moi, d’après-concert).
Voilà donc à quelle insoutenable nostalgie se sont confrontés hier Didier Levallet, François Raulin et leurs compagnons. Un souvenir que ni les reconstitutions antérieures de Didier Levallet avec Chris Mc Gregor en personne dans les années 1980, ni même les enregistrements studio ou live des années 1970 n’ont pu soutenir. Même ces derniers, où en l’absence de la présence physique de l’orchestre, l’impression de désordre prend le dessus sur la force de pénétration, les formidables groove, les embrasements mélodiques lancés à la diable, superposés et enchevêtrés en délirants canons et contrepoints, s’épuisent en dépense d’énergie dans des réalisations incertaines et des solos interminables (certes, en des prises de son maladroites comme le révèle l’écoute d’un tout de même terrassant Kongi’s Theme de la compilation live “Travelling Somewhere” que j’écoutais hier dans le Paris-Nevers de 16h00).
John Surman, qui fit partie des premières moutures du Brotherhood et que l’on peut entendre sur le premier album paru sur Neon, John Surman vint hier ajouter son souvenir au mien, d’une tout autre importance. Quittant sa table dans la salle de restauration du festival, pour se joindre à celle où s’étaient rassemblées les musiciens du Brotherhood Heritage, il tenait à partager le souvenir de la première répétition convoquée après minuit au Ronnie’s Scott. Chris McGregor avait ratissé large, faisant appel aux meilleurs de ce que Londres pouvait compter de musiciens de pupitre, en un temps où la scène anglaise comportait de fameux big bands. Et là, McGregor, en l’absence de toute partition, se mit au piano et commença à dicter les mélodies, qui souvent étaient bien plus que de simples riffs et qui s’emboîtaient les uns dans les autres selon des schémas qui n’avaient rien de simplistes ni de définitifs. Où l’on vit – manque ici les intonations et mimiques de Surman, en bon compatriote de Peter Sellers – les musiciens refermer un à un leurs étuis et prendre discrètement la poudre d’escampette. C’est ainsi que Chris McGregor « sépara les chèvres des moutons » et ne garda que les meilleurs.
C’était bien cette énergie que j’étais venu retrouver avec peut-être un poil de maîtrise de la durée et je savais qu’avec les musiciens retenus par Raulin et Levallet (qui surent ne garder que les “chèvres” et quelles chèvres ! Des chamois, des bouquetins…), avec la basse de ce dernier associée à Simon Goubert, tout était réuni pour y parvenir, l’excitation scénique de Vankenhove reprenant le rôle de mouche du coche autrefois tenu par Dudu Pukwana. J’avoue, la nostalgie ne jouant pas ici « son rôle de force d’entrainement », que je suis passé un peu à côté des compositions ajoutées par Raulin, trop “écrites”, trop compartimentées, au regard de ce que j’étais venu écouter, au regard aussi de l’esprit dans lequel le répertoire original plaçait l’orchestre. J’avoue encore que certaines pièces que je ne connaissais pas, se référant plus littéralement au marabi sud-africain, prenaient des couleurs un peu trop pittoresques au regard du grand répertoire du Brotherhood. Mais sinon quel pied, avec une fin de concert en pleine vapeur introduite par une longue introduction de Raulin, belle exploration-extension de l’imaginaire pianistique de McGregor, puis l’orchestre rejoint par l’invité surprise, John Surman, qui décomposa et recomposa le matériel du morceau sur son soprano, dans un style très éloigné de ce qu’il jouait à l’époque. Bouquet final avec la pétarade de cuivres de saxes de Mra dont la puissante pulsation fut le sujet d’étude de Simon Goubert en un passionnant solo avant la farandole accelerando qui constituait l’indicatif de l’orchestre. Rappel majestueux sur le tempo de Sonia que je qualifierais, après les cavalcades qui ont précédé, de “pachydermique léger”. Il nous a fallu nous rincer de quelques verres avant de soumettre nos oreilles à la suite du concert.
Erik Truffaz Quartet : Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (claviers), Marcello Giulani (basse), Arthur Hnatek (batterie).
La nostalgie encore avec Erik Truffaz dont je n’avais vu aucun concert depuis fort longtemps. Entre musiciens et critiques, il peut exister des périodes de désamours, et pour avoir soutenu ses débuts, je me suis désintéressé par la suite de certains de ces projets. Pour tout dire, j’en étais resté au quintette (Maurice Magnoni en était le formidable saxophoniste, “Nina Valeria”, 1992) et au quartette de “The Dawn” et “Bending New Corners” (1997-1999) ou je trouvais des pistes que j’aurais aimé voir Miles Davis explorer s’il avait vécu et s’il avait pris connaissance des beats électroniques de la scène jungle et du drum’n’bass (que Patrick Muller, Marcello Giuliani et Marc Erbetta transposaient sur leurs instruments).
Miles, je ne le retrouve plus vraiment dans la trompette de Truffaz, sauf évidemment, au premier degré du son lorsqu’il s’empare de la sourdine harmon. Il y a incontestablement un son Truffaz qui ne tient pas qu’à la sonorité, mais aussi à certaines couleurs mélodiques, à un certain débit, une certaine respiration. Depuis que je fréquentais ses concerts, Marcello Giualini est toujours à ses côtés, mais Patrick Muller puis Marc Erbetta s’en sont allés. Et dans cette première partie de concert, je retrouve sur la batterie d’Arthur Hnatek ce travail de décomposition aux allures aléatoires que Marc Erbetta empruntait aux dérèglements des boîtes à rythme. J’ai particulièrement apprécié un longue improvisation libre conduisant vers de belles variations sur un morceau de la période “The Dawn – Bending New Corners” (nostalgie pour tout le monde, Truffaz comme son public, que relancera un autre morceau de la même période… ). Jouage, vivacité de l’interaction, phrasés de trompette mobilité des lignes de basse, solo de piano avec des angles originaux et une belle montée en chauffe). Où l’on aura compris que le jazz-critic fut moins sensible aux autres morceaux plus pop, un jouage plus statique, avec réverb interminable sur la trompette. Après avoir patienté longuement pour le saluer que le trompettiste soit venu à bout d’une longue file d’attente au stand des autographes qu’il accompagne chaque fois d’un chaleureux échange verbal, je lui déclare, sans prendre garde, « je m’attendais pas te voir une si longue queue» et il me répond malicieux : « je t’en prie… »
Ce qui me rappelle une autre queue. Nostalgie toujours. Par une belle fin d’été, j’avais trainé Erik Truffaz au festival de Cluny à un concert dont je lui avait promis le meilleur et qu’il avait fui rapidement, me laissant seul à mes émois musicaux. Le retrouvant à la terrasse d’un café, nous nous étions chamaillé à ce propos, lui trouvant que cette musique ne groovait pas, moi assimilant cette remarque une actualisation des vieux arguments d’Hugues Panassié. Un rat nous avait réconciliés. Un rat long et gras comme un basset, qui passa devant notre table d’un pas tranquille, un pas de notable traversant sa ville, traînant derrière une longue queue rose qui dépassait de sa redingote grise. Interloqué, laissant là nos bières et leur paiement, nous lui avions emboîté le pas, quoiqu’à une distance respectable, comme deux Pieds Nickelés attendant un peu d’ombre pour détrousser le bourgeois, à vrai dire quelque peu intimidé par la taille de l’animal qui entraînait à sa suite le musicien et son critique comme autrefois, drôle de renversement des rôles, le joueur de flûte d’Hamelin débarrassa la ville de sa population de rats en l’emmenant se noyer dans le fleuve au son de son instrument (peut-être, Truffaz jalousa-t-il quelques instants ce rat, rêvant d’entraîner à sa suite jusqu’au plus profond du fleuve, ma personne et toute la population des jazz-critics). Quelques rues plus loin, le rat disparut dans quelque anfractuosité murale, nous laissant seuls, riant comme des bossus de notre inepte curiosité et de nos différents. • Franck Bergerot