Errances trans-tangentielles là bas…

Un solo de saxophone sous électro-choc (Yannick Jory), un quatuor interdisciplinaire autour d’un violon (Rhésus) et un duo flûte et chant bretonnant aux accents hindoustaniques (Lors Jouin et Jean-Michel Veillon). Plus quelques heures de route en pays breton de l’un à l’autre avec quelques disques pour nous tenir en éveil.
Le pilote automatique programmé sur Langonnet, trois quarts d’heure de route, petites routes bordées d’arbres abattus par les récentes tempêtes, parmi des champs gorgés d’eau qu’éclaire vaguement et par intermittence les dernières lueurs d’un soleil intimidé par l’humidité régnante et l’approche de la nuit. Nous accompagne “Sông Song” (prod. Le Grand Pas), le nouveau disque de l’accordéoniste diatonique Janick Martin entouré de Julien Jack Tual (elg), Simon Latouche (tb) et, sur deux titres, de Robin Fincker que l’on sait friand des patrimoines populaires revisités, ici aussi discret qu’habité par son sujet et par le propos de cet accordéoniste intense tant pour la danse que pour l ’incantation. Les Bourguignons pourront l’entendre le 22 mars aux Forges royales de Quérigny, dans le cadre de la Saison D’jazz à Nevers et les Parisiens le 29 au Studio de l’Ermitage.
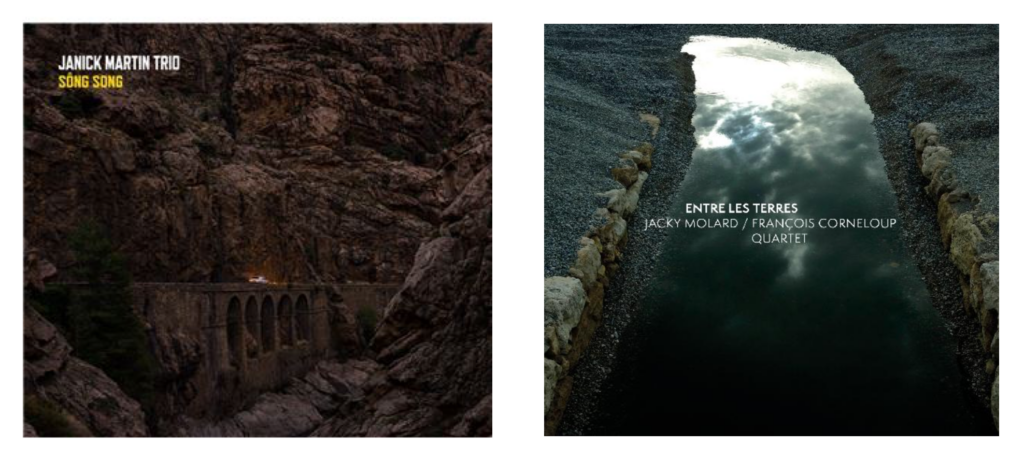
Nous enchaînons sur le CD “Entre les Terres” de Jacky Molard et François Corneloup (produit sur le label de Claude Tchamitchian, Émouvance) alors que déjà s’annonce Langonnet et nous résistons à l’envie de continuer à rouler pour entendre la suite de l’album, laissant se finir le morceau en cours sur notre parking avant de descendre de voiture à regret tant les écritures des deux leaders et leurs deux interprètes et improvisateurs (Catherine Delaunay et Vincent Courtois) se complètent admirablement. Cette descente différée de voiture me rappelle un ami qui, habitant Nanterre et étudiant à la fac de Dauphine où il se rendait en auto, sachant qu’en temps normal le trajet durait un Moon in June de Robert Wyatt (la face chantée de “Third” de Soft Machine), il pouvait écouter deux fois Moon in June dans le même trajet (en tentant compte du fait qu’un défaut de clignotant gauche l’obligeait à concevoir ses trajets sans jamais avoir à tourner à gauche) ; lorsque la circulation était fluide, il annonçait avoir mis un Moon in June pour arriver à la fac, mais il arrivait même, parvenu à Dauphine avant la fin du morceau, de monter jusqu’à la place de l’Étoile pour entendre la fin.

Nous voici donc à la Grande Boutique lieu légendaire déjà présenté dans ces pages, où, ce vendredi 23 février, se produisait un artiste connu dans cette Bretagne où la musique prolifère autant qu’elle peine à s’exporter au-delà de ses limites géographiques, la world music n’étant généralement admise à l’export de ses terres d’origine que fun et sunny. Saxophoniste, Yannick Jory nous est connu notamment pour sa participation à l’Acoustic Quartet du violoniste Jacky Molard (avec l’accordéoniste Janick Martin et la contrebassiste Hélène Labarrière) et pour son duo avec le joueur de bandonéon Philippe Ollivier. L’entendre en solo attisait notre curiosité… Or, ce vendredi 23, il n’était pas venu seul, mais l’accompagnait Logelloop, « looper spatialiseur multicanal pour la création sonore en temps réel » développé par Christophe Baratay. Ouverture shamanique pour ce programme intitulé “Mantra”. Souffles rituels, mugissements éoliens, grondements telluriques répondent au saxophone par l’intermédiaire de l’ordinateur et des consoles qui l’entourent et que Yannick Jory pilote en temps réel. Je pense au premier “one man band” de John Surman sur “Westering Home” de 1972, au dispositif rudimentaire (beaucoup de re-recording et de vieux synthétiseurs Moog et EMS) dont je garde la nostalgie par-delà la sophistication des dispositifs ultérieurs adoptés par le célèbre baryton anglais. À ceci près que le Logelloop permet visiblement une interactivité qui n’était pas envisageable à l’époque, Jory se dédoublant entre ses initiatives de programmateur et celles d’instrumentiste qui se stimulent mutuellement, les ambiances premières très “Le Seigneur des anneaux” évoluant vers des climats plus industriels, voire une séquence plus convenue façon dance floor. Hélas, rôdage oblige, un problème technique obligea le saxo-machiniste à écourter son concert. À suivre…
Nous ne nous attardons pas au bar, inquiet de l’état de nos routes détrempées qu’une température négative risque de rendre glissantes. Roulant plus prudemment qu’à l’aller, nous aurons le temps de reprendre l’écoute de “Entre les terres” et d’enchainer deux disques Hubro (label vitrine de la jeune scène norvégienne) de Erlend Apneseth, joueur de violon hardanger (violon norvégien à bourdons et au chevalet facilitant l’usage des doubles et triples cordes, dont on trouve de nombreuses occurrences sur la scène jazz norvégienne, notamment sur ECM).

Sur le premier, “Collage”, le violoniste avance masqué par un dispositif électronique qui nous ramène d’une certaine façon au concert que nous venons de quitter, avec Stephan Meidell (baritone acoustic guitar, live sampling, modular synth), Øvind Hegg-Lunde (dm,el dm, perc, timpani), plus (invitée du trio), la chanteuse Maja S.K. Ratkje également bidouilleuse d’électronique. Ambiance en accord avec le climat hivernal, monde sonore fascinant, admirablement contrasté sans tape-à-l’œil, d’authentiques narrations évitant les facilités habituelles du genre narratif et les clichés du genre électro. Notre route se termine au son de “Nova”, le même violoniste cette fois-ci en solo acoustique, jouant la tradition norvégienne en se débarrassant du répertoire convenu pour n’en faire résonner que l’âme profonde. Avant que mon “lift” ne me dépose à ma voiture au parebrise couvert d’une couche de glace déjà tenace, quelques tours du village s’impose pour aller jusqu’au bout de ce disque fascinant qui m’habite encore, lorque grelottant dans ma vieille guimbarde, je regagne le village voisin et vers ma maisonnette.
Le lendemain, c’est sur la côte nord, vers Morlaix, à Saint-Jean-du-Doigt, que nous avons prévu de nous rendre au concert, un étrange projet autour des mathématiques ayant éveillé la curiosité de Baptiste Boiron – parce que c’est lui le lift désigné ci-dessus –, saxophoniste et compositeur déjà salué dans ces pages pour son trio avec Bruno Chevillon et Fred Gastard. Appelons-le “Bee” pour ne pas lui donner ici trop d’importance. Nos conversations de la veille nous ayant distrait du côté d’Anna Livia Plurabelle d’André Hodeir auquel j’ai consacré un petit essai à paraître dans les mois qui viennent, je me suis muni d’un petit coffret CD contenant l’intégrale Prestige de Miles Davis. Bee ne connaît pas en effet cette fameuse version de Bag’s Groove du 24 décembre 1954 (séance dont on ne retient généralement que The Man I Love pour le fameux et pittoresque “trou de Monk”, pain péni pour le commentateur). Bag’s Groove, la prise 1 (mais la 2 n’est pas mal non plus) fut l’objet dans Jazz Hot en 1956 d’un étonnant débat entre Hodeir, le tromboniste Nat Peck alors résident en France et familier du Jazz Groupe de Paris dirigé par Hodeir et le compositeur contemporain Michel Fano. Ils y font le constat que Monk renonce à “jouer des phrases”, “cesse de jouer du piano”. « L’instrument est complètement détruit, précise Fano, donc la phrase est détruite au profit de l’organisation d’un monde sonore complètement nouveau. » Hodeir d’ajouter « Sa manière même d’accompagner Milt Jackson, par exemple, détruit complètement le piano au sens traditionnel : ce n’est plus un support harmonique, c’est autre chose. » Et Nat Peck de conclure : « Ce qui est extraordinaire dans son solo, c’est que, pour la première fois, dans l’histoire du jazz, Monk ait pu rompre si complètement avec le passé tout en restant un jazzman qui fait œuvre. »
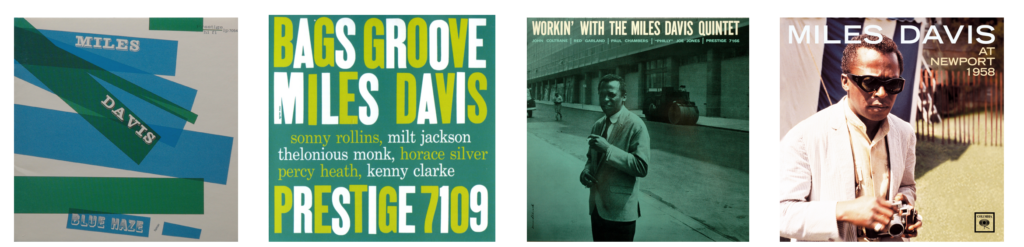
Je programme ensuite Blue Haze de cette même année 1954, essence de blues avec ce troisième chorus que Miles semble avoir reçu des mains de King Oliver (réécouter le solo de ce dernier sur le Dippermouth Blues d’avril 1923). Bee se souvient lui d’une merveilleuse introduction d’Horace Silver “à la Chopin” que le poursuivait ostinato derrière l’exposé de Miles. Bee aimerait la réentendre. Je crois savoir qu’il pense à It Never Entered My Mind, mais c’est une version avec Red Garland que je lui fais écouter. Finalement, nous retrouvons ce dont il parle sur mon mobile. Il s’agit non des faces Prestige de 1956, mais de la séance Blue note de mars 1954. Dire que j’avais toujours attribué cette petite perle pianistique à Red Garland. Celle d’Horace Silver est certes différemment construite, plus ample. Est-ce lui qui l’a inventée ? Sur une idée de Miles ? Ce dernier n’aurait-il pas piqué l’idée à Ahmad Jamal qui l’obsédait déjà ? Il n’existe pas d’enregistrement de ce thème par Jamal. Est-ce Miles qui a demandé à Red Garland de la reprendre et Garland qui l’a réaménagée ? Mais j’ai aussi pris quelques faces Columbia, après nous être régalé de la complicité Miles-Philly Joe sur Dr. Jackle (“Milestones”), c’est bientôt l’héroïque Ah Leu Cha en ouverture du concert de Newport 1958 qui accapare notre attention, avec ce solo survolté où Coltrane semble déjà creuser les idées de ce qui deviendra Countdown.
Mais nous sommes bientôt distrait par tout autre chose. Le pilote automatique n’a retenu pour nous que les plus jolies petites routes que l’on puisse prendre pour monter du Pays Pourlet vers la frontière du Tregor et du Léon et l’accalmie climatique annoncée nous a décidé à partir assez tôt pour rouler de jour. Et tandis que rôdent alentours les masses grises et obliques de giboulées raclant les Monts d’Arrée, nous voyageons “au travers des gouttes”, de clairière en clairière de lumière, jusqu’au bout de la pointe de Primel que nous gagnons à pied et où nous accueillent les clameurs d’une forte houle auxquelles répondent la succion du ressac et l’allegro polyphonique des galets roulés par les eaux.
Quelques galettes de blé noir et bolées de cidre plus tard, nous voici à la salle du Kasino (avec un K). Vous vouliez du tangentiel ? En voici avec cet étrange spectacle, “Rhésus”, proposé par la compagnie du Chemin des ânes dans le cadre de ses Saisons singulières, où l’on a pu entendre les duos Marc Ducret / Christophe Monniot, Jean-Mathias Pétri / Jean-Michel Veillon et… en l’église de Saint-Jean-du-doigt où repose la relique d’une phalange de l’index droit de Saint-Jean-Baptiste, notre Baptiste Boiron dans un dialogue alors inédit avec la chanteuse traditionnelle Marthe Vassalo.
Rhésus réunit quant à lui une étrange polyphonie de sens et de compétences reposant sur la précision tant du déroulé dramatique que de sa mise en scène : côté cour, attablé devant un clavier d’ordinateur, l’écrivain Jacques Guiavach dont vont se succéder en projection sur deux écrans les mots (Le logos. La grammaire. La syntaxe. Le rythme. L’adéquation. La tension…), les sentences (Simuler l’inconstance. Le nerf de la guerre c’est le temps. Manier le couteau de la rigueur dans la clarté. La Paix n’est plus une alternative…), les phrases (Nous ne sommes rien pour eux mais nous saisirons partout du nécessaire. Reste ce que peut contenir le bon sens des choses et des couleurs, les choses et les êtres violemment délivrés…). Côté jardin, entre un tableau noir sur lequel il écrira à la craie et un autre de plexiglass transparent sur fond noir où il écrira au feutre blanc, le mathématicien et récitant Nicolas Neveu commence ainsi :
« Continuité, fusion, distinction, fusion, espace, on va expliquer ce que ça veut dire. La continuité est un affect sans entendement. On fait beaucoup de chose en vertu de capacités insues, qui doivent demeurer insues au moment où on les fait : respirer, faire de la bicyclette, plus généralement agir, en particulier continuer […] »

Tandis qu’il continue à disserter mettant en évidence les tensions entre l’imagination et les preuves, l’espace et la quantité, l’espace et le groupe, ses mots et ses définitions résonnant et déraisonnant avec les mots et les sentences affichées sur l’écran, Pierre Stephan (violoneux comme on le dit des violonistes jouant de routine les musiques des campagnes, fiddler dirait l’anglophone) improvise sur cette trame serrée, recourant à toutes les techniques “étendues” que permet son instrument et sa pratique (pizzicato, double cordes, mèche désolidarisé de la baguette de l’archet pour frotter les quatre cordes à la fois, saturation, grincements au-delà du chevalet, etc.).
Quant au quatrième, Rémi Leblanc-Messager, il danse une chorégraphie créée et écrite par Fabrice Dasse. Au spectateur-auditeur de se relier à sa façon à ce rhizome de contenus, de sens, en circulant de l’un à l’autre, en se laissant renvoyer de l’un à l’autre comme une boule de billard, expérimentant de par son égarement cette continuité qui relie les notions de fusion et de distinction.
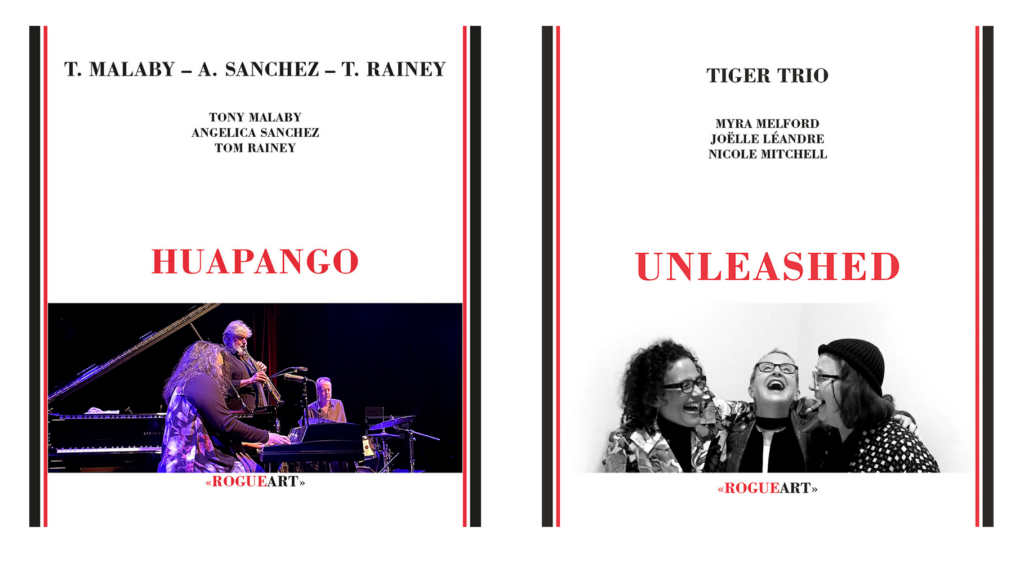
La route du retour sera longue – deux heures sous cette deuxième pleine lune de l’année, dite « des neiges » – et deux disques achetés au stand de Rogue Art lors du dernier Jazzdor à Strasbourg se succèderont dans notre mange-disque pour nous tenir en éveil. Deux âpres trios : Tony Malaby / Angela Sanchez / Tom Rainey (“Huapango” de 2021) et le Tiger Trio de Nicole Mitchell / Myra Melford / Joëlle Léandre (“Unleashed” de 2016). Deux conceptions du flow improvisé sans autre fondement qu’une complicité réinventée au fil de l’eau. Une énergie tendue comme un arc et projetée comme sa flèche pour le premier trio, une vison plus folâtre de l’existence pour le second. C’est tout du moins les impressions que m’ont laissées cette écoute nocturne et routière.
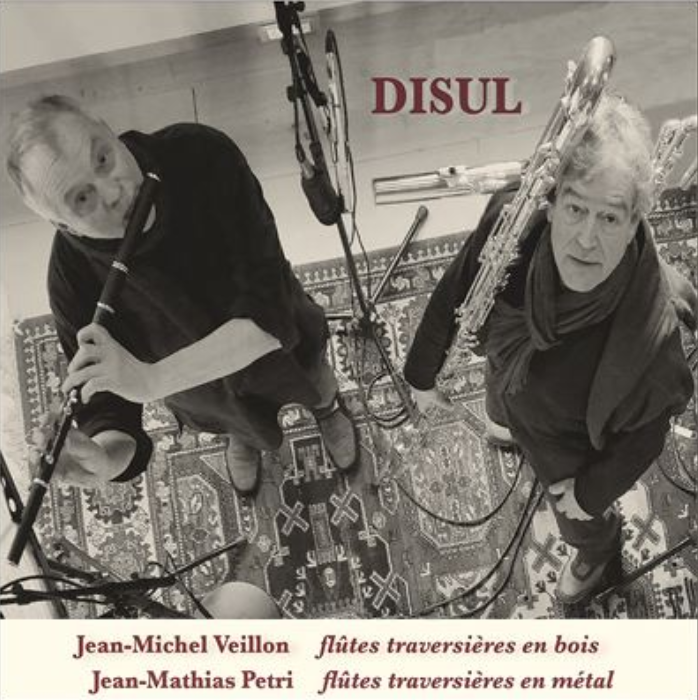
Après ça, pour les derniers kilomètres, nous sommes redescendus vers des propos plus limpides. Ce sont les flûtistes Jean-Mathias Petri et Jean-Michel Veillon qui nous les ont offerts avec le disque “Disul” autrement dit, traduit du breton, “Dimanche”. Jean-Mathias Petri, même s’il est multicarte sur le plan esthétique, n’est pas étranger au jazz qu’il a enseigné au Conservatoire de Saint-Brieuc en parfaite complicité avec le directeur du département jazz, le pianiste et organiste Jean-Philippe Lavergne. Avec ce dernier et son frère, le batteur Christophe Lavergne, ils animent différentes formules accueillant le guitariste irlandais Tommy Halferty ou le français Serge Lazarevitch, ainsi que le tromboniste Jean-Louis Pommier et/ou le vibraphoniste Franck Tortiller. Pratiquant toutes les flûtes du piccolo à l’octobasse, Jean-Mathias Petri aime rassembler d’autres flûtistes pratiquant les musiques traditionnelles ou contemporaines. Sur “Disul” avec Jean-Michel Veillon que nous allions écouter le lendemain pour notre dernier concert du week end, ils signent chacun une pièce où s’affichent leurs singularités respectives avant de reprendre des partitions de la harpiste bretonne décédée en 2007, Kristen Noguès, puis de s’emparer de quelques-uns des duos pour violons de Belá Bartók, enfin une adptatio de Trois Beaux Oiseaux du Paradis de Maurice Ravel en guise de coda.
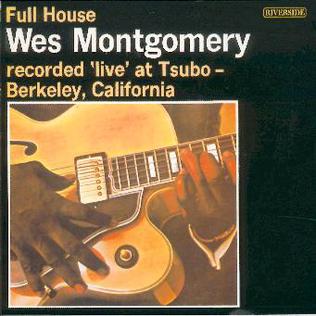
Le lendemain, dimanche 25 février, direction Landeleau, un heure de route qui suffit à se sentir au cœur du Centre Bretagne. Pour l’aller, j’ai proposé à Bee le l’album live “Full House” de Wes Montgomery, avec solos de guitare construit comme des sonates (une édition récente nous apprend qu’il s’agit de montages, mais peu importe, je m’en tiens à “l’original” que j’aime fredonner à l’unisson pour les avoir tant écouté) entre deux scapinades de Johnny Griffin.

Quel contraste avec l’arrivée dans cette salle communale où l’on se congratule en breton. Jean-Michel Veillon et le chanteur Lors Jouin sont à l’affiche. Lors Jouin, certains le connaissent à travers le répertoire pour enfants des Ours du Scorff dont il partageait les vocaux avec le regretté Gigi Bourdin, groupe qui avait son pendant pour adultes, le duo Les Ânes du Scorff. Collecteur de chansons, d’histoires, d’accents et de vocabulaires auprès des anciens, il est surtout un grand interprète de chants à danser et de gwerz, la complainte bretonne, un art qu’il a dépoussiéré notamment en prenant ses distances d’avec le timbre pincé et vibrant qui s’est fait connaître au-delà des frontières bretonnes avec les sœurs Goadec. Il y eut une époque où, pas seulement en Bretagne, les collectages auprès de locuteurs souvent âgés semblent avoir imposé une sorte de standardisation du chant traditionnel tel que pratiqué par les revivalistes des années 1970.
C’est en breton que Lors Louin présente gwerz et autres mélodies, assurant lui-même la traduction. Il y a chez lui une générosité tant du geste que de la voix, une souplesse du timbre, de la ligne mélodique et de la justesse, une façon d’infléchir certaines notes qui évoque le qawali pakistanais, ainsi qu’un art de la variation, si bien que, ne comprenant pas le breton, on se laisse tout de même embarquer par ces récits, chaque couplet différant du précédent.

Lançant des bourdons sur un petit boîtier électronique, comme on le fait dans le raga à l’aide du luth tampura, Jean-Michel Veillon est très versé dans cette culture indienne. Certes, il a dansé la gavotte, sonné la bombarde, avant de s’intéresser à la fûte traversière en bois telle qu’elle est pratiquée en Irlande, importante source d’inspiration pour le renouveau de la musique bretonne dont il fut un acteur important notamment au sein des groupes Kornog, Pennou Skoulm, Den, Barzaz. Il fut l’interlocuteur de Lors Jouin au sein de Toudsames porté par la basse électrique d’Alain Genty et les percussions de David Hopkins et Dominique Molard, formation dont le peu d’impact public reste un mystère. Son jeu de flûte est explicitement nourri des musiques indiennes, à travers notamment la pratique de la flûte bansuri. Il doit à cette curiosité d’attendrir son enracinement dans le terroir breton d’une imagination et d’un placement mélodique qui lui permet lui aussi de raconter une histoire nouvelle ou tout du moins d’en développer l’intrigue à chaque nouveau couplet, d’accompagner enfin son complice sans se mettre dans ses pattes ou d’alterner avec le chant en complétant le propos de son compère. Un grand moment de musique.
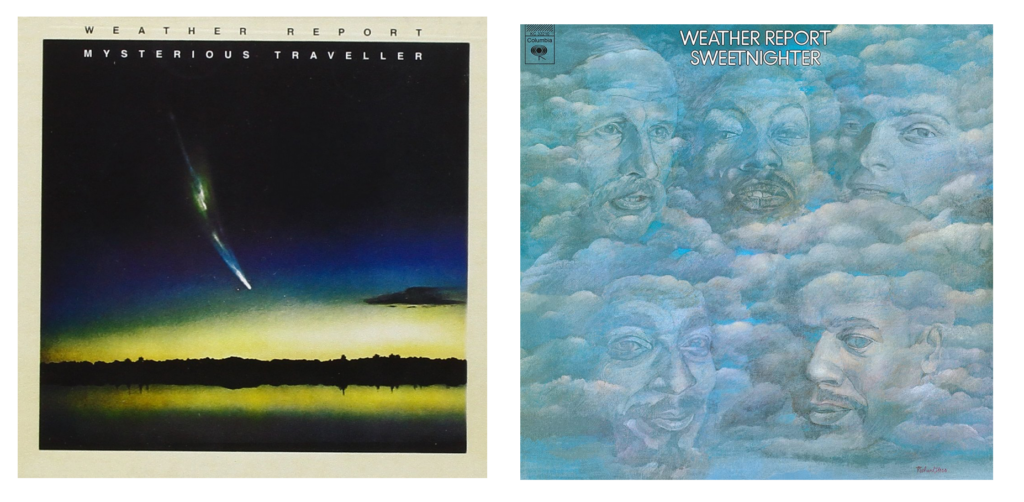
Contraste. Il nous restait à rentrer à la maison, avec quelques faces de Weather Report, celles de la première période (ou déjà de la deuxième) avec des extraits des albums que j’avais sous la main, “Sweetnighter” et “Mysterious Traveller”, où l’on voit Joe Zawinul écarter Miroslav Vitous et prendre l’initiative. Une initiative dont on renonce à distinguer la part d’improvisation et d’écriture l’une et l’autre s’engendrant mutuellement en de longs développements sans retours. Rythmiques triées sur le volet, et Wayne Shorter nulle part ailleurs tandis que sous nos phares émerveillés détalent lièvres et chevreuils outragés. Franck Bergerot