Respire Jazz 2 : Malna, Perrudin, The Watershed, Louraukarpasic
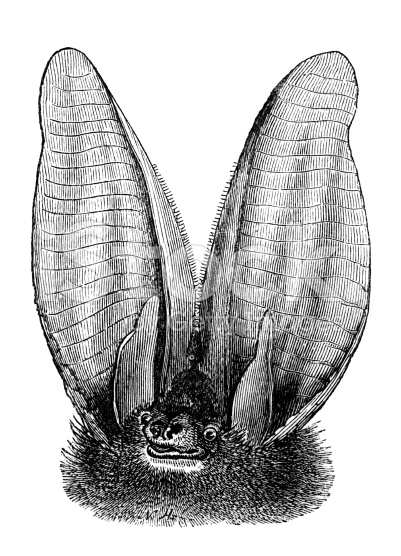
Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Tout commence en début d’après-midi par un exposé de Pierre de Bethmann sur le thème “Etre musicien de jazz aujourd’hui” et l’on s’y rend confiant tant on apprécie cette faconde réfléchie, méthodique dont témoigna il y a quelques années sa contribution, parmi d’autres, à un rapport sur la situation du jazz en France commandé par le Ministère du culture où il a dû servir à caler un pied de bureau, dont témoigne aussi le petit exercice de concision que lui a réclamé Jazz Magazine pour dire son avis à propos du disque qui fait débat dans notre numéro de juillet, “Music Of Weather Report” de Miroslav Vitous. J’en oublie l’heure du concert de Malna et rejoint tardivement le petit théâtre de verdure où il se produit déjà depuis un moment.
Malna : Lilian Mille (trompette), Auxane Cartigny (piano électrique), Antonin Fresson (guitare électrique), Nicolas Morinot (basse électrique), Marco Girardi (batterie).
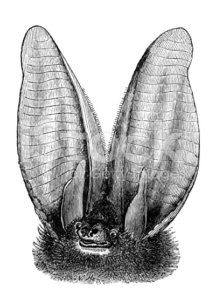 De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
Laura Perrudin (chant, harpe).
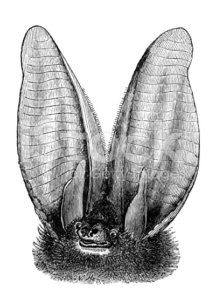 J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
Puis elle enchaîne sur un répertoire plus ancien encore, celui qui avait attiré mon attention voici quatre ans en me promenant sur internet suite à mes interrogations sur la capacité pour la harpe de trouver sa place dans le monde du jazz. Elle y harmonisait des standards avec des compétences de pianiste qu’elle doit à sa connaissance du jazz qu’elle découvrit enfant à l’écoute de Wayne Shorter et qu’elle se donna mille moyens d’approfondir tout en l’ouvrant, qu’elle doit aussi au choix d’une harpe chromatique dépourvue des encombrantes pédales, la débarrassant de cette contrainte mécanique au profit de contrainte qui ne sont probablement pas moindres mais que je qualifierais de plus “gracieuses”. Et il y a de la grâce non seulement dans son chant, mais plus encore dans la façon dont elle réharmonise Solitude et Easy Leaving, encore plus savamment qu’autrefois, m’a-t-il semblé hier, avec des angles qui pourraient évoquer Paul Bley, Ran Blake ou Kris Davis. Entre deux morceaux, elle s’amuse soudain d’un criquet posé sur sa corde de la bémol qui, ayant décidé de ne pas la déranger, lui aura inspiré une solution harmonique inattendue. Puis acceptant un rappel, malgré le froid tombé sur ses épaules, descend de scène sans micro pour chanter un vieux spiritual qu’elle fait accompagner par le public claquant des doits. En fermant les yeux, dans cet air frais et ces odeurs d’herbes fraîchement coupées, on se prendrait presque pour le vieux Lomax, John le père, collectant Vera Hall
dans les années 1930 bien qu’à mon souvenir, elle n’ai jamais chanté cette chanson devant son micro, mais, cette interprétation lui ressemblait. Presque évidemment, mais ne refusons pas cette grâce qui nous est offert de rêver un peu et que le public a su saisir avec des frissons où l’émotion prit le dessus sur les effets du froid.
Signalons, parmi un calendrier très plein, qu’elle se produira dans une formule encore inédite aux côtés de Théo Ceccaldi et Federico Casagrande, le jeudi 7 juillet à Paris au Studio de l’Ermitage.
Julien Lourau (saxes ténor et soprano), Bojan Zulfikarpasic (piano, piano électrique, électronique).
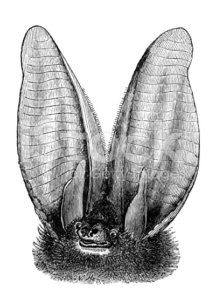 Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Entre temps, le ciel enfin dégagé, l’heure bleue est descendue sur l’abbaye, laissant un dernier liseré rouge s’éteindre à l’horizon aperçu de ma chambre alors que je récupérais, pour la fin de soirée, une petite laine rendue nécessaire par un froid tenace. Il explique peut-être l’obstination des chauves souris attendues la veille à ne pas se montrer, plongées dans une hibernation hors saison, à moins que le fantôme de la mère supérieure dont j’occupe la chambre n’ait rendu indésirables en ces lieux les infernales connotations qui les accompagnent.
The Watershed : Christophe Panzani (sax ténor, clarinette basse), Pierre Perchaud (guitares), Tony Paeleman (claviers, électronique), Karl Jannuska (batterie).
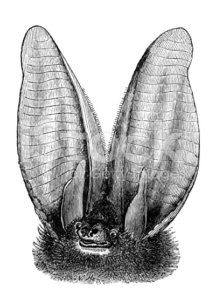 L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
C’est foutrement réjouissant de voir comme partant de rien, les quatre musiciens progressent à l’écoute l’un de l’autre, d’observer qui mène, qui emboîte le pas, souvent pour prendre à son tour l’initiative. Panzani avait prévenu : « quand ça marche, c’est terrible ! » A l’écoute du premier morceau, on le pressent. « Mais ça ne marche pas toujours. » Ce que l’on pressent aussi à l’écoute de la suite. Non qu’il y ait échec patent, mais le sentiment que passé l’enthousiasme du disque et des premiers concerts, le groupe, doit peaufiner ses stratégies, définir quelques interdits à l’égard de certaines facilités, réjouissantes sur le moment, mais qui pourraient rapidement amener le groupe à ronronner. On garde en mémoire les meilleurs moments qui n’étaient pas rares, ravi de voir invité en réponse à un chaleureux rappel du public le duo de la première partie, au risque de dénaturer un authentique son de groupe et de disperser une énergie jusque là très concentrée. On applaudit volontiers tout en se levant, non pas dans l’esprit d’une standing ovation, mais parce qu’il fait bougrement froid. Les plus courageux, encore nombreux, se rendent à la buvette où le Malna Quintet ouvre la jam session avec Laura Perrudin sur un répertoire de standards qu’introduit le Whisper Not de Benny Golson.
![]()
![]()
![]()
![]() Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Tout commence en début d’après-midi par un exposé de Pierre de Bethmann sur le thème “Etre musicien de jazz aujourd’hui” et l’on s’y rend confiant tant on apprécie cette faconde réfléchie, méthodique dont témoigna il y a quelques années sa contribution, parmi d’autres, à un rapport sur la situation du jazz en France commandé par le Ministère du culture où il a dû servir à caler un pied de bureau, dont témoigne aussi le petit exercice de concision que lui a réclamé Jazz Magazine pour dire son avis à propos du disque qui fait débat dans notre numéro de juillet, “Music Of Weather Report” de Miroslav Vitous. J’en oublie l’heure du concert de Malna et rejoint tardivement le petit théâtre de verdure où il se produit déjà depuis un moment.
Malna : Lilian Mille (trompette), Auxane Cartigny (piano électrique), Antonin Fresson (guitare électrique), Nicolas Morinot (basse électrique), Marco Girardi (batterie).
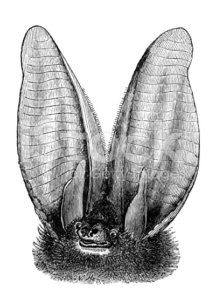 De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
Laura Perrudin (chant, harpe).
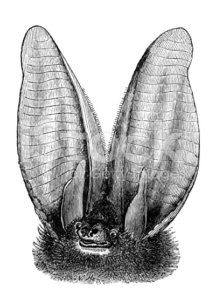 J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
Puis elle enchaîne sur un répertoire plus ancien encore, celui qui avait attiré mon attention voici quatre ans en me promenant sur internet suite à mes interrogations sur la capacité pour la harpe de trouver sa place dans le monde du jazz. Elle y harmonisait des standards avec des compétences de pianiste qu’elle doit à sa connaissance du jazz qu’elle découvrit enfant à l’écoute de Wayne Shorter et qu’elle se donna mille moyens d’approfondir tout en l’ouvrant, qu’elle doit aussi au choix d’une harpe chromatique dépourvue des encombrantes pédales, la débarrassant de cette contrainte mécanique au profit de contrainte qui ne sont probablement pas moindres mais que je qualifierais de plus “gracieuses”. Et il y a de la grâce non seulement dans son chant, mais plus encore dans la façon dont elle réharmonise Solitude et Easy Leaving, encore plus savamment qu’autrefois, m’a-t-il semblé hier, avec des angles qui pourraient évoquer Paul Bley, Ran Blake ou Kris Davis. Entre deux morceaux, elle s’amuse soudain d’un criquet posé sur sa corde de la bémol qui, ayant décidé de ne pas la déranger, lui aura inspiré une solution harmonique inattendue. Puis acceptant un rappel, malgré le froid tombé sur ses épaules, descend de scène sans micro pour chanter un vieux spiritual qu’elle fait accompagner par le public claquant des doits. En fermant les yeux, dans cet air frais et ces odeurs d’herbes fraîchement coupées, on se prendrait presque pour le vieux Lomax, John le père, collectant Vera Hall
dans les années 1930 bien qu’à mon souvenir, elle n’ai jamais chanté cette chanson devant son micro, mais, cette interprétation lui ressemblait. Presque évidemment, mais ne refusons pas cette grâce qui nous est offert de rêver un peu et que le public a su saisir avec des frissons où l’émotion prit le dessus sur les effets du froid.
Signalons, parmi un calendrier très plein, qu’elle se produira dans une formule encore inédite aux côtés de Théo Ceccaldi et Federico Casagrande, le jeudi 7 juillet à Paris au Studio de l’Ermitage.
Julien Lourau (saxes ténor et soprano), Bojan Zulfikarpasic (piano, piano électrique, électronique).
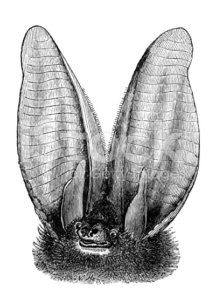 Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Entre temps, le ciel enfin dégagé, l’heure bleue est descendue sur l’abbaye, laissant un dernier liseré rouge s’éteindre à l’horizon aperçu de ma chambre alors que je récupérais, pour la fin de soirée, une petite laine rendue nécessaire par un froid tenace. Il explique peut-être l’obstination des chauves souris attendues la veille à ne pas se montrer, plongées dans une hibernation hors saison, à moins que le fantôme de la mère supérieure dont j’occupe la chambre n’ait rendu indésirables en ces lieux les infernales connotations qui les accompagnent.
The Watershed : Christophe Panzani (sax ténor, clarinette basse), Pierre Perchaud (guitares), Tony Paeleman (claviers, électronique), Karl Jannuska (batterie).
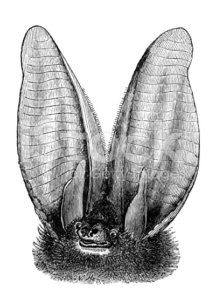 L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
C’est foutrement réjouissant de voir comme partant de rien, les quatre musiciens progressent à l’écoute l’un de l’autre, d’observer qui mène, qui emboîte le pas, souvent pour prendre à son tour l’initiative. Panzani avait prévenu : « quand ça marche, c’est terrible ! » A l’écoute du premier morceau, on le pressent. « Mais ça ne marche pas toujours. » Ce que l’on pressent aussi à l’écoute de la suite. Non qu’il y ait échec patent, mais le sentiment que passé l’enthousiasme du disque et des premiers concerts, le groupe, doit peaufiner ses stratégies, définir quelques interdits à l’égard de certaines facilités, réjouissantes sur le moment, mais qui pourraient rapidement amener le groupe à ronronner. On garde en mémoire les meilleurs moments qui n’étaient pas rares, ravi de voir invité en réponse à un chaleureux rappel du public le duo de la première partie, au risque de dénaturer un authentique son de groupe et de disperser une énergie jusque là très concentrée. On applaudit volontiers tout en se levant, non pas dans l’esprit d’une standing ovation, mais parce qu’il fait bougrement froid. Les plus courageux, encore nombreux, se rendent à la buvette où le Malna Quintet ouvre la jam session avec Laura Perrudin sur un répertoire de standards qu’introduit le Whisper Not de Benny Golson.
![]()
![]()
![]()
![]() Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Tout commence en début d’après-midi par un exposé de Pierre de Bethmann sur le thème “Etre musicien de jazz aujourd’hui” et l’on s’y rend confiant tant on apprécie cette faconde réfléchie, méthodique dont témoigna il y a quelques années sa contribution, parmi d’autres, à un rapport sur la situation du jazz en France commandé par le Ministère du culture où il a dû servir à caler un pied de bureau, dont témoigne aussi le petit exercice de concision que lui a réclamé Jazz Magazine pour dire son avis à propos du disque qui fait débat dans notre numéro de juillet, “Music Of Weather Report” de Miroslav Vitous. J’en oublie l’heure du concert de Malna et rejoint tardivement le petit théâtre de verdure où il se produit déjà depuis un moment.
Malna : Lilian Mille (trompette), Auxane Cartigny (piano électrique), Antonin Fresson (guitare électrique), Nicolas Morinot (basse électrique), Marco Girardi (batterie).
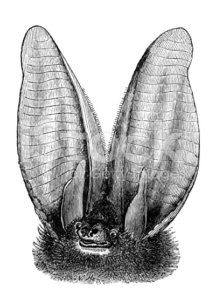 De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
Laura Perrudin (chant, harpe).
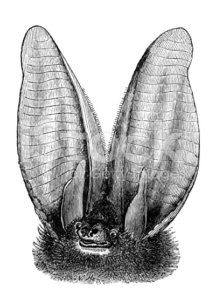 J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
Puis elle enchaîne sur un répertoire plus ancien encore, celui qui avait attiré mon attention voici quatre ans en me promenant sur internet suite à mes interrogations sur la capacité pour la harpe de trouver sa place dans le monde du jazz. Elle y harmonisait des standards avec des compétences de pianiste qu’elle doit à sa connaissance du jazz qu’elle découvrit enfant à l’écoute de Wayne Shorter et qu’elle se donna mille moyens d’approfondir tout en l’ouvrant, qu’elle doit aussi au choix d’une harpe chromatique dépourvue des encombrantes pédales, la débarrassant de cette contrainte mécanique au profit de contrainte qui ne sont probablement pas moindres mais que je qualifierais de plus “gracieuses”. Et il y a de la grâce non seulement dans son chant, mais plus encore dans la façon dont elle réharmonise Solitude et Easy Leaving, encore plus savamment qu’autrefois, m’a-t-il semblé hier, avec des angles qui pourraient évoquer Paul Bley, Ran Blake ou Kris Davis. Entre deux morceaux, elle s’amuse soudain d’un criquet posé sur sa corde de la bémol qui, ayant décidé de ne pas la déranger, lui aura inspiré une solution harmonique inattendue. Puis acceptant un rappel, malgré le froid tombé sur ses épaules, descend de scène sans micro pour chanter un vieux spiritual qu’elle fait accompagner par le public claquant des doits. En fermant les yeux, dans cet air frais et ces odeurs d’herbes fraîchement coupées, on se prendrait presque pour le vieux Lomax, John le père, collectant Vera Hall
dans les années 1930 bien qu’à mon souvenir, elle n’ai jamais chanté cette chanson devant son micro, mais, cette interprétation lui ressemblait. Presque évidemment, mais ne refusons pas cette grâce qui nous est offert de rêver un peu et que le public a su saisir avec des frissons où l’émotion prit le dessus sur les effets du froid.
Signalons, parmi un calendrier très plein, qu’elle se produira dans une formule encore inédite aux côtés de Théo Ceccaldi et Federico Casagrande, le jeudi 7 juillet à Paris au Studio de l’Ermitage.
Julien Lourau (saxes ténor et soprano), Bojan Zulfikarpasic (piano, piano électrique, électronique).
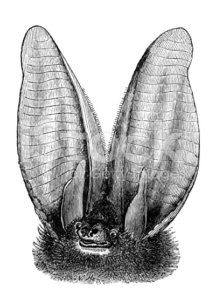 Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Entre temps, le ciel enfin dégagé, l’heure bleue est descendue sur l’abbaye, laissant un dernier liseré rouge s’éteindre à l’horizon aperçu de ma chambre alors que je récupérais, pour la fin de soirée, une petite laine rendue nécessaire par un froid tenace. Il explique peut-être l’obstination des chauves souris attendues la veille à ne pas se montrer, plongées dans une hibernation hors saison, à moins que le fantôme de la mère supérieure dont j’occupe la chambre n’ait rendu indésirables en ces lieux les infernales connotations qui les accompagnent.
The Watershed : Christophe Panzani (sax ténor, clarinette basse), Pierre Perchaud (guitares), Tony Paeleman (claviers, électronique), Karl Jannuska (batterie).
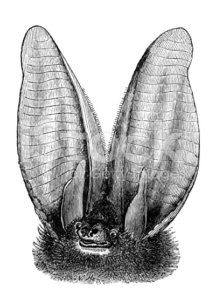 L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
C’est foutrement réjouissant de voir comme partant de rien, les quatre musiciens progressent à l’écoute l’un de l’autre, d’observer qui mène, qui emboîte le pas, souvent pour prendre à son tour l’initiative. Panzani avait prévenu : « quand ça marche, c’est terrible ! » A l’écoute du premier morceau, on le pressent. « Mais ça ne marche pas toujours. » Ce que l’on pressent aussi à l’écoute de la suite. Non qu’il y ait échec patent, mais le sentiment que passé l’enthousiasme du disque et des premiers concerts, le groupe, doit peaufiner ses stratégies, définir quelques interdits à l’égard de certaines facilités, réjouissantes sur le moment, mais qui pourraient rapidement amener le groupe à ronronner. On garde en mémoire les meilleurs moments qui n’étaient pas rares, ravi de voir invité en réponse à un chaleureux rappel du public le duo de la première partie, au risque de dénaturer un authentique son de groupe et de disperser une énergie jusque là très concentrée. On applaudit volontiers tout en se levant, non pas dans l’esprit d’une standing ovation, mais parce qu’il fait bougrement froid. Les plus courageux, encore nombreux, se rendent à la buvette où le Malna Quintet ouvre la jam session avec Laura Perrudin sur un répertoire de standards qu’introduit le Whisper Not de Benny Golson.
![]()
![]()
![]()
![]() Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot|Deuxième journée, la plus longue, sous des cieux plus cléments, et où la musique a eu raison du froid qui recroquevillait le public néanmoins rivé à la scène jusqu’à nuit noire, puis peu pressé de quitter la buvette et ses jam sessions.
Tout commence en début d’après-midi par un exposé de Pierre de Bethmann sur le thème “Etre musicien de jazz aujourd’hui” et l’on s’y rend confiant tant on apprécie cette faconde réfléchie, méthodique dont témoigna il y a quelques années sa contribution, parmi d’autres, à un rapport sur la situation du jazz en France commandé par le Ministère du culture où il a dû servir à caler un pied de bureau, dont témoigne aussi le petit exercice de concision que lui a réclamé Jazz Magazine pour dire son avis à propos du disque qui fait débat dans notre numéro de juillet, “Music Of Weather Report” de Miroslav Vitous. J’en oublie l’heure du concert de Malna et rejoint tardivement le petit théâtre de verdure où il se produit déjà depuis un moment.
Malna : Lilian Mille (trompette), Auxane Cartigny (piano électrique), Antonin Fresson (guitare électrique), Nicolas Morinot (basse électrique), Marco Girardi (batterie).
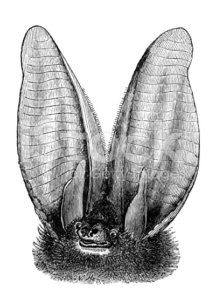 De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
De ce que j’aurai entendu de ces jeunes gens venus du CMDL, j’aurai pu apprécier la qualité formelle des compositions, le temps finement découpé par le batteur qui saura muscler son jeu lorsqu’il le faudra, une basse électrique et un piano électrique qui contribuent au sentiment d’espace caractérisant ce quintette dont la guitare et la trompette me rappelle d’emblée les univers de Kenny Wheeler et John Abercrombie, mais qui pourra évoquer à d’autres moments ceux de Christian Scott et des interlocuteurs de ses formations.
Laura Perrudin (chant, harpe).
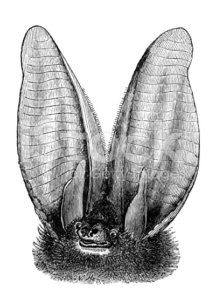 J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
J’aborde le concert de Laura Perrudin avec un sentiment de vacances. J’ai déjà beaucoup parlé d’elle dans ce blog et que pourrai-je écrire de plus. D’autant que – elle le regrette –, l’engageant pour son art, mais aussi pour le petit budget qu’elle représente, on lui refuse souvent l’engagement de son sonorisateur, la privant le plus souvent du programme “électronique” qui lui tient le plus à cœur. Ce qui la contraint à revenir à de “vieilles choses” alors que déjà, à la maison, désormais parisienne, elle est en pleine gestation de son prochain disque… Vacances donc où je retrouve comme on revient sur des plages connues ce que j’avais d’abord entendu d’elle. Point de plages de sable avec cabines de bains et alignements de serviettes et corps huilés, mais plutôt des chemins de douaniers entre landes et côte rocheuse. Ses mélodies en ont les angles abrupts et inattendus suivant des harmonies à l’herbe drue et aux genêts impénétrables où elle se déplace avec une adresse et une assurance caprine, sa voix planant au-dessus de quelques coups d’aile contre le vent, sur des textes rares de Yeats, Joyce, Wilde et Mauréas que l’on aimerait parfois mieux comprendre.
Puis elle enchaîne sur un répertoire plus ancien encore, celui qui avait attiré mon attention voici quatre ans en me promenant sur internet suite à mes interrogations sur la capacité pour la harpe de trouver sa place dans le monde du jazz. Elle y harmonisait des standards avec des compétences de pianiste qu’elle doit à sa connaissance du jazz qu’elle découvrit enfant à l’écoute de Wayne Shorter et qu’elle se donna mille moyens d’approfondir tout en l’ouvrant, qu’elle doit aussi au choix d’une harpe chromatique dépourvue des encombrantes pédales, la débarrassant de cette contrainte mécanique au profit de contrainte qui ne sont probablement pas moindres mais que je qualifierais de plus “gracieuses”. Et il y a de la grâce non seulement dans son chant, mais plus encore dans la façon dont elle réharmonise Solitude et Easy Leaving, encore plus savamment qu’autrefois, m’a-t-il semblé hier, avec des angles qui pourraient évoquer Paul Bley, Ran Blake ou Kris Davis. Entre deux morceaux, elle s’amuse soudain d’un criquet posé sur sa corde de la bémol qui, ayant décidé de ne pas la déranger, lui aura inspiré une solution harmonique inattendue. Puis acceptant un rappel, malgré le froid tombé sur ses épaules, descend de scène sans micro pour chanter un vieux spiritual qu’elle fait accompagner par le public claquant des doits. En fermant les yeux, dans cet air frais et ces odeurs d’herbes fraîchement coupées, on se prendrait presque pour le vieux Lomax, John le père, collectant Vera Hall
dans les années 1930 bien qu’à mon souvenir, elle n’ai jamais chanté cette chanson devant son micro, mais, cette interprétation lui ressemblait. Presque évidemment, mais ne refusons pas cette grâce qui nous est offert de rêver un peu et que le public a su saisir avec des frissons où l’émotion prit le dessus sur les effets du froid.
Signalons, parmi un calendrier très plein, qu’elle se produira dans une formule encore inédite aux côtés de Théo Ceccaldi et Federico Casagrande, le jeudi 7 juillet à Paris au Studio de l’Ermitage.
Julien Lourau (saxes ténor et soprano), Bojan Zulfikarpasic (piano, piano électrique, électronique).
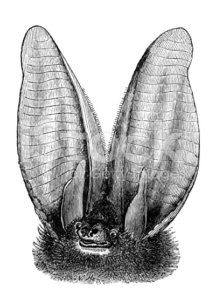 Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Et revoici le vieux tandem, bien des années plus tard. L’électronique apparue entre temps, beaucoup de savoir faire accumulé au fil des rencontres et des expériences. Et toujours cette passion commune pour les Balkans que Julien (et à l’époque Noël Akchoté) avaient su faire (re)découvrir à Bojan lorsqu’il débarqua à Paris pour s’inscrire à l’école du Cim (où quelques cours suffirent à révéler qu’il y avait place plus du côté du corps enseignant que comme étudiant). On sait la carrière qui s’en est suivi. Le revoici et ces accents balkaniques qui leur collent aux doigts, les siens et ceux de son compère. Découvrant en mai dernier Bojan en duo avec Erik Marchand, j’avais cru y percevoir un piège possible, celui de l’ornement, du décoratif, de la joliesse, d’une redondance avec la partie chantée. Un piège dont on ne sait dire s’il est contourné ou revendiqué par le duo, dans les deux cas avec une assurance redevable à des stratégies savantes et un élan qui ont l’âge, la maturité et la décontraction naturelle de leur complicité. Et si la musique est plus directement séduisante que le trio de la veille, parce que moins “abstraite”, plus lisible, plus festive (on le sait, les Balkans sont festifs comme le Français est un gros mangeur de pain et l’Américain un grand enfant), avec toutefois des hymnes aux accents quasi liturgiques, mais de manière générale plus ludique, en tout cas selon des règles du jeu qui n’exige pas d’expertise particulière pour en jouir directement, qu’il s’agisse du jeu, du rythme ou des sonorités.
Entre temps, le ciel enfin dégagé, l’heure bleue est descendue sur l’abbaye, laissant un dernier liseré rouge s’éteindre à l’horizon aperçu de ma chambre alors que je récupérais, pour la fin de soirée, une petite laine rendue nécessaire par un froid tenace. Il explique peut-être l’obstination des chauves souris attendues la veille à ne pas se montrer, plongées dans une hibernation hors saison, à moins que le fantôme de la mère supérieure dont j’occupe la chambre n’ait rendu indésirables en ces lieux les infernales connotations qui les accompagnent.
The Watershed : Christophe Panzani (sax ténor, clarinette basse), Pierre Perchaud (guitares), Tony Paeleman (claviers, électronique), Karl Jannuska (batterie).
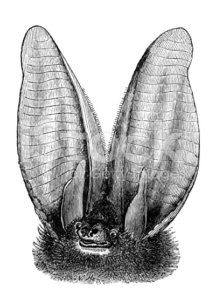 L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
L’objet du groupe, nous expliquera Christophe Panzani, c’est de jouer sans partition, ni aucun préalable autre qu’une complicité éprouvée. Et ce qui rameutera le public, ce sera moins la cloche de l’ancien couvent que l’appel du ténor de Christophe Panzani dissimulé derrière le public auquel répond une lancinante guitare et des cymbales givrées. Dégel progressif alors que paraît enfin Panzani, puis Tony Paeleman. Un groove s’improvise, s’installe, grossit, se mue, porté par un Jannuska tribal dans une jungle électronique qu’habitent les claviers et effets de Paeleman, la clarinette basse et les pédales de Panzani… Et je m’arrête sur cette clarinette basse, avant de dire que son ténor aura des accents entendus dans le grand nord “eu-cé-émien” (ou ECMien, ou surmano-garbareko-trygveseimein), pour dire combien elle m’en évoque une autre, celle de Bennie Maupin dans “Bitches Brew” (que Julien Lourau invité en rappel avec son compère, citera brièvement, probablement pas par hasard) et qu’évoque plus encore les effets sonores et les loops qu’elle commande. Tandis que Tony Paeleman évoquerait plutôt Joe Zawinul, magicien iconoclaste des claviers, la musique elle-même renvoyant aux côtés les plus improvisés du premier Weather Report revisité non dans l’imitation mais à travers cette fraîcheur même qu’avait le groupe à ses débuts. Quant à Pierre Perchaud, toujours éclectique, il se fait insaisissable, sinon par cette touche “americana” qu’il décline ici et là.
C’est foutrement réjouissant de voir comme partant de rien, les quatre musiciens progressent à l’écoute l’un de l’autre, d’observer qui mène, qui emboîte le pas, souvent pour prendre à son tour l’initiative. Panzani avait prévenu : « quand ça marche, c’est terrible ! » A l’écoute du premier morceau, on le pressent. « Mais ça ne marche pas toujours. » Ce que l’on pressent aussi à l’écoute de la suite. Non qu’il y ait échec patent, mais le sentiment que passé l’enthousiasme du disque et des premiers concerts, le groupe, doit peaufiner ses stratégies, définir quelques interdits à l’égard de certaines facilités, réjouissantes sur le moment, mais qui pourraient rapidement amener le groupe à ronronner. On garde en mémoire les meilleurs moments qui n’étaient pas rares, ravi de voir invité en réponse à un chaleureux rappel du public le duo de la première partie, au risque de dénaturer un authentique son de groupe et de disperser une énergie jusque là très concentrée. On applaudit volontiers tout en se levant, non pas dans l’esprit d’une standing ovation, mais parce qu’il fait bougrement froid. Les plus courageux, encore nombreux, se rendent à la buvette où le Malna Quintet ouvre la jam session avec Laura Perrudin sur un répertoire de standards qu’introduit le Whisper Not de Benny Golson.
![]()
![]()
![]()
![]() Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot
Je ne détaillerai pas les détails de cette jam qui dura jusqu’à trois heures du matin et que je quittais à deux heures, mais précisons que ce soir, à l’heure où je dépose ces souvenirs sur le net Géraldine Laurent et son quartette commence son concert à l’abbaye Saint-Gilles du Puypéroux, suivie de l’Ensemble Art Sonic de Joce Mienniel, Cédric Châtelain, Sylvain Rifflet, Sophie Bernado et Didier Ithursarry qui donneront leur Bal Perdu sur un répertoire musette revisité. • Franck Bergerot
