Le Trio Oliva – Abbuehl – Hegg-Lunde aux Lombards
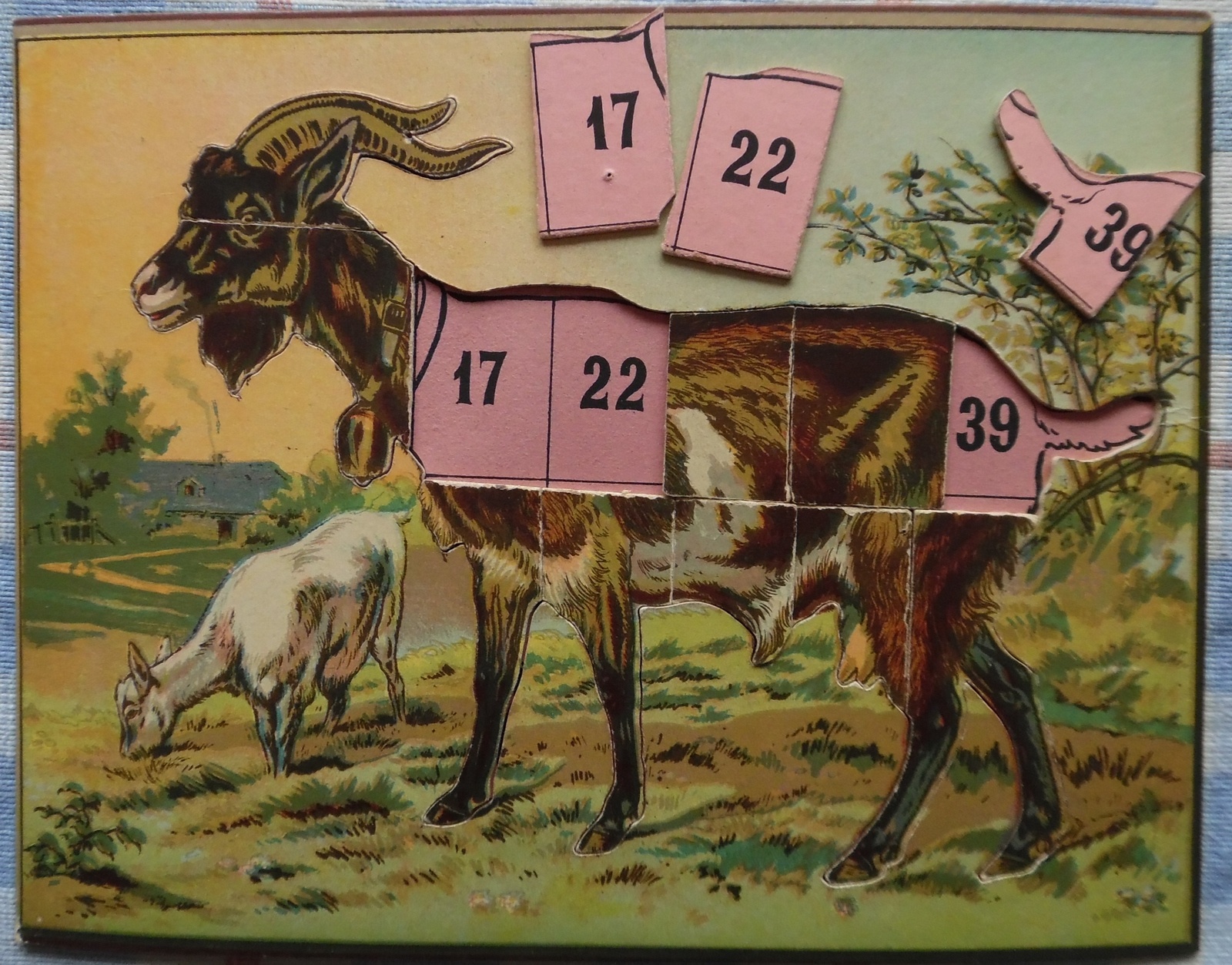
C’était hier, 12 mai, aux Ducs des Lombards, où Stéphan Oliva, Susanne Abbeuhl et Oyvind Hegg-Lunde présentaient le répertoire de leur disque “Princess” publié chez Vision fugitive.
Le hasard a voulu que quelques jours auparavant parvienne sur ma platine le second disque ECM de la chanteuse anglaise June Tabor en trio avec la pianiste Huw Warren et le saxophoniste Iain Ballamy. Même, si le registre est légèrement plus grave, et l’ambitus probablement plus étroit, chez cette dernière, ce début de récital de Susanne Abbuehl sur The Listening de Jimmy Giuffre, avec cette voix droite et dépouillée, cette douce mais ferme autorité, me renvoie plus aux contrées musicales irlando-britanniques fréquentées du temps de mes années folk, qu’à Ella Fitzgerald, Anita O’Day et ma culture de jazz critic. Depuis que je la découvris en tandem avec Maddy Prior au sein du duo The Silly Sisters aux alentours de 1976, même si elle s’est rapprochée du monde du jazz dont elle a repris certains standards, et du rock anglais dont elle a exploré les contours “progressive”, June Tabor est restée une chanteuse folk, relativement straight, là où Susanne Abbuehl trouve plus naturellement sa place dans les jazz clubs par un rapport à l’improvisation, certes “minimal”, une sophistication du placement et les abstractions d’un répertoire emprunté à Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith Jarrett (mais où les résonnances folk sont loin d’être absentes).
Mais concentrons nous sur ce que nous avons entendu hier sur la scène du Duc des Lombards et ce qu’entendirent la veille à la chapelle du Méjean à Arles Philippe Méziat, Xavier Prévost et Sophie Chambon (voir les pages précédentes de ce mail). D’abord un piano. On pense naturellement au duo Ran Blake-Jeanne Lee, par ce refus du traditionnel asservissement de l’accompagnement à la chanson, quoique Stéphan Oliva entretienne une relation beaucoup plus immédiate avec le chant que ne le faisait Ran Blake : carrure, pédales, ponctuations, unissons, contrepoints. Largement déployées, les ressources harmoniques du piano – on reconnaît ici ce qu’Oliva doit à Paul Bley – répondent moins au contrat harmonique qu’impose habituellement la mélodie prétexte dans le jazz qu’elles ne sont au service de la chanson, dans toutes ses dimensions, musique et texte. Nous sommes ici sur un territoire éminemment littéraire, voire pictural, et le piano – cristallin ou diluvien, les deux mains autonomes ou solidaires l’une de l’autre – joue moins une grille qu’il ne joue un programme de couleurs, de formes, d’évocations et de récits. On en dirait de même d’Oyvind Hegg-Lunde qui, même lorsqu’il entretient une pulsation sur ces peaux et métaux effleurés, a d’autres contrats en tête que celui du swing qui n’est, éventuellement, qu’un arrière-plan au service d’une rêverie.
Ainsi va donc l’auteure-interprète Susanne Abbuehl, dans son pays des songes, dont les vocalises empruntent parfois au scat sans chercher trop à s’en approcher, avec quelque chose de brut derrière une préciosité de surface et un rapport très aérien au rythme, qui m’évoque moins le jazz vocal que certains rites améridiens. La reprise de Desireless et Mopti de Don Cherry n’est probablement pas étrangère à cette impression que je retrouve néanmoins dans la Mosquito Dance de Jimmy Giuffre, les vocalises initiales de Winter Day signées Oliva-Abbuehl m’évoquant quelque sean-nós apatride, arraché à la terre irlandaise par cet art du choral que Keith Jarrett a su faire sien. Et voilà justement Jarrett, avec Great Bird (tiré de “Death and the Flower”), le Jarrett du quartette américain dont je porte l’inconsolable deuil – comme de ces années 1970, mes années folk. Délicieuse écharde que vient doucement mais sûrement retourner le trio. • Franck Bergerot
|C’était hier, 12 mai, aux Ducs des Lombards, où Stéphan Oliva, Susanne Abbeuhl et Oyvind Hegg-Lunde présentaient le répertoire de leur disque “Princess” publié chez Vision fugitive.
Le hasard a voulu que quelques jours auparavant parvienne sur ma platine le second disque ECM de la chanteuse anglaise June Tabor en trio avec la pianiste Huw Warren et le saxophoniste Iain Ballamy. Même, si le registre est légèrement plus grave, et l’ambitus probablement plus étroit, chez cette dernière, ce début de récital de Susanne Abbuehl sur The Listening de Jimmy Giuffre, avec cette voix droite et dépouillée, cette douce mais ferme autorité, me renvoie plus aux contrées musicales irlando-britanniques fréquentées du temps de mes années folk, qu’à Ella Fitzgerald, Anita O’Day et ma culture de jazz critic. Depuis que je la découvris en tandem avec Maddy Prior au sein du duo The Silly Sisters aux alentours de 1976, même si elle s’est rapprochée du monde du jazz dont elle a repris certains standards, et du rock anglais dont elle a exploré les contours “progressive”, June Tabor est restée une chanteuse folk, relativement straight, là où Susanne Abbuehl trouve plus naturellement sa place dans les jazz clubs par un rapport à l’improvisation, certes “minimal”, une sophistication du placement et les abstractions d’un répertoire emprunté à Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith Jarrett (mais où les résonnances folk sont loin d’être absentes).
Mais concentrons nous sur ce que nous avons entendu hier sur la scène du Duc des Lombards et ce qu’entendirent la veille à la chapelle du Méjean à Arles Philippe Méziat, Xavier Prévost et Sophie Chambon (voir les pages précédentes de ce mail). D’abord un piano. On pense naturellement au duo Ran Blake-Jeanne Lee, par ce refus du traditionnel asservissement de l’accompagnement à la chanson, quoique Stéphan Oliva entretienne une relation beaucoup plus immédiate avec le chant que ne le faisait Ran Blake : carrure, pédales, ponctuations, unissons, contrepoints. Largement déployées, les ressources harmoniques du piano – on reconnaît ici ce qu’Oliva doit à Paul Bley – répondent moins au contrat harmonique qu’impose habituellement la mélodie prétexte dans le jazz qu’elles ne sont au service de la chanson, dans toutes ses dimensions, musique et texte. Nous sommes ici sur un territoire éminemment littéraire, voire pictural, et le piano – cristallin ou diluvien, les deux mains autonomes ou solidaires l’une de l’autre – joue moins une grille qu’il ne joue un programme de couleurs, de formes, d’évocations et de récits. On en dirait de même d’Oyvind Hegg-Lunde qui, même lorsqu’il entretient une pulsation sur ces peaux et métaux effleurés, a d’autres contrats en tête que celui du swing qui n’est, éventuellement, qu’un arrière-plan au service d’une rêverie.
Ainsi va donc l’auteure-interprète Susanne Abbuehl, dans son pays des songes, dont les vocalises empruntent parfois au scat sans chercher trop à s’en approcher, avec quelque chose de brut derrière une préciosité de surface et un rapport très aérien au rythme, qui m’évoque moins le jazz vocal que certains rites améridiens. La reprise de Desireless et Mopti de Don Cherry n’est probablement pas étrangère à cette impression que je retrouve néanmoins dans la Mosquito Dance de Jimmy Giuffre, les vocalises initiales de Winter Day signées Oliva-Abbuehl m’évoquant quelque sean-nós apatride, arraché à la terre irlandaise par cet art du choral que Keith Jarrett a su faire sien. Et voilà justement Jarrett, avec Great Bird (tiré de “Death and the Flower”), le Jarrett du quartette américain dont je porte l’inconsolable deuil – comme de ces années 1970, mes années folk. Délicieuse écharde que vient doucement mais sûrement retourner le trio. • Franck Bergerot
|C’était hier, 12 mai, aux Ducs des Lombards, où Stéphan Oliva, Susanne Abbeuhl et Oyvind Hegg-Lunde présentaient le répertoire de leur disque “Princess” publié chez Vision fugitive.
Le hasard a voulu que quelques jours auparavant parvienne sur ma platine le second disque ECM de la chanteuse anglaise June Tabor en trio avec la pianiste Huw Warren et le saxophoniste Iain Ballamy. Même, si le registre est légèrement plus grave, et l’ambitus probablement plus étroit, chez cette dernière, ce début de récital de Susanne Abbuehl sur The Listening de Jimmy Giuffre, avec cette voix droite et dépouillée, cette douce mais ferme autorité, me renvoie plus aux contrées musicales irlando-britanniques fréquentées du temps de mes années folk, qu’à Ella Fitzgerald, Anita O’Day et ma culture de jazz critic. Depuis que je la découvris en tandem avec Maddy Prior au sein du duo The Silly Sisters aux alentours de 1976, même si elle s’est rapprochée du monde du jazz dont elle a repris certains standards, et du rock anglais dont elle a exploré les contours “progressive”, June Tabor est restée une chanteuse folk, relativement straight, là où Susanne Abbuehl trouve plus naturellement sa place dans les jazz clubs par un rapport à l’improvisation, certes “minimal”, une sophistication du placement et les abstractions d’un répertoire emprunté à Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith Jarrett (mais où les résonnances folk sont loin d’être absentes).
Mais concentrons nous sur ce que nous avons entendu hier sur la scène du Duc des Lombards et ce qu’entendirent la veille à la chapelle du Méjean à Arles Philippe Méziat, Xavier Prévost et Sophie Chambon (voir les pages précédentes de ce mail). D’abord un piano. On pense naturellement au duo Ran Blake-Jeanne Lee, par ce refus du traditionnel asservissement de l’accompagnement à la chanson, quoique Stéphan Oliva entretienne une relation beaucoup plus immédiate avec le chant que ne le faisait Ran Blake : carrure, pédales, ponctuations, unissons, contrepoints. Largement déployées, les ressources harmoniques du piano – on reconnaît ici ce qu’Oliva doit à Paul Bley – répondent moins au contrat harmonique qu’impose habituellement la mélodie prétexte dans le jazz qu’elles ne sont au service de la chanson, dans toutes ses dimensions, musique et texte. Nous sommes ici sur un territoire éminemment littéraire, voire pictural, et le piano – cristallin ou diluvien, les deux mains autonomes ou solidaires l’une de l’autre – joue moins une grille qu’il ne joue un programme de couleurs, de formes, d’évocations et de récits. On en dirait de même d’Oyvind Hegg-Lunde qui, même lorsqu’il entretient une pulsation sur ces peaux et métaux effleurés, a d’autres contrats en tête que celui du swing qui n’est, éventuellement, qu’un arrière-plan au service d’une rêverie.
Ainsi va donc l’auteure-interprète Susanne Abbuehl, dans son pays des songes, dont les vocalises empruntent parfois au scat sans chercher trop à s’en approcher, avec quelque chose de brut derrière une préciosité de surface et un rapport très aérien au rythme, qui m’évoque moins le jazz vocal que certains rites améridiens. La reprise de Desireless et Mopti de Don Cherry n’est probablement pas étrangère à cette impression que je retrouve néanmoins dans la Mosquito Dance de Jimmy Giuffre, les vocalises initiales de Winter Day signées Oliva-Abbuehl m’évoquant quelque sean-nós apatride, arraché à la terre irlandaise par cet art du choral que Keith Jarrett a su faire sien. Et voilà justement Jarrett, avec Great Bird (tiré de “Death and the Flower”), le Jarrett du quartette américain dont je porte l’inconsolable deuil – comme de ces années 1970, mes années folk. Délicieuse écharde que vient doucement mais sûrement retourner le trio. • Franck Bergerot
|C’était hier, 12 mai, aux Ducs des Lombards, où Stéphan Oliva, Susanne Abbeuhl et Oyvind Hegg-Lunde présentaient le répertoire de leur disque “Princess” publié chez Vision fugitive.
Le hasard a voulu que quelques jours auparavant parvienne sur ma platine le second disque ECM de la chanteuse anglaise June Tabor en trio avec la pianiste Huw Warren et le saxophoniste Iain Ballamy. Même, si le registre est légèrement plus grave, et l’ambitus probablement plus étroit, chez cette dernière, ce début de récital de Susanne Abbuehl sur The Listening de Jimmy Giuffre, avec cette voix droite et dépouillée, cette douce mais ferme autorité, me renvoie plus aux contrées musicales irlando-britanniques fréquentées du temps de mes années folk, qu’à Ella Fitzgerald, Anita O’Day et ma culture de jazz critic. Depuis que je la découvris en tandem avec Maddy Prior au sein du duo The Silly Sisters aux alentours de 1976, même si elle s’est rapprochée du monde du jazz dont elle a repris certains standards, et du rock anglais dont elle a exploré les contours “progressive”, June Tabor est restée une chanteuse folk, relativement straight, là où Susanne Abbuehl trouve plus naturellement sa place dans les jazz clubs par un rapport à l’improvisation, certes “minimal”, une sophistication du placement et les abstractions d’un répertoire emprunté à Jimmy Giuffre, Don Cherry et Keith Jarrett (mais où les résonnances folk sont loin d’être absentes).
Mais concentrons nous sur ce que nous avons entendu hier sur la scène du Duc des Lombards et ce qu’entendirent la veille à la chapelle du Méjean à Arles Philippe Méziat, Xavier Prévost et Sophie Chambon (voir les pages précédentes de ce mail). D’abord un piano. On pense naturellement au duo Ran Blake-Jeanne Lee, par ce refus du traditionnel asservissement de l’accompagnement à la chanson, quoique Stéphan Oliva entretienne une relation beaucoup plus immédiate avec le chant que ne le faisait Ran Blake : carrure, pédales, ponctuations, unissons, contrepoints. Largement déployées, les ressources harmoniques du piano – on reconnaît ici ce qu’Oliva doit à Paul Bley – répondent moins au contrat harmonique qu’impose habituellement la mélodie prétexte dans le jazz qu’elles ne sont au service de la chanson, dans toutes ses dimensions, musique et texte. Nous sommes ici sur un territoire éminemment littéraire, voire pictural, et le piano – cristallin ou diluvien, les deux mains autonomes ou solidaires l’une de l’autre – joue moins une grille qu’il ne joue un programme de couleurs, de formes, d’évocations et de récits. On en dirait de même d’Oyvind Hegg-Lunde qui, même lorsqu’il entretient une pulsation sur ces peaux et métaux effleurés, a d’autres contrats en tête que celui du swing qui n’est, éventuellement, qu’un arrière-plan au service d’une rêverie.
Ainsi va donc l’auteure-interprète Susanne Abbuehl, dans son pays des songes, dont les vocalises empruntent parfois au scat sans chercher trop à s’en approcher, avec quelque chose de brut derrière une préciosité de surface et un rapport très aérien au rythme, qui m’évoque moins le jazz vocal que certains rites améridiens. La reprise de Desireless et Mopti de Don Cherry n’est probablement pas étrangère à cette impression que je retrouve néanmoins dans la Mosquito Dance de Jimmy Giuffre, les vocalises initiales de Winter Day signées Oliva-Abbuehl m’évoquant quelque sean-nós apatride, arraché à la terre irlandaise par cet art du choral que Keith Jarrett a su faire sien. Et voilà justement Jarrett, avec Great Bird (tiré de “Death and the Flower”), le Jarrett du quartette américain dont je porte l’inconsolable deuil – comme de ces années 1970, mes années folk. Délicieuse écharde que vient doucement mais sûrement retourner le trio. • Franck Bergerot